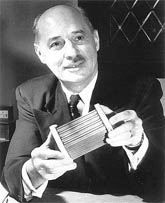Les portraits
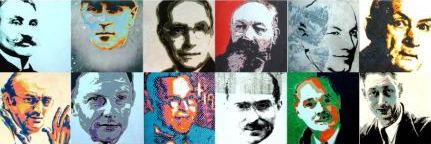
Portraits réalisés par
Pierre Marie DUTHIL (Li-Ai. 59)
Pierre Angénieux

Promotion Cluny 1925
Saint-Étienne 1907 – 1998
Concepteur-constructeur d’optiques pour la photographie et le cinéma
Grand public, professionnelles et scientifiques (NASA) Prix Nessim Habif en 1994

Pierre Angenieux sur wikipedia
“Pierre Angénieux est né le 14 juillet 1907 (…). Il entre en 1925 à l’Ecole des Arts et Métiers de Cluny et rejoint l’Ecole supérieure d’optique en 1928. Il entre dans la vie active et se retrouve chez Pathé. C’est l’âge d’or du cinéma, en pleine effervescence, tant dans le domaine de la production que de la recherche de la clientèle, mais aussi dans l’évolution des techniques (…). Il fonde son entreprise en 1935 et se tourne vers le marché du cinéma professionnel (…). Mais l’époque entraîne aussi des programmes importants pour la Défense, et des commandes de composants optiques et mécaniques. À l’instigation du gouvernement, Angénieux va se délocaliser et ouvrir un atelier d’optique dans son village natal, à Saint-Héand. À la débâcle de 1940, II se retrouve en zone libre. Un faible courant d’activité est maintenu grâce au cinéma français (…). L’atelier traverse ainsi les années noires dans un demi-sommeil. Mais Pierre Angénieux, lui, est bien éveillé. C’est au cours de cette période qu’il poursuit ses recherches dans le domaine du calcul des combinaisons optiques. Il prépare le futur, une stratégie pour le développement de son entreprise : l’instrument d’optique destiné à produire des images, c’est-à-dire les objectifs de prise de vue et de projection.
La société Angénieux va désormais bénéficier, en la personne de son patron, d’un opticien concepteur exceptionnel… Il choisit le concept du calcul trigonométrique de la marche des rayons lumineux pour développer ses objectifs. Dès la fin de la guerre, il installe une nouvelle usine moderne (…). Angénieux équipe de nombreuses marques d’appareils, tels que SEM, Lumière, Royer (de René Royer, ingénieur Arts et Métiers), et surtout Kodak-Pathé, dont il sera le fournisseur exclusif pendant dix ans. En 1950, avec le Retrofocus, Angénieux fait œuvre de novateur. Cinquante ans après, mondialement et exclusivement, le modèle demeure ; retrofocus est devenu un nom commun. La seconde innovation majeure signée Angénieux sera le zoom, en 1958 (…). Pour y parvenir, Pierre Angénieux écarte le système de la compensation optique au profit de la compensation mécanique (aujourd’hui universellement adoptée). L’apparition du zoom est un événement considérable pour le cinéma, la télévision et la photo. Peut-on imaginer le monde sans lui aujourd’hui ? (…) En 1964, la Nasa sélectionne l’objectif Angénieux et, le 31 juillet, pour la première fois, la Lune est photographiée à bout portant par la sonde spatiale Ranger Vil (…). En 1969, le 21 juillet, ce sont les premiers pas de l’homme sur la Lune, suivis par le monde entier grâce à un objectif Angénieux (…). En 1994, chaque vol de la navette spatiale met en œuvre plusieurs exemplaires de ce zoom. En 1964, puis en 1990, Pierre Angénieux recevra deux oscars pour ses travaux; en 1973, lui est attribué le Grand prix des ingénieurs civils et, en 1994, le prix Nessim Habif.
Il part à la retraite en 1975. Tout en restant impliqué dans son entreprise, il prend de la distance avec le quotidien, mais continue à inspirer les équipes qu’il a formées.”
Pour en savoir plus :
Chasseur d’images mars 1999-Un million et demi d’objectifs made in France, Patrice Hervé Pont.
Revue de l’association d’anciens élèves de l’Ecole Supérieure d’Optique – mars 1999, André Masson (ESO 48)
Extrait de l’article de Jean Vuillemin (Pa 40) paru dans Arts et Métiers Magazine Septembre 2001.
Pierre Bézier

Promotion Paris 1927
Paris 1910 – Bures-sur-Yvette 1999
Initiateur de la CAO
Auteur des ” Courbes de Bézier ”
Prix Nessim Habif 1972
Président de la Société des Ingénieurs Arts et Métiers
Si Pierre Bézier a effectué toute sa carrière chez Renault, les travaux de cet ingénieur intuitif et non-conformiste ont retenti dans tous les secteurs de l’industrie.
Pierre Bézier est né le 1er septembre 1910 à Paris. Son père, Jules Bézier (An. 1891), major de sa promotion, est Ingénieur principal aux Chemins de fer de l’État à Paris (très probablement le premier gadzarts à ce poste), et sa mère, Pascale Giraud, s’intéresse à la musique, au dessin et, plus rare, à la cryptographie et à l’analyse combinatoire. Il a un frère et deux sœurs. Son grand-père, prénommé également Jules, était entré à l’Ensam d’Angers en 1858… mais exclu pour ses pensées jugées trop subversives, s’était installé comme serrurier à Gallardon (Eure-et-Loir). Il fait notamment une serrure au pêne orné d’un R, la gâche arborant un F, pour “République Française” ! Un grand-oncle de Pierre Bézier, Pierre Feuardent (An. 1842), était quant à lui installé à Rennes.
Titulaire d’une bourse, Pierre Bézier entre au lycée Jean-Baptiste Say où il se concentre pleinement sur ses études, se refusant même toute sortie au cinéma. Il est reçu premier aux Arts et Métiers. À son grand dam, il n’en sort “que” deuxième… Puis, admis à faire Supélec en un an, il arrive sur le marché du travail en 1931.
Après deux premières expériences dans de petites sociétés, il entre en 1933 chez Renault. Il y fera toute sa carrière, depuis le poste d’ajusteur outilleur jusqu’aux fonctions de directeur fonctionnel à la direction générale. Mais bien au-delà du secteur automobile, ses travaux, alliant non-conformisme et intuition, retentiront sur toute l’industrie. Dès 1935, il rompt totalement avec l’utilisation généralisée de commandes hydrauliques en utilisant des relais électriques sous forme séquentielle (pour une grosse machine-outil à tarauder automatiquement les carters, par exemple). Il est alors chef de section Bureau d’études outillage.
Naissance d’Unisurf
Au lancement de la 4CV, en 1946, son objectif, très ambitieux pour l’époque, est d’assurer une cadence de 20 voitures/jour. Pour cela, il imagine une machine transfert à têtes indépendantes. Cette innovation est le fruit de ses réflexions, croquis à l’appui, transcrites sur des petits cahiers pendant sa “villégiature” dans l’Oflag XIA entre 1939 et 1941 (en même temps que Pierre Pillot – Li. 1923). En un an, son équipe réalise 750 unités d’usinage normalisées et 60 tables rotatives : la cadence atteint progressivement 300 voitures/jour. Ses machines spéciales sont vendues à travers le monde. Il est alors chef du Bureau d’études outillages mécaniques. En 1955, il s’intéresse à la commande numérique et, trois ans plus tard, met au point des perceuses avec des équipements aux commandes entièrement transistorisées. Sur cette période, il occupe successivement les postes de directeur des Méthodes de fabrications mécaniques et de directeur de la division Machines-outils.
Enfin, nommé directeur à la direction générale en 1960, il est déchargé de toute responsabilité opérationnelle. Les premiers ordinateurs faisant alors leur apparition, il réfléchit à l’utilisation de l’informatique dans la fabrication d’outillages de carrosserie. Pour cet ingénieur rigoureux, par tempérament et par l’expérience du 1/100e de mm acquise dans la production de pièces mécaniques, le système de fabrication des outillages de carrosserie, s’il est voisin de la sculpture d’art, n’est pas satisfaisant : trop long, coûteux, imprécis. Bref, peu compatible avec la fabrication en très grande série. Dans le droit fil d’une note rédigée en 1965, “Que tout soit représenté par des nombres dans l’entreprise et circule sous forme de nombres dans l’entreprise et chez les sous-traitants”, il choisit la voie la plus difficile à explorer : transformer les courbes de forme des stylistes de carrosserie en expressions mathématiques, ces dernières devant être utilisables par les ingénieurs grâce aux nouveaux instruments que sont l’ordinateur et ses liaisons avec les machines-outils.
En 1968, il présente partout, et en particulier à Détroit, alors temple de l’industrie automobile, un prototype du système Unisurf : une machine à dessiner, une fraiseuse, un ordinateur d’occasion avec une mémoire de 8 ko et un logiciel rudimentaire. Le système est opérationnel en 1972 et, avec Unisurf 3 en 1975, la CFAO (Conception et fabrication assistée par ordinateur) se généralise dans toute l’industrie, facilitant désormais la définition graphique d’objets aux formes complexes (nez des motrices TGV, sièges de voitures…)
Cette modélisation mathématique s’appuie sur les fameuses “courbes de Bézier”, représentatives de “polynômes paramétriques”, comme disent les mathématiciens. Connues dans le monde entier, au point de devenir un nom commun, elles sont présentées en détail dans les Actes du colloque Pierre Bézier, tenu à l’Ensam le 30 novembre 2000. Elles constituent le sujet de sa thèse de doctorat d’État en mathématiques défendue le 23 février 1977 sous le titre : “Essai de définition numérique des courbes et surfaces.” Il a alors 67 ans.
Homme d’engagement
Plein d’humour – il en donne volontiers la preuve aux lecteurs d’AMM dans les années 90 -, Pierre Bézier est loin d’être l’inventeur enfermé dans son univers scientifique que l’on pourrait imaginer au regard de son œuvre. Il a consacré beaucoup de temps à l’enseignement, notamment dans les cours du soir qu’il a donnés chez Renault de 1935 à 1957 (mathématiques, descriptive et dessin). Il s’est investi aussi comme président du Groupement pour l’avancement de la mécanique industrielle ou en tant que président de la Société des ingénieurs Arts et Métiers (organisation des journées du bicentenaire à Liancourt), président des ICF (Ingénieurs civils de France), etc. De nombreuses distinctions signent ces engagements : chevalier de la Légion d’honneur, Croix de guerre 39-45, médaille Coons et médaille Gregory de l’Association for Computer Machinery…
Pierre Bézier est décédé le 25 novembre 1999 et inhumé à Gallardon (Eure-et-Loir). Ses quatre enfants sont très engagés dans la perpétuation de sa mémoire. Le Monde du 10 décembre 1999 a salué “le concepteur de la représentation numérique des formes complexes”.
Edmond De Andrea (Ai 45)
Léon Chagnaud

Paris 1866 – 1930
Fondateur de l’entreprise de travaux publics Chagnaud
Sénateur de la Creuse

Transformer une PME de maçonnerie en un “grand” du BTP intervenant partout en France: l’œuvre de Léon Chagnaud aura marqué son temps.
C’est dans la Creuse, à Chanteloube, que Léon Chagnaud naît le 12 mars 1866. Son père, Hippolyte Chagnaud, vient d’installer son entreprise de maçonnerie à Guéret. Rapidement, la société oriente ses activités vers les travaux publics et participe à des chantiers importants à partir de 1870. Quant au jeune Léon, il quitte sa Creuse natale en 1881 pour les Arts et Métiers de Châlons-sur-Marne. Il s’y astreint à quatorze heures d’un labeur quotidien, avec la forte volonté de réussir. Ses études achevées, il retrouve l’entreprise paternelle.
Mais en 1891, Hippolyte Chagnaud décède brutalement d’une crise cardiaque. Sa forte personnalité et son goût du risque, couplés à sa quête perpétuelle d’innovations techniques, poussent Léon Chagnaud à devenir entrepreneur à 25 ans. Il crée son établissement tout en reprenant l’activité paternelle. Il intervient bientôt sur des chantiers plus importants et éloignés de la Creuse, dans l’Est de la France: fortification de la ville de Toul (de 1889 à 1891), voies ferrées entre Vitry et Blesmes. Il collabore à des travaux en région parisienne avec l’entreprise Fougerolle (de nos jours intégrée à Eiffage construction).
Avec la réalisation du collecteur de Clichy, ces chantiers participent au vaste plan d’assainissement de Paris lancé par Haussmann. Audacieux, Chagnaud utilise le bouclier métallique, un procédé inventé en 1818 et qu’il a nettement amélioré.
Il s’agit “d’une carapace métallique à l’abri de laquelle s’exécutent les fouilles et le revêtement de la galerie souterraine et qui se déplace progressivement à l’aide de vérins (…), en maintenant les terres et en offrant une protection efficace aux ouvriers”. Le gadzarts en améliore l’étanchéité et la résistance, tout en augmentant les vitesses de percement. Ce chantier lui apporte une véritable reconnaissance et marque le début d’une nouvelle ère dans les travaux souterrains.
De 1897 à 1899, Léon Chagnaud travaille pour la Compagnie du chemin de fer d’Orléans en construisant la gare d’Orsay et en réalisant les tronçons souterrains qui relient cette dernière à la gare d’Austerlitz. À 33 ans, le voilà élu administrateur du syndicat professionnel des entrepreneurs de travaux publics. Entouré d’ingénieurs talentueux, pour la plupart issus des Écoles d’Arts et Métiers, il va relever les défis du métropolitain parisien, dont la mise en service des premières lignes doit coïncider avec l’ouverture de l’Exposition universelle de 1900. Léon Chagnaud intervient pour construire la ligne n°3, et notamment la station Opéra où, dans un sol imbibé d’eau, il doit gérer la superposition de trois lignes ! Il relève le défi en utilisant de l’air comprimé et en injectant du ciment dans le sous-sol: les délais prévus par le cahier des charges seront respectés. Procédure exceptionnelle, un concours est lancé en 1904 pour la traversée du sous-sol de la Seine entre la place Saint-Michel et celle du Châtelet. L’ouvrage étant considéré comme le plus complexe du réseau, les plus grands spécialistes français sont sollicités. Impressionnant les membres du jury par ses méthodes et ses techniques, le gadzarts remporte brillamment le marché (voir encadré). Bien que très coûteux, l’ouvrage apparaît comme une grande réussite technique et marque la profession. Il apporte aussi la preuve de l’habileté de l’ingénieur qui dialogue beaucoup avec ses ouvriers, mais n’en est pas un moins un patron autoritaire aux colères redoutées – à faire face aux imprévus.
DES CAISSONS SOUS LA SEINE
Pour faire passer le métro sous la Seine, Chagnaud utilise plusieurs caissons traversant le fleuve. Doté d’une armature métallique recouverte de tôles, chacun est fermé à ses extrémités, puis immergé par l’injection de béton entre ses cloisons. Dès qu’il est posé sur le lit du fleuve, les ouvriers prennent place dans une chambre de travail aménagée dans la partie basse du caisson et alimentée à l’air comprimé. Le creusement du lit, combiné avec l’injection de béton dans les caissons, enfonce l’ensemble dans le sous-sol. Pour assurer la jonction entre les caissons et les souterrains bordant la Seine, Léon Chagnaud adapte le procédé de congélation utilisé dans le percement de puits de mines.
En 1906, l’entreprise Chagnaud participe au percement du tunnel du Loetschberg (14 605 m), pour désenclaver le canton suisse de Berne. Mais en février 1908, une avalanche détruit l’hôtel où séjournent des employés de l’entreprise et tue onze personnes. Quelques mois plus tard, une masse d’alluvions envahit brutalement le tunnel et cause la mort de 25 ouvriers. Endeuillé, le chantier sera arrêté 238 jours. Déjà préoccupé par les questions sociales, Léon Chagnaud met en oeuvre de nouvelles méthodes de creusement améliorant la sécurité de ses ouvriers. En mars 1911, les galeries française et suisse se rejoignent avec une précision millimétrique. Ce chantier n’est pas encore achevé que Chagnaud est sollicité pour creuser le canal souterrain de Rove, destiné au transport maritime, qui reliera le port de Marseille à l’étang de Berre: une longueur de 7 266 m pour une largeur inédite de 22 m. Les travaux débutent en 1911. Par manque de main d’œuvre durant le conflit de 14-18, Chagnaud développe l’utilisation d’engins mécaniques, d’autant que le volume de déblais extrait est estimé à 2,5 millions de m3. Le tunnel est inauguré en 1916, à l’achèvement du percement, puis une seconde fois après sa mise en eau, en 1927, en présence du président de la République Gaston Doumergue, Homme d’influence.
Au lendemain de la Grande Guerre, durant laquelle Léon Chagnaud a œuvré activement au sein d’un syndicat des entrepreneurs de travaux publics complètement désorganisé, le gadzarts réoriente son entreprise vers l’aménagement hydroélectrique avec la construction du barrage d’Éguzon, dans la Creuse (voir AMM de septembre 2001, p. 19). De 61 m de haut et 225 m de long, il reste le plus grand barrage français jusqu’en 1934. Achevé et mis en eau en 1926, il produit de l’électricité non seulement pour la région mais aussi pour… Paris.

Homme d’influence, Léon Chagnaud siège dans une quinzaine de conseils d’administration de sociétés (assurance, banque, électricité, mécanique, travaux publics…). Attentif aux bonnes relations entre dirigeants et salariés, il encourage le développement de l’intéressement déjà mis en place dans son propre établissement. Il préside le syndicat de la profession et fonde une école de travaux publics pour réinsérer les blessés et mutilés de guerre et pallier le manque de main d’œuvre après le conflit. Élu sénateur de la Creuse en 1921, puis président du conseil général de 1926 à1928, il s’efforce de moderniser et de désenclaver ce département auquel il reste très attaché. Il s’investit dans diverses commissions liées aux chemins de fer, aux transports ou encore à l’enseignement technique. Toutefois, battu aux élections de 1929, il met un terme à ses activités politiques, non sans amertume. Le parcours de cet officier de la Légion d’honneur aura néanmoins été ponctué de nombreux honneurs, dont le Grand prix de l’Exposition universelle de Paris en 1900. Léon Chagnaud décède le 31 juillet 1930 dans son château de Lasvy (Creuse), alors que son beau-frère Philippe Fougerolle, dirigeant la société du même nom, vient de disparaître un mois auparavant. Conformément à sa volonté, une partie de sa fortune est léguée au département de la Creuse et au canton de Bonnat. Bien qu’ayant repris la société dans un contexte économique de forte dépression, son fils Charles a réussi à poursuivre l’œuvre paternelle. Actuellement, Chagnaud Constructions participe à la réalisation de la deuxième ligne du métro toulousain, dont l’ouverture est prévue en 2007.
Frédéric Champlon (Ch 94)
René Couzinet

Saint Martin des Noyers (85) 1904 – Bagneux 1956
Aviateur et constructeur d’avions, dont ” l’Arc en ciel ”
avec lequel Mermoz traverse l’Atlantique-Sud
Né le 20-07-1904 à Saint-Martin-des-Noyers, décédé le 16-12-1956. “En octobre 1921, il entre à l’École d’Angers. Dès l’année suivante, à 18 ans, il dépose plusieurs brevets relatifs à l’aviation. Sorti second de sa promotion en juillet 1924, il poursuit ses études à l’École Supérieure d’Aéronautique puis est incorporé en novembre 1925 dans l’Armée de l’Air où il devient sous-lieutenant.
Un jeune inventeur
o Le 8 mai 1927, Nungesser et Coli décollent du Bourget pour traverser l’Atlantique. On ne les reverra plus. Treize jours plus tard, le 21 mai, au milieu d’une foule enthousiaste, l’officier de service René Couzinet très impressionné accueille Lindbergh qui vient de réussir la traversée New York-Paris. René Couzinet a un projet d’avion commercial transatlantique, un trimoteur, très en avance pour son époque. Son enthousiasme est communicatif et grâce à de nombreux appuis, il peut trois semaines plus tard commencer la construction de l’avion.
o Mars 1928

L’Arc-en-Ciel est présenté à la presse. C’est un avion complètement nouveau, aussi bien par sa silhouette que par ses aspects techniques : monoplan à ailes épaisses, trimoteur (les moteurs étant accessibles et réparables en vol), il a un rayon d’action de 10 000 Km, peut voler à 260 Km/heure..
Malgré un refus d’autorisation de vol pour non conformité aux normes officielles (100 Kg/m2 au lieu de 50), les essais se déroulent parfaitement. Pourtant en août, une manoeuvre trop risquée conduit à l’accident. Il faut reconstruire le prototype. Mais avec quels fonds ? La ville de Biarritz prend l’initiative de lancer une souscription, l’élan est donné, les soutiens affluent.
o 1929-1930 : Période très créatrice pour René Couzinet qui dépose brevet sur brevet. En février 1930, dans l’usine Letord de Meudon il construit trois trimoteurs postaux, l’Arc-en-Ciel, un hydroglisseur. Mais le 17 février le feu détruit tout.
II faut, à nouveau tout recommencer, les soutiens se manifestent une fois de plus. René Couzinet s’installe à l’île de la Jatte (Levallois-Perret), il construit un Couzinet postal (type 20) puis le Biarritz qui sort d’usine le 6 octobre 1931.
Vers le succès

Le BIARRITZ réussit la première liaison aérienne France/Nouvelle-Calédonie. Il décolle du Bourget le 6mars 1932, avec De Verneilh, pilote, Devé, navigateur et Munch, mécanicien. Istres, Tripoli, Le Caire, Bassorah, Guvadar, Karachi, Allahabad…les escales se succèdent, et le 5 avril, le Biarritz atterrit en Nouvelle-Calédonie, accueilli par 10 000 personnes enthousiastes.
Au début de 1932, le troisième arc-en-ciel sort d’usine. Une fois encore beaucoup d’innovations : 30 mètres d’envergure, trois moteurs de 650 CV chacun, un rayon d’action de 11 000 Km, vitesse maximum : 285 Km/heure.
L’avion intéresse l’Aéropostale pour l’Atlantique Sud. La concurrence est rude alors pour assurer la traversée régulière. En Amérique du Sud d’une part, entre le Sénégal et l’Europe d’autre part, des réseaux sont constitués. Mais pour traverser l’Atlantique Sud on doit encore utiliser le bateau. Quel moyen choisir pour mettre en place une liaison aérienne : le dirigeable ? l’hydravion ? l’avion ?. L’Aéropostale est séduite par les innovations de Couzinet. Elle lui fait rencontrer Mermoz. Les deux hommes sont habités de la même passion et deviennent aussitôt amis.
” Ces deux hommes avaient le même idéal, le même désintéressement, la même pureté, la même passion sacrée, ils se complétaient pour une grande tâche. Contre la paresse des bureaux, les combinaisons d’antichambre, contre la cupidité, i’envie et ia peur. Us formèrent attelage. Ce n’était pas trop de leurs deux génies con)ugués. Sans Couzinet, Mermoz eût erré longtemps dans les défifés du désespoir. Sans Mermoz, Couzinet n’eût pas vu l’Arc-en-Ciel triompher “. (Joseph Kessel : Mermoz, Gallimard, 1938).
Mais il faut, pour convaincre définitivement l’Aéropostale, effectuer un voyage de démonstration, relier Paris à Buenos-Aires. Malgré les obstacles et les difficultés créés par les services officiels, l’Arc-en-Ciel décolle du Bourget le 7 janvier 1933, direction Istres puis l’Afrique et le Brésil. (…) Escale à Port-Etienne (Mauritanie) puis à Saint-Louis du Sénégal. Et c’est la traversée de l’Atlantique. Entre Saint-Louis et Natal au Brésil : 3 173 Km parcourus en 14 h 32 de vol à 227 Km/heure de moyenne. A Natal, puis Rio, Buenos-ATres, Montevideo, l’accueil est triomphal. Les télégrammes de félicitations affluent, la presse salue l’événement. Réceptions, fêtes, banquets. C’est un exploit : Le Bourget/Buenos-Aires soit 13 045 Km parcourus en 57 h 56 minutes de vol, moyenne horaire 225 Km.
Le triomphe
Le 15 mai c’est le retour. L’Arc-en-Ciel décolle de Natal au Brésil, direction Dakar. Un journaliste est à bord, il fait le récit d’un vol qui se termine dans l’inquiétude. Environ 1 000 Km avant Dakar une fuite d’eau est décelée. Celle-ci s’aggrave rapidement, il faut stopper un moteur, l’avion descend, les températures de l’eau et de l’huile dépassent nettement la cote d’alerte. Il fait 45° à l’intérieur de l’avion, l’eau atteint 92° et l’huile 97°. Tous les navires sont en état d’alerte, les radios veillent, prêts à aider l’Arc-en-Ciel. L’angoisse règne. Vont-ils arriver ? Mermoz et l’équipage utilisent tous les moyens disponibles et à 20 h 10 l’Arc-en-Ciel se pose enfin à Dakar. Soulagement et joie de la population qui a suivi, avec anxiété, les dernières heures de vol.
Le 21 mai, l’arrivée au Bourget est triomphale, 15 000 personnes acclament Mermoz, Couzinet et tout l’équipage. L’Arc-en-Ciel est le premier avion à avoir réussi la double traversée de l’Atlantique Sud. C’est une victoire pleine de promesses pour l’aviation française.
Des temps difficiles

Pourtant il faut vite déchanter. L’Aéropostale, en butte à de nombreuses hostilités, est mise en liquidation puis absorbée par la nouvelle compagnie nationale : Air France. L’Arc-en-Ciel a beau effectuer avec succès plu- sieurs traversées de l’Atlantique Sud en 1934, aucune commande officielle ne se concrétise malgré les promesses. ”
attach:Images.Images/Couzinet_3.jpg
Depuis des années, écrit un journal de l’époque, on couvre de fleurs René Couzinet, on le porte aux nues dans les discours officiels et systématiquement on le torpille chaque fois qu’une commande doit lui être passée “. Et fin 1934, l’usine doit fermer ses portes faute de travail. René Couzinet pourtant ne se décourage pas, il prépare toujours de nouveaux projets comme celui du Guanabara. Dans un hangar aménagé au Bourget, il travaille dans des conditions difficiles, avec le soutien constant de Mermoz. Mais celui-ci disparaît avec “La Croix du Sud” le 7 décembre 1936. Couzinet crée alors une nouvelle société : la TRANSOCEANIC. En 1937, il construit un bi-moteur : le Couzinet 10.
En même temps, il se lance dans l’entretien et les réparations d’appareils militaires, et le ler octobre 1938, il obtient l’accord du ministère de la défense nationale pour installer une partie de ses ateliers près du terrain d’aviation en construction à La Roche- sur-Yon. Dans l’usine achevée en décembre 1939, on répare des “Potez 540”, des Caudron “Goéland”, et on prépare la construction d’avions de chasse Arsenal VG 90. A la fin de 1939 on travaille également à un prototype dans le garage Citroën de la place Napoléon. Au début de 1939 le constructeur reçoit une commande officielle pour un Couzinet B 4 (quadrimoteur de bombardement) qui pourra atteindre 510 Km/heure.
Puis la guerre est déclarée. Comme les commandes s’accélèrent, Couzinet envisage une nouvelle implantation à Barbâtre dans l’île de Noirmoutier. Mais tout cela vient trop tard. Après l’offensive allemande, les entreprises Couzinet se replient vers le sud. Et le 20 septembre 1940, René Couzinet gagne le Brésil. Directeur de la Fabrique Nationale d’Avions du Brésil à Lagoa Santa, il s’engage en septembre 1943 dans les Forces Françaises Libres.
1944, retour en France.
Malgré les difficultés administratives (pour récupérer l’usine de Levallois-Perret occupée par les allemands, réparer les ateliers de La Roche-sur-Yon en partie détruits par deux bombes en juin 1944), René Couzinet reste toujours aussi inventif.
Il crée des avions transatlantiques (un quadri- moteur postal par exemple), des hydravions, mais aussi des avions de tourisme (biplace, quadriplace…). Mais il s’investit alors surtout dans les hydroglisseurs.

Le 27 septembre 1946, dans la baie de Rio de Janeiro, il lance l’hydroglisseur 125. De retour en France il construit plusieurs modèles. Ainsi l’hydroglisseur type 60 mû par un petit réacteur Turbomeca présenté au salon de l’aviation en 1951 . C’est le premier “bateau à réaction” construit en France. Pourtant, malgré toutes ces innovations, les difficultés persistent. Il n’y a pas de commandes pour les hydroglisseurs.
Le 16 décembre 1956, épuisé par les difficultés qui s’accumulent, il disparaît.
La ville de la Roche-sur-Yon a consacré un très bel espace permanent à René Couzinet rendant ainsi hommage à cet homme d’exception.
Source : Document de la “Maison Renaissance” – La Roche-sur-Yon
> En savoir plus :
Couzinet (A) : Mermoz-Couzinet ou le rêve fracassé de l’Aéropostale. Paris . Picollec 1986 Fonds René Couzinet : Archives Municipales de La Roche-sur-Yon.
Sur le web :
http://petitefabrique.free.fr/couzi/index.html
http://aerostories.free.fr/couzinet/
Article extrait de Arts et Métiers Magazine Avril 2002
Louis Delage

Cognac 1874 – Le Pecq 1947
Constructeur d’automobiles de courses, puis de luxe
Président de la Société des Ingénieurs Arts et Métiers
Louis Delage sur Wikipédia

“Les Delage de l’entre-deux-guerres étaient des véhicules, certes de luxe, mais aussi sportifs et de compétition. Derrière ce prestige se cache un ingénieur hors du commun.
Louis Delage naît le 22 mars 1874 à Cognac (…). Reçu au concours d’entrée des Arts et Métiers d’Angers en 1890, il en sort en 1893 avec son titre d’ingénieur. Il effectue son service militaire en Algérie, où il reste jusqu’en 1895 pour travailler dans une entreprise de travaux publics de Bône. Revenu en France, il entre à la Compagnie des chemins de fer du Midi comme surveillant de travaux, et y demeure cinq ans. Mais la passion de l’automobile le taraude. Aussi s’installe-t-il en 1900 à Paris, créant un bureau d’études de voitures automobiles.
Ayant travaillé pour plusieurs constructeurs, dont Peugeot, il est embauché en 1903 dans cette jeune entreprise, comme chef des études et essais. C’est là qu’il rencontre l’ancien des Arts et Métiers Augustin Legros, qui arrive de chez Daimler, à Coventry. Deux ans plus tard, Delage démissionne de Peugeot en entraînant Legros, pour créer le 10 janvier 1905 la Société en commandite simple Delage et Cie, qu’ils installent au 62, rue Chaptal, à Levallois-Perret (…).
Dès la fin de l’année, ils peuvent exposer au 8e Salon de l’automobile, qui se tient au Grand Palais, deux châssis équipés d’un moteur de 4,5 ou 9 CV, au choix. Les clients – des médecins pour la plupart – recherchent plutôt une 6 CV ? Delage s’empresse de leur en proposer en modifiant ses prototypes, et les commandes affluent (…).
Cependant, le nouveau constructeur est persuadé que les épreuves sportives constituent la meilleure des publicités. Aussi, dès novembre 1906, il participe à la Coupe des voiturettes du journal “L’Auto” (…). Les ateliers sont transférés dans un local plus grand à Levallois en 1907, et, en 1908, l’usine emploie 116 personnes sur 4 000 m2. Pour participer au premier Grand Prix des voiturettes organisé par l’Automobile Club de France, Louis Delage confie la réalisation du moteur à Némorin Causan (Aix 1898). La voiture ainsi équipée enlève la première place, les autres Delage, équipées de moteurs De Dion, étant aussi bien placées. Pourtant, pour des raisons financières, seul le nom de De Dion est mentionné et retenu. (…)
L’usine est encore agrandie en 1909. C’est là que débutent les fabrications de moteurs Delage, à partir des plans de Maurice Ballot. C’est là aussi que Arthur Michelat (Angers 1899) commence sa carrière, en déchargeant Legros des études : il aura à son actif les châssis de course des années 1911-1914. Quant à Legros, il restera le bras droit de Delage jusqu’à la fin (…). Les succès s’enchaînent, même si les voitures Delage n’atteignent pas le grand public en raison de leur positionnement haut de gamme (tourisme ou sportives), qui les réserve à une clientèle plutôt fortunée. Une nouvelle usine devient nécessaire : elle est construite en 1912 à Courbevoie, près de l’île de La Jatte. Une Delage bat le record du monde de vitesse absolue en 1914, avec un moteur V12 de 10,7 litres créé par un ancien des Arts et Métiers, Planchon.
Mais arrive la Grande guerre. Après une période de mise en veilleuse de l’usine de Courbevoie, les fabrications d’obus, puis de véhicules de liaison pour l’armée (…). La fabrication de prototypes pour l’après-guerre se poursuit, cependant, dans un atelier séparé. Et, la paix retrouvée, la 1 500 cm3 Delage devient championne du monde en 1927, avec un moteur créé par Albert Lory (Angers 1911).
L’entreprise comprend, à son apogée en 1930, 3 000 personnes travaillant sur 51 000 m2. Malheureusement, cet âge d’or sera de courte durée. La pression de la concurrence – en particulier celle d’André Citroën – devient très âpre. La grande crise de 1929 a laissé de lourdes séquelles. Et, en raison d’une priorité donnée aux solutions techniques sur les investissements commerciaux, probablement aussi parce que Louis Delage, vieillissant, est absorbé par de nombreuses préoccupations personnelles, la société ne prend pas le virage de la très grande série et décline.
 Delage Watney Le Mans 1945
Delage Watney Le Mans 1945 Le personnel est progressivement licencié, et un autre ancien des Arts et Métiers, Émile Delahaye (Angers 1889), rachète les actions en 1935. Louis Delage connaît dès lors une vie de retraité. Il s’éteint en 1947, et est inhumé au cimetière du Pecq. Des voitures sous son nom, mais pourvues de mécaniques Delahaye, continueront toutefois à être commercialisées : la dernière, équipée d’une carrosserie Chaptron, sortira en 1952.
Grâce à sa passion pour la technique automobile, ce grand entrepreneur-constructeur a apporté une grande impulsion au développement technologique, aussi bien dans le dessin des châssis que dans la conception des moteurs (le moteur à compresseur par exemple). Mais il s’est trouvé disponible aussi pour d’autres causes. C’est durant son mandat de président de la Société des anciens élèves des Arts et Métiers, entre 1924 et 1927, que sera acheté l’hôtel d’Iéna, inauguré officiellement en 1926 en présence de Gaston Doumergue, président de la République.”
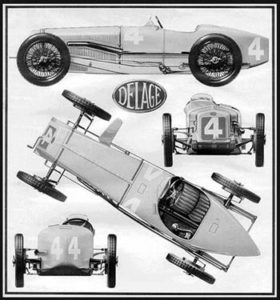
Complément dans AHCLAM
Edmond De Andrea, Ingénieur A&M (Ai 45)
Extrait de Arts et Métiers Magazine – Novembre/Décembre 2001.
Nicolas Esquillan

Fontainebleau 1902 – Paris 1989
Concepteur et constructeur d’ouvrages d’art
dont le CNIT à La Défense
Prix Nessim Habif en 1971
Nicolas Esquillan sur Wikipédia
“Nicolas Esquillan, dès son premier grand ouvrage, le pont de la Roche-Guyon, a manifesté son talent particulier à réaliser des structures aux lignes très pures, irradiant par elles-mêmes, sans le moindre ornement, leur propre beauté esthétique (…)”
Nicolas Esquillan est né le 27 août 1902 à Fontainebleau. Son père, Hugues Esquillan, qui avait appris la menuiserie et l’ébénisterie et entrepris son tour de France pour devenir compagnon, s’arrêta à Fontainebleau et ouvrit un atelier de fabrication de voitures à chevaux, puis automobiles (…). Grâce à une bourse d’Etat, il entra aux Arts-et-Métiers à Châlons en 1919 et en sortit 4e de sa promotion avec une médaille d’argent. Il resta proche du milieu Gadzarts, dans sa vie professionnelle et dans sa vie privée.
Après son service militaire qu’il termina comme sous-lieutenant artilleur, il était indécis sur son orientation. Le hasard lui fit rencontrer un Gadzarts, ami de Simon Boussiron (Aix 1888), lequel avait orienté sa société vers le béton armé et avait écrit un des premiers ouvrages théoriques sur le sujet. La rencontre entre Boussiron et Esquillan fut concluante et ce dernier rejoignit la société en 1923. Il devait y consacrer sa vie.
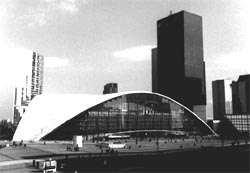 [ Le CNIT de La Défense ]
[ Le CNIT de La Défense ]
Il s’intégra très rapidement dans ce que les collaborateurs de l’entreprise appelaient ” la famille “. Les relations y étaient en effet très étroites, le climat de confiance exceptionnel et comme le dit son collaborateur de toujours Jean François (Ch 1938) : ” Comme patron , Nicolas Esquillan, comme dans toute l’entreprise, faisait confiance. Cette confiance régnait du haut en bas des responsabilités : Boussiron, Fougerolle, Esquillan, François. ” Il est certain que dans un climat comme celui-là, les hommes se sentent à l’aise, prêts à examiner sans crainte les possibilités innovatrices et aussi à prendre des risques. Il est donné comme exemple les voûtes des hangars de Marignane : 2 fois 4200T coulées au sol et élevées à 19m de hauteur en trois semaines. Il faut se sentir sûr de soi mais surtout épaulé dans un climat favorable pour faire ce pari en 1950. Ce climat a aussi favorisé le travail en équipe. Ses prédécesseurs avaient ouvert la voie (Simon Boussiron, Roger Vallette) et leurs successeurs.
Si le contexte de l’entreprise est une condition favorable, elle ne produit pas le talent et ne remplace pas le travail. Le talent, Nicolas Esquillan l’avait par sa curiosité toujours en éveil, abordant les nouveaux sujets en apprenant d’abord, puis en essayant de découvrir le pourquoi et le comment des choses ; il l’avait aussi par sa sensibilité à la beauté , celle des choses réalisées admirées par tous parce qu’on n’imaginait pas qu’elles auraient pu être différentes. Il disait toujours que “plus on fait simple, plus on fait beau et plus on fait beau, plus on fait grand (…)”.
On peut imaginer la quantité de travail que les études, puis toutes les réalisations, ont demandé. Plusieurs exemples ont été donnés : lorsqu’il eut l’intuition que la méthode de calcul utilisée dans l’étude des ouvrages en béton, simpliste car basée sur l’utilisation de coefficients de sécurité importants, était un handicap pour progresser en allégeant, il se replongea dans les mathématiques (…).
Parmi les réalisations de Nicolas Esquillan, six ont été des records du monde. Il faut citer en particulier le CNIT à La Défense record mondial des ouvrages en coque mince avec 206 m de portée et où une plaque a été scellée sur le parvis par ses amis le 13/10/1993. Pour certaines d’entre elles, il a assumé aussi le rôle d’architecte, par exemple pour les pylônes de Tancarville. Il disait : ” Dans un esprit de synthèse, je me suis efforcé de combiner, dans la conception, l’art de l’architecte, la science de l’ingénieur, le métier de constructeur “.
 [Le Pont de Tancarville]
[Le Pont de Tancarville]
Son parcours lui a valu de très nombreuses distinctions, tant françaises qu’internationales . Ces distinctions ont été décernées, soit pour des réalisations remarquables, soit pour la qualité des études théoriques, soit pour son engagement européen en vue d’arriver à une réglementation générale unique (voir encadré).
Ses publications sont nombreuses, une centaine entre 1935 et 1972, articles, rapports ou conférences. Son action ayant été prépondérante dans les deux domaines que sont l’action de la neige et du vent sur les constructions et la conception et le calcul des structures (…). Toutes ces activités extérieures pourraient faire penser à une personnalité recherchant les honneurs et la médiatisation. Ses proches comme ses amis le décrivent au contraire comme quelqu’un d’assez discret, ni mesquin, ni carriériste. Très accessible, il écoutait et savait se mettre à la portée des gens : ” Il n’était pas fier ” disaient certains. Il était conscient certainement de sa valeur en tant qu’ingénieur mais le laissait peu voir. Sur sa tombe, et à sa demande, il n’y a qu’une seule inscription : ” Ingénieur. ” (…). On peut résumer ce rapide portrait de Nicolas Esquillan par cinq mots : réserve, rigueur, risque, sens du beau, travail. Il est décédé le 21 janvier 1989 à paris et inhumé au cimetière parisien des Batignolles.
Principales réalisations:
- Pont de La Roche-Guyon (1935), record du monde, détruit en 1940
- Pont de La Coudette, record du monde (1943)
- Viaduc de Chasse-sur-Rhône, record du monde (1950)
- Hangar de Marignane, record du monde (1951)
- Pylônes du pont de Tancarville, record du monde (1957)
- CNIT à La Défense, record du monde(1958)
- Palais des expositions de Turin (1961)
- Stade Olympique de Grenoble (1968)
Quelques Distinctions:
- Officier de la Légion d’Honneur (1959)
- Grande médaille d’argent de l’Académie d’architecture (1971)
- Prix Nessim Habif (1972)
- Médaille de Vermeil Gueritte en Grande Bretagne (1958)
- Deutscher Beton Verein : médaille Emil-Mörsch (1969)
- American Concrete Institute : Alfred E. Lindau Award (1966)
- Médaille Eugène Freyssinet au 6e Congrès Fédération Intern. Précontrainte

[Plaque commémorative situé au CNIT de La Défense]
Edmond De Andrea, Ingénieur A&M (Ai 45)
Extrait d’ Arts et Métiers Magazine – Février 2002.
Eugène Houdry

Promotion Châlons 1908
Domont (78) 1892 – Pennsylvanie 1962
Inventeur du cracking catalytique
National Inventors Hall of Fame (Ohio)
Eugène Houdry naquit le 18 avril 1892 à Domont, dans l’Oise. Élève du lycée Turgot de Paris, il prépare et réussit le concours des Arts et Métiers en 1908. Au cours de sa scolarité à l’école de Châlons, Houdry s’illustre brillamment, tant par ses résultats scolaires que sportifs. Major de sa promotion, il est en effet l’heureux capitaine d’une équipe de Soccer victorieuse au Championnat de France. A sa sortie de l’école en 1911, il rejoint l’entreprise familiale spécialisée en serrurerie et charpente métallique.
Quand survient la mobilisation de 1914, le jeune Houdry est incorporé dans l’artillerie et plus particulièrement dans les chars d’assaut. Investit du grade de lieutenant, Houdry est ainsi le témoin actif des premières batailles de Tank de l’histoire. Grièvement blessé à Juvincourt en Lorraine, il reçoit la croix de guerre. A la signature de l’armistice, Houdry retrouve l’entreprise familiale et n’ayant rien perdu de son extraordinaire vitalité, il se passionne alors pour les courses automobiles.
Un carburant à base de lignite
A partir de 1922, son insatiable curiosité, le conduit à étudier un procédé de fabrication d’essence à partir de lignite. Convaincu de l’aboutissement heureux de ses recherches, Houdry crée en 1923 une société d’étude et de développement pour la production de carburant à base de lignite. Se consacrant exclusivement à ces recherches ; celles-ci aboutissent en 1927. Reste désormais à tester l’industrialisation du procédé. La faisabilité technique est démontrée en 1929 à partir d’une installation industrielle construite à cet effet. Malheureusement la rentabilité du projet s’avère négative. Houdry sollicite une aide auprès de l’office National des Combustibles Liquides; cette requête restant vaine, l’usine doit fermer en 1930.
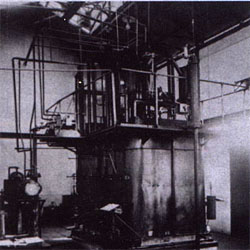
Outre l’étude d’essence synthétique à base de lignite, Houdry multiplie les expérimentations de traitements catalytiques sur des pétroles brutes. On s’aperçoit que le carburant traité supprime le cliquetis des moteurs … le cracking catalytique inventé par Houdry réduit de façon très significative les propriétés détonantes de l’essence. Plusieurs compagnies montrent un intérêt pour le cracking catalytique, mais ces contacts se limitent à la visite des laboratoires Houdry. Enfin, en juillet 1930, la ‘Compagnie des Produits Chimiques et Raffinerie de Berre’ commande la construction d’une unité pilote d’une capacité de production de 10 t/j.
La mise en application de cette commande est supplantée par une autre proposition. En effet, en octobre de la même année, la Vacuum Oil Company achète une licence du cracking catalytique. Accompagné d’un ingénieur et d’un chef d’équipe, Houdry rejoint les Etats-Unis. La petite équipe française s’installe dans les laboratoires de la Vacuum Oil Cy à Paulsboro (New-Jersey).
L’année 1931 est marquée par la création de la ‘Houdry Process Corporation’ (H.P.C) et la collaboration avec un autre partenaire la Sun Oil Company.
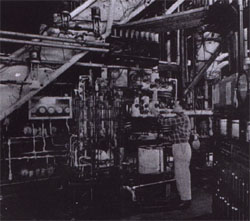
Fort de ses soutiens, Houdry peut engager de nouvelles recherches, et une unité pilote est construite sur le site de la Sun Oil Company à Paulsboro. Les résultats des diverses expérimentations sont concluants pour lancer le déploiement du procédé. En 1939, on dénombre 15 unités de cracking catalytique en marche ou à l’état de construction.
A l’aube du second conflit mondial, les autorités françaises se préoccupent de l’approvisionnement en essence pour l’aviation. Houdry est sollicité afin de présenter les bénéfices de son procédé auprès des représentants de l’industrie du pétrole en France. Incrédulité ou manque de lucidité ? Seule la ‘Compagnie des Produits Chimiques et Raffinerie de Berre’ confirme son intérêt pour le procédé pourtant éprouvé outre atlantique.
Reconnaissant l’action d’Houdry en faveur de l’industrie Pétrolière, le gouvernement Français lui décerne la Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur. Les Etats-Unis ne tardent pas non plus à reconnaître sa valeur, et il reçoit ainsi plusieurs distinctions honorifiques.
France For Ever
Alors que la France vient de sombrer dans la débâcle, Houdry n’accepte pas la résignation à la défaite; il répond à l’Appel du général de Gaulle par la création du comité ‘France For Ever’. Face à la propagande du gouvernement de Vichy, cette association devait donner une autre image de la France : celle des hommes épris de Liberté. En quelques mois, on dénombre plus de 15.000 adhérents. En mai 1941, Houdry est déchu de la nationalité française, il devient alors citoyen américain.
L’HPC dans la guerre
Les licences Houdry sont essentiellement utilisées pour la fabrication d’essence d’avion. Ainsi, durant la Seconde guerre mondiale, jusqu’à 67 usines utilisent le procédé et, près des deux tiers de l’essence de l’aviation de guerre sortiront de ces centres de fabrication. Conséquence directe de l’attaque de Pearl Harbor, les approvisionnements en caoutchouc naturel sont interrompus. Sollicités par le gouvernement Américain, les laboratoires Houdry mettent au point un procédé de transformation du butane en butadiène produit de base du caoutchouc synthétique, et ce dans un délais très court, au-delà des attentes des demandeurs. En 1943, les travaux d’Eugène Houdry sont salués par le président de la Sun Oil Cie : ” Sans le procédé de cracking catalytique, il eut été impossible à l’industrie du pétrole de répondre aux exigences de notre aviation, aussi aucun homme n’a apporté – peut-on dire – une contribution aussi décisive à notre effort de guerre que son inventeur “.
Une grande figure de la chimie industrielle et homme d’idées
A partir de 1948, Houdry se lance personnellement dans de nouvelles recherches, notamment pour palier au problème de la pollution de l’air. Il noue également des contacts avec des biologistes et crée un groupe de recherches dédié à l’étude des phénomènes chimiques liés à l’apparition du cancer. Durant les dernières années de sa vie Houdry consacre ainsi son ‘génie inventif’ à des préoccupations humaines et industrielles. En 1962, il dépose le brevet du pot catalytique pour les automobiles. Doué d’une formidable intuition, Houdry ne serait-il pas un précurseur de ce qui, désormais est plus communément appelé développement durable ? Dans ses allocutions publiques, Houdry célèbre la liberté comme un vecteur de l’harmonie sociale : ainsi ‘liberté de travail et liberté d’entreprise’ doivent conduire au plein ‘épanouissement de création’.
Un grand français
Lorsque que le 18 juillet 1962, Houdry vient à disparaître, ses amis sont d’autant plus affectés qu’ils gardent de lui l’image d’un homme ‘à l’énergie infatigable’. Depuis 1971, la société américaine ‘NACS’ (North American Catalysis Society) décerne un prix Houdry afin d’encourager et de promouvoir les traitements et applications catalytiques. Plus récemment, la mémoire d’Houdry fût honorée par la municipalité de Domont par la création d’une rue au nom de l’inventeur.
Bien que naturalisé Américain, Houdry restera un Grand français. Il exprima sa reconnaissance à l’égard de ses maîtres français, dont la qualité de l’enseignement est reconnue outre-atlantique. Le succès de ses multiples entreprises, son enthousiasme communicatif et sa grande générosité font de lui, véritablement un exemple.
Frédéric Champlon (Ch 94)
Avec l’aimable participation de la municipalité de Domont
Marius Lavet

Clermont-Ferrand 1894 – Paris 1980
Père du micro-moteur pas à pas, inventeur de la montre à quartz
Prix Nessim Habif 1976
Donateur du prix de l’ingénieur-inventeur Chéreau-Lavet

Inventeur de génie du micromoteur pas à pas, Marius Lavet a permis une évolution considérable de l’industrie horlogère européenne.
La famille Lavet est originaire d’Auvergne et, plus précisément, du Puy-de-Dôme. Le grand-père maternel de Marius Lavet était sabotier, son grand-père paternel agriculteur, et son père aubergiste à Clermont. C’est dans cette ville qu’il naît au domicile de ses parents, 1, rue Blanzat. Il est déclaré le 8 février 1894, né le 6 ou le 7 février (l’état civil porte les deux dates). Sa mère, Jeanne-Marie Fafournoux, était elle aussi native du Puy-de-Dôme. Il épousera Arnolde Deisenburg le 7 février 1934, mais on ne lui connaît ni descendants, ni collatéraux. Après des études à Clermont, il est admis aux Arts et Métiers de Cluny en 1910 et en sort parmi les premiers (médaille d’argent). Il poursuit sa formation à Supélec en 1914. Mobilisé, il fait la guerre de 14-18 et reçoit la Croix de guerre avec citation. Dès sa démobilisation, ingénieur à la Compagnie des appareils horoélectriques, il dépose, le 23 décembre 1918, un premier brevet au nom de Mme veuve Moulin et de M. Favre Bulle, dont il est le collaborateur. Ce brevet décrit une variante du système Brillié d’entretien du mouvement du balancier dans les pendules. Il est à l’origine de la pendulette électrique indépendante, la “Bulle Clock”, qui devait connaître un grand succès et être fabriquée jusqu’en 1970.
Marius Lavet entre en 1923 à la société Hatot, où il est chargé de créer un département d’horlogerie électrique dont l’objectif est d’exploiter des “systèmes de distribution de l’heure et modèles originaux d’instruments horaires” qui seront vendus sous la marque ATO. Il fera toute sa carrière dans cette société, malgré certaines difficultés avec elle qui conduiront à un procès gagné par le gadzarts.
Si Marius Lavet est principalement connu dans l’horlogerie, ses travaux, depuis l’origine, concernent plus généralement l’électromagnétisme dont elle est une application. Il a pris à son nom, pendant qu’il travaillait pour la société Hatot, une cinquantaine de brevets (en comptant les additions) consacrés essentiellement à l’horlogerie. À partir de sa retraite en 1962, et jusqu’en 1977, Marius Lavet reste un inventeur indépendant. Il se consacre aux petits appareils magnéto-électriques, en particulier aux petits moteurs à courant continu sans collecteur. En 1968, il crée même avec l’ingénieur général de Valroger le laboratoire de recherche Laborem.
La méthode de travail de Marius Lavet, telle qu’elle a été décrite par son conseiller Louis Chéreau, est intéressante : dans un premier temps, il agit comme “guetteur”, détecte, parmi les publications, une nouveauté et en recherche des applications dans son domaine d’intérêt. Dans un deuxième temps, il prend garde de ne pas se perdre dans des perfectionnements successifs, mais recherche et fait breveter d’autres applications nouvelles. Sa démarche s’illustre par deux exemples: l’utilisation du transistor en horlogerie et le petit moteur pas à pas bipolaire. En mars 1948, il prend le brevet n° 986536 sur les horloges électriques. Or, au mois de juin suivant, les Bell Laboratories annoncent une importante découverte, sous la forme d’un petit appareil, de la taille d’un ongle, destiné à remplacer les lampes triodes ou autres et pouvant servir d’interrupteur et d’amplificateur : le transistor. Ce mécanisme possède de nombreux avantages, tels que son faible volume, sa faible consommation et la suppression des contacts mécaniques dans les systèmes électriques d’entretien du mouvement qu’il rend possible. Marius Lavet entrevoit tout de suite, malgré le scepticisme ambiant, les avantages à l’utiliser en horlogerie. Dès juillet 1949, il dépose un additif (n° 60520) à son brevet. L’application viendra en septembre 1953 par un brevet n°1090564 pris pour la France, et par 16 autres brevets pris dans 9 pays, dont les États-Unis et l’Allemagne. Ce qui lui permettra simultanément de faire opposition à un brevet pris par des Japonais. Outre l’application à l’horlogerie traditionnelle, une vingtaine de brevets ultérieurs concernent divers mécanismes d’horlogerie à transistor. Dès novembre 1953, fidèle à son désir de faire partager cette avancée technologique, il publie un article dans les “Annales de chronométrie”.
L’évolution du moteur bipolaire à impulsions électriques, quant à lui, fait l’objet du brevet n° 971418 pris en mai 1940, déposé par la société Hatot, mais dont la paternité sera reconnue à Marius Lavet en mai 1963. Ce premier moteur préfigure le moteur pas à pas, dit “moteur Lavet”, ainsi que son utilisation par la suite en horlogerie fine, voire en bijouterie, avec l’emploi rapide des nouveaux matériaux magnétiques comme le platinecobalt. Ce moteur pas à pas utilisé en horlogerie permettra à l’industrie horlogère européenne, avec les montres électroniques à quartz et à aiguilles, de lutter contre l’invasion japonaise des montres à affichage numérique, et de ne pas sombrer.
Les travaux de l’ingénieur ne se limitent pas à l’horlogerie. Dans le cadre de ses recherches sur les petits moteurs, le développement des moteurs à courant continu sans collecteur le fait reconnaître universellement dans l’industrie aéronautique. Ce moteur “brushless” est une révolution en électrotechnique, car il arrive après un siècle de quasi-stagnation des moteurs électriques. C’est, là encore, une application du transistor, de ses dérivés et des nouveaux matériaux magnétiques. Une série de brevets est prise entre 1968 et 1977 aux noms de Lavet – de Valroger. Le principe de ce moteur est simple: un rotor aimanté, et un stator bobiné alimenté par l’intermédiaire de plusieurs transistors jouant le rôle de contacteurs successifs lors de la rotation. Ce moteur peut être plat ou cylindrique. La suppression du collecteur et la multiplication du nombre des transistors permet d’adapter les utilisations aux différents besoins. C’est ainsi que l’on a pu atteindre des vitesses de rotation de 100 000 tr/min et des puissances massiques voisines du kilowatt par kilogramme.
Outre les brevets, additions et enveloppes Soleau, Marius Lavet fait environ 70 communications dans les “Annales françaises de la chronométrie” ou dans les congrès internationaux de chronométrie, et publie plus d’une quarantaine de textes divers. Il est aussi l’auteur de sept ouvrages qu’il rédige entre 1949 et 1971, allant des “Horloges de commutation remontées électriquement ” aux “Moteurs à courant continu à commutation électronique “. Deux de ces ouvrages, “Mécanismes électromagnétiques “, en trois volumes, et “Relais”, écrits en 1962, servent de support aux cours qu’il dispense à l’École nationale supérieure de l’aéronautique entre 1952 et 1970. L’excellence de ces enseignements lui vaut la Légion d’honneur. On sait peu de choses de l’homme; il est décrit comme peu expansif, discret, “un inventeur du XIXe égaré au XXe”, travaillant en solitaire, pas très intégré à la vie civile, un peu “vieille France”. Il parle, en toutes occasions, de ce qu’il fait, mais pas de lui-même. Sa politique de dépôt de brevets, la défense de ses droits et les conseils avisés de Louis Chéreau, lui valent, tout en vivant très simplement, de constituer un patrimoine significatif, et lui permettent de susciter ou de soutenir une politique d’aide à des inventeurs. C’est dans ce cadre que, par testament daté du 19 juin 1977, un fonds autonome Chéreau-Lavet est institué et rattaché à la Fondation Arts et Métiers, lequel est administré par un conseil d’administration dont Pierre Bézier (Pa. 27) est le premier président. Le 21 novembre 1979, lors d’un conseil auquel participe Marius Lavet, un premier diplôme de lauréat est décerné, accompagné de la remise d’une montre et d’un chèque. Malheureusement, une action en justice interrompt la remise du prix. Ce n’est qu’en 2001 qu’il est officiellement attribué pour la première fois sous l’égide de la Fondation de France, grâce à l’organisation de l’association Marius Lavet fondée par la Fondation Arts et Métiers, le Conseil national des ingénieurs et scientifiques de France, le cabinet Pierre Breesé (depuis cette année, l’Académie des technologies a rejoint les fondateurs). La cérémonie se tient traditionnellement au Sénat. Marius Lavet est aussi lauréat de l’Académie des sciences (prix Henry Wilde), de la Société française de microtechniques et de chronométrie de France (médaille Jules Haag) et de la Société allemande de chronométrie (médaille Matthäus Hahn). Il est décédé le 14 février 1980 à Paris et a été incinéré.
Edmond De Andrea (Ai 45)
Paul-Louis Merlin

Grenoble 1882 – 1973

Constructeur de matériel électrique
Fondateur avec Gaston Gerin (Aix 1906)des Ets Merlin-Gerin à Grenoble,
dont il fut longtemps président, devenus Schneider-Electric
Entre chance, travail et intuition, le cofondateur de Merlin-Gerin s’est forgé un destin d’entrepreneur hors pair.
Paul-Louis Merlin naît le 27 novembre 1882, place Saint André, à Grenoble. Il est placé très tôt en nourrice au pied du Belledonne, à Theys; c’est de là peut-être qu’il tiendra sa passion pour la montagne. Son père, Jean Merlin, coiffeur connu de l’avenue de la Gare, et sa mère née Marguerite Sonzini, ont eu aussi deux filles, qui seront couturières. Paul-Louis est un enfant turbulent, amateur de plaies et bosses, mais dont l’intelligence est remarquée par son instituteur qui propose à ses parents d’en faire… un instituteur. Le président de la Chambre de commerce, client de son père, lui conseille plutôt les Arts et Métiers.
L’adolescent intègre l’École d’Aix en 1898, après le collège Lesdiguières. Il est boursier, moitié de l’État, moitié du département. Après son diplôme et son service militaire, où il suit le peloton d’officier, et deux courtes expériences professionnelles, il entre aux établissements Maljournal et Bourron, à Lyon. Dans cette entreprise de matériel électrique, il devient directeur des Fabrications en 1914. Entre-temps, il a épousé en 1906 Camille Barnaud, fille d’un brossier et d’une frangeuse. Le couple aura deux fils, Paul et Henri, et une fille décédée en bas âge. L’ingénieur répétera encore, lors de ses quatre-vingts ans : “Une de mes chances, c’est d’avoir épousé Madame Merlin.”
Mobilisé en 1914, il n’est pas envoyé au front, mais affecté à la formation des officiers, puis aux fabrications d’armement. Il retourne en 1919 chez Maljournal et Bourron, où il rencontre Gaston Gerin (Ai. 1906 et IEG), qui dirige le bureau d’études. Les deux compères ne se sentent pas à l’aise dans cette société et, semble-t-il à l’initiative de Paul-Louis Merlin, décident de créer leur propre affaire. Compte tenu de leur expérience et du climat industriel de l’époque, où l’électricité entre en force, ce sera principalement une entreprise de matériel électrique : après la guerre de 14, “le matériel électrique, c’est l’avenir”, déclare Paul-Louis Merlin.
Toutefois, si les deux associés ont la compétence et l’envie de créer, ils disposent de très peu de moyens… Paul-Louis Merlin se souvient alors d’un capitaine qu’il a connu pendant la guerre, Hippolyte Bouchayer, qui règne sur un groupe industriel important. Lors d’une entrevue, il lui demande deux choses : lui louer l’usine de son groupe Fibrecol, située à Grenoble et à moitié désaffectée, et lui prêter 25 000 F. Non seulement ses deux demandes sont satisfaites, mais il obtient en plus la clientèle de toutes les usines du groupe d’Hippolyte Bouchayer pour le matériel électrique! Les deux créateurs d’entreprise trouvent un second soutien en la personne d’Henri Joucla (Ai. 1902), qui leur prête 25 000 francs à chacun, à condition que cette somme soit incorporée au capital. Tout cela leur permet, moyennant quelques ajouts personnels et familiaux, de réunir 100 000 francs. L’usine Merlin-Gerin peut ouvrir le 1er janvier 1920, avec 27 personnes ; elle en comptera 8 000 en 1970. Au début, les températures intérieures des locaux sont négatives en hiver et torrides en été ; mais le patron est toujours là et met la main à la pâte.
L’entreprise se caractérise, au départ, par l’absence de produit propre, la priorité étant de détecter les besoins des clients et de trouver le moyen de les satisfaire en achetant ou fabriquant les produits. Connaissant bien la fabrication, Paul-Louis Merlin exige une qualité irréprochable qui fera très rapidement la notoriété de la jeune société, laquelle prospère très vite. Mais cette expansion doit être financée. Et c’est là une des caractéristiques rares de Merlin-Gerin : les fondateurs, pragmatiques, ne cherchent pas à conserver le contrôle financier ; l’essentiel n’est pas là, mais dans la réussite de l’entreprise. Cette politique se retrouvera tout au long de la vie de la société.
On ne peut dire quelle a été la part de chacun des associés dans l’élaboration de cette stratégie mais, au vu de ce qui s’est passé par la suite, il est hautement probable que Paul-Louis Merlin était le fonceur impatient et charismatique, le raisonnable Gaston Gerin gardant le rôle de l’organisateur. C’est ce dernier, par exemple, qui met en place le très efficace réseau d’agents commerciaux. Jusqu’à la fin des années 1930, sont surtout fournis des produits haute tension (HT) demandés par la Marine, les mines et l’industrie lourde, c’est-à-dire des matériels blindés, antidéflagrants ou anti-grisouteux (cuirassés Richelieu et Jean Bart, mines d’Anzin, raffineries Standard Oil). C’est pendant cette période que sont créés les laboratoires d’essais qui conforteront la réputation de qualité des produits Merlin-Gerin, ainsi qu’un bureau d’études pour élaborer les produits demandés en adaptant les matériels de sociétés spécialisées obtenus par achat de licences.
Gaston Gerin décède en 1943. Paul-Louis Merlin se retrouve seul aux commandes et peut donner sa pleine mesure à son tempérament audacieux. Mais son existence est simple, familiale ; il va une fois par semaine dîner chez les fermiers installés dans sa ferme. De même que son épouse, il fait preuve d’un total désintérêt pour le luxe, sans aucun désir de paraître. Pour autant, il entretient les meilleurs contacts avec les hommes politiques, et sait les faire valoir quand il faut défendre l’industrie et… Grenoble. Vincent Auriol, à sa demande, patronnera l’Association des amis de l’université, et De Gaulle viendra visiter sa société en 1960. Car la fin de la guerre de 1939-1945, la reconstruction et le développement du pays ont apporté de profonds changements dans l’entreprise, qui s’étend de plus en plus. Si la HT est toujours très présente, la BT (basse tension) prend une place importante. En 1949, un brevet a été déposé pour une belle innovation marquante : le disjoncteur pneumatique avec soufflage de l’arc à sec, le Solenarc. Si cette réelle innovation pour la HT assure une partie du développement de Merlin-Gerin, elle est complétée pour la BT par les postes de transformation ruraux et les postes sur pylônes. De sorte que, entre 1950 et 1970, le chiffre d’affaires se trouve multiplié par 10, le bénéfice net par 20, les effectifs par 2, le capital social par 6 !
Pour assurer cette expansion, les augmentations de capital se sont succédé, soit directement, soit par des prises de participation de groupes industriels amis, par exemple SW (Schneider Westinghouse) et Bouchayer. Ces alliés aideront à contrer l’OPA de la CGE (Compagnie générale d’électricité) en 1937. Si le succès est pour une grande part lié à la qualité de fabrication, donc aux investissements consentis, il est aussi largement imputable à la formation des salariés : organisée dès 1923 sous forme de cours, puis par une école d’apprentissage en 1929, elle culmine avec la méthode de formation Merlin-Gerin. La promotion interne par cette voie est une caractéristique de l’esprit “Merger”. Aussi, dans cette entreprise à la culture plutôt paternaliste au départ, la modification des structures en centres de profits ne sera guère facile. D’où peut-être les quelques grèves assez dures qui s’y dérouleront, notamment celle de 1979.
En 1965, Paul-Louis Merlin cède son fauteuil de président à son fils aîné Paul ; lui-même, restant administrateur, continue à multiplier ses activités. Pour sa réputation de réalisateur et sa capacité de mobilisation, jointes à un grand charisme, on fait souvent appel à lui. Deux exemples: la création de la Promotion supérieure du travail à Grenoble, expérience pilote d’ascension sociale étendue en 1959 à toute la France ; et le sauvetage du couvent Sainte-Marie d’en-Haut, à Grenoble, qu’un élu traitait de “misérable bâtisse” mais qui a été heureusement transformé en Musée dauphinois. Au service de ces réalisations, Paul-Louis Merlin met avec enthousiasme et disponibilité sa force de conviction et, surtout, sa formidable confiance en lui. À 78 ans, ce commandeur de la Légion d’honneur donne encore des conférences en Sorbonne sur le “décloisonnement”. Il décède le 2 mai 1973 et est inhumé à Grenoble. Merlin-Gerin est aujourd’hui incorporé dans le Groupe Schneider Electric avec sa propre marque, au même titre que Télémécanique et Square D (Canada).
Edmond De Andréa (Ai 45)
Avec l’aide de Michel Cabaret (Ch 52)
Marcel Môme

Clermont Ferrand 1899 – Paris 1962

Fondateur et Président de la SAGEM
Fondateur de la société d’électricité et de mécanique Sagem, Marcel Môme a assuré son développement malgré les crises ou la guerre.
Les années qui ont précédé la Première Guerre mondiale sont connues pour avoir été une période de légèreté et d’amusement. Mais derrière ces paillettes, beaucoup de familles de condition très modeste rêvaient de voir leurs enfants prometteurs s’élever dans l’échelle sociale par la voie royale de l’enseignement technique. Ce fut le cas de Marcel Môme. Il naît le 11 janvier 1899 à Clermont-Ferrand, de Pierre Môme et Marie Dufour. Sa mère est couturière et son père, employé à l’octroi – un droit perçu sur certaines denrées lors de leur entrée en ville, disparu en 1948. Il a une sœur aînée.
Pierrette Faurre, fille de Marcel Môme, décrit ses grands-parents comme des personnes posées et réfléchies, très soucieuses des études qu’elles respectaient. Le jeune Marcel suit un enseignement technique qui conduit, à l’époque, à un emploi d’ouvrier, d’agent de maîtrise ou, pour les meilleurs, au titre d’ingénieur. En 1917, il intègre les Arts et Métiers à Cluny, mais la guerre interrompt ses études, sa classe d’âge étant mobilisée. À son retour, il obtient en 1921 un diplôme d’ingénieur avec de nombreux camarades démobilisés des différentes classes de guerre.
Il est embauché comme ajusteur – ce qui est fréquent – chez Michelin, puis à la Compagnie des Signaux et entreprises électriques.
En 1925, il “monte à Paris” et la conjoncture étant très bonne, il fonde avec l’aide de quelques amis la Sagem, Société d’applications générales d’électricité et de mécanique. Le nom même de l’entreprise montre qu’il s’agit de lancer une activité sans idée préconçue des produits qu’elle va vendre et fabriquer, mais qu’elle va saisir toutes les occasions qui se présenteront dans ce domaine très large. L’objectif est donc très pragmatique : il s’agit d’assurer le développement de l’entreprise.
Un formidable esprit de réussite
Marcel Môme est entreprenant, et peut ajouter plusieurs atouts à cette qualité : sa formation, l’expérience acquise, ses relations dans ses deux précédentes sociétés – sources de contrats -, ses amis auvergnats ainsi que de nombreux gadzarts qui viendront le rejoindre, et enfin l’appui de son beau-père, directeur à la Compagnie des Signaux. Il est surtout animé d’une formidable volonté de réussir. La suite de son parcours montrera qu’il est un meneur d’hommes, qu’il anticipe les évolutions technologiques et effectue des choix judicieux.
À ses débuts, la Sagem fabrique des caméras et projecteurs Pathé Baby, répare des wagons de chemin de fer, s’impose dans l’alimentation en énergie des centraux téléphoniques et installe des colonnes montantes électriques dans les immeubles. Son effectif s’élève à 50 personnes dès la fin de 1926. En 1928, l’entreprise ouvre une usine à Argenteuil et installe son siège social au 26 rue de Naples, à Paris. Elle acquiert ainsi pignon sur rue et compte 150 personnes fin 1928. La crise de 1929 survient alors que la société est en pleine expansion. Elle surmontera cette épreuve grâce à sa diversification sans préjugés et à son personnel de mentalité auvergnate, dur à la tâche et fidèle. Elle réussit encore mieux en amorçant dans les années qui suivent un premier virage technologique vers la mécanique fine. Elle se lance alors dans la fabrication d’équipements de précision pour la marine nationale : des directions de tir, des télémètres, et surtout des gyrocompas. Ces appareils, utilisés sur les navires et les avions, et leurs applications impliquent le développement d’un bureau d’études dans des domaines de pointe. L’entreprise peut dès lors se poser en interlocuteur crédible dans l’armement.
La défaite de 1940 et les années d’Occupation imposent une politique de survie, facilitée par l’existence de l’usine de Montluçon en zone libre, acquise en 1934. Face à l’Occupant, il s’agit de faire “profil bas” en concentrant l’activité sur la réalisation de gazogènes, d’installations frigorifiques ou de machines de fabrication de chaussures. Mais c’est surtout une période de réflexion sur les produits civils et militaires qui seront nécessaires à la fin de la guerre. C’est ainsi que naissent les téléscripteurs, dont un prototype capte le message annonçant le Débarquement allié en Normandie. C’est un produit français, alors que le marché naissant est dominé par les Américains et les Allemands. Pour réaliser les études de ces nouveaux produits, le nombre d’ingénieurs augmente considérablement.
On peut s’interroger sur le financement et la gestion de toute cette expansion réalisée dans les pires conditions. Elle s’explique de plusieurs façons : par des augmentations de capital ; par une prise de participation de la Compagnie des Signaux, suivie d’une introduction en bourse en 1936 ; et enfin par l’introduction en bourse en 1946 de la SAT, acquise en 1939, dont Sagem détenait la quasi-totalité du capital. À la fin de la guerre toutefois, la société se trouve dans une situation financière critique. Une entreprise moins dynamique et volontariste aurait sombré, mais deux produits vont la sauver : la fabrication sous licence des haveuses pour l’extraction prioritaire du charbon, et la production industrielle des téléimprimeurs. Parallèlement, dès les années 50, les commandes d’armement reprennent. En 1955, la société compte 4 200 salariés. Il faut préciser que chaque activité devait être autonome et dirigée par un responsable motivé, ce qui apportait beaucoup de souplesse à l’ensemble.
Avare de paroles et homme d’action
La Sagem allait saisir une dernière évolution technologique, celle des transistors apparus sur le marché à la fin des années cinquante. Leur première application vise à remplacer les cames et embrayages des téléscripteurs par des dispositifs électroniques. Sa production à grande échelle assure le développement de la société dans les années soixante-dix. Marcel Môme ne connaîtra pas la formidable ascension de sa société. Alors qu’il est depuis 1944 PDG de la Compagnie des Signaux, son premier employeur, et grand patron de CSEE-Sagem-SAT (le groupe G3S), il décède subitement le 2 mars 1962. Il avait épousé en 1924 Claudine Masson-Verny, fille de Félix Verny, directeur à la CSEE. Ils ont eu quatre enfants dont deux fils, Pierre et Marcel, et deux filles : Claudine, épouse de Roger Labarre (Cl. 40) et mère de Georges Labarre (Ch. 66), et Pierrette, sa cadette, épouse de Pierre Faurre. Peu connu du grand public, Marcel Môme apparaissait très peu dans les médias. Il est donc difficile de tracer un portrait de ce personnage. Cependant, on sait qu’il a marqué, dès l’origine, l’identité de la Sagem. Il lui a transmis des caractéristiques fondatrices de son comportement : grand travailleur, avare de paroles, homme d’action. Il jugeait en outre indispensable le dialogue entre les différents échelons d’une entreprise, source d’équilibre pour tous. Sa fille Pierrette ajoute que “sa réputation d’homme réfléchi, prenant des décisions mûries qui s’avéraient justes, entraînait l’adhésion de ses collaborateurs directs et, en cascade, du personnel”. Sur le plan social, il s’est révélé précurseur en instaurant des congés payés dès 1929, complétés par des jours d’ancienneté dès 1934. Ils atteignaient deux semaines en 1935. L’intéressement aux résultats date des débuts de l’entreprise. La survie de l’entreprise a nécessité un licenciement en 1949, mais avec priorité de réembauche, et les effectifs ont repris leur progression dans les deux ans qui ont suivi. On peut compléter cette description par les propos de son petit-fils Georges : “La gestion était prudente (auvergnate, NDRL), nous étions près de nos sous – par exemple, pour le courrier interne, nous utilisions des enveloppes usagées”. Roger Labarre lui succède en 1962 jusqu’à sa mort en 1999, où Pierre Faurre prend les rênes avant qu’il ne décède à son tour en 2001. Sagem a récemment fusionné avec Snecma pour former le groupe Safran. Membre bienfaiteur de la Société des ingénieurs Arts et Métiers, Marcel Môme est devenu chevalier de la Légion d’honneur en 1952 et officier en 1961. Il est inhumé à Saint-Cloud.
Edmond De Andrea (Ai 45)
Dates clés de la Sagem
1925 : Fondation de la société, au capital de 38 000 euros (250 000 francs à l’époque), puis 76 000 euros.
1926 : Ouverture de l’usine d’Argenteuil.
1928 : L’entreprise compte 150 ouvriers et son siège social s’installe rue de Naples, à Paris.
1934 : Acquisition de l’usine de Montluçon, “au pays” – 883 salariés. CSEE prend une participation.
1936 : Introduction en bourse, avec 1 000 salariés et un capital de 4,6 millions d’euros.
Début 1940 : Achat du château d’Argentières, près de Montluçon, qui deviendra le centre Sagem en zone libre.
1950 : Lancement des haveuses et des téléscripteurs.
1955 : Fondation du G3S. L’entreprise compte 4 200 salariés.
1962 : À la mort de Marcel Môme, G3S est un leader mondial en télégraphie (télex), gyroscopie (navigation inertielle), imagerie thermique (infrarouge). Le groupe emploie 10 000 salariés.
Fernand Picard

Promotion Lille-Paris 1923
Chennevières sur Marne 1906 – Paris 1993
Père de la 4 CV Renault
Président de la Société des Ingénieurs Arts et Métiers
Prix Nessim Habif 1988
Henri Verneuil (né Achod Malakian)

Promotion Aix 1940
en Arménie 1920 – Paris 2002
Metteur en scène et Producteur de nombreux films
Prix Nessim Habif 1973
Membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

Héros d’une histoire d’intégration exemplaire, le grand cinéaste d’origine arménienne,aux films inoubliables, était aussi un ingénieur.
Apatride… C’est le premier mot de français qu’apprennent ces Arméniens fuyant la Turquie, qui débarquent à Marseille un matin de décembre 1924: le fonctionnaire de police le marque au tampon encreur sur leurs passeports, les autorisant ainsi à rester en France. Ils sont cinq : le père, Agop Malakian, sa femme Araxi, les deux soeurs de cette dernière Anna et Gayané, et un garçonnet de quatre ans, Achod, né le 15 octobre 1920 à Rodosto (Turquie). Avec pour tout bagage un lourd ballot porté par le père, et pour toute fortune huit pièces d’or camouflées dans les boutons de la robe de la mère, ils s’installent au 109, rue Paradis. C’est presque un taudis. Dès le lendemain de leur arrivée, le père s’embauche comme manutentionnaire aux Raffineries de sucre Saint-Louis ; quelques semaines plus tard, les trois soeurs trouvent des emplois de chemisières à domicile. Car il faut vivre, et avec un objectif absolu : faire faire des études au petit Achod. Malgré les difficultés évidentes et constantes auxquelles se heurtent ces réfugiés aux maigres ressources, qui parlent à peine français, jamais le clan ne perd l’espoir. Même lorsqu’il rentre épuisé de son dur labeur (de nuit, parce c’est mieux payé), le chef de famille, conteur merveilleux, narre à son Achod des histoire charmantes qui le font rêver. En dépit de son isolement à l’école où, au début, le petit garçon souffre de sa situation d’immigré, la tendresse chaleureuse de tous les instants qui l’enveloppe lui assure un épanouissement certain et la promesse d’un avenir meilleur. En connivence permanente et totale, cette cellule familiale s’organise pour le protéger, le soutenir, l’encourager.
Il gardera toute sa vie la marque de cette relation familiale si forte. Il entre bientôt à l’Institution Melizan, école privée réputée où ses parents l’ont inscrit, au prix de lourds sacrifices financiers, pour qu’il étudie dans les meilleures conditions. Mais il se sent exclu par ses camarades issus de la “bonne société” marseillaise, et compense sa solitude en se racontant des histoires.
Achod a sept ans lorsque, un certain 24 avril 1927, son père l’emmène à une réunion commémorant le massacre des Arméniens commis en 1915 au nom du panturquisme. Il découvre, bouleversé, la terrifiante histoire de son peuple. Il entrevoit aussi, petit à petit, le passé de sa famille : son père, armateur de pêche, possédait vingt bateaux, une belle maison et des domestiques, un grand jardin dont il se rappelle seulement les roses…
Tout cela, ils ont dû l’abandonner. Le poids du passé, le vécu quotidien amènent doucement le jeune garçon à imaginer son avenir avec une grande ambition, pour sortir les siens de leur situation précaire. Un jour, il déclare à sa famille ébahie qu’il veut devenir “ingénieur mécanicien de la Marine militaire”. Pour y arriver, le chemin passe par les Arts et Métiers. Le garçon se retrouve pensionnaire à Aix-en-Provence pour préparer, en quatre ans, le concours d’entrée. L’an 1940 arrive et, malgré les événements, le concours d’entrée a lieu en juillet. Achod Malakian est reçu “à titre étranger”: il ne sera naturalisé que vingt-cinq ans après son arrivée sur le quai de la Joliette, par un décret du 4 novembre 1949. Pendant ses trois années à Aix, “Malaks” participe activement aux activités de sa promotion, développant des animations avec un sens musical et artistique évident, mais faisant aussi preuve d’originalité et de caractère. Lors d’une fête traditionnelle, il joue le rôle d’un metteur en scène en plein tournage devant une caméra de carton: hasard prémonitoire ou prémices d’une vocation ? Son diplôme en poche, il s’oriente d’abord vers le journalisme. De 1944 à 1946, il est rédacteur en chef du magazine “Horizon”, puis critique cinématographique et radioreporter. C’est alors qu’il s’essaye au court-métrage. En 1947, sa rencontre avec Fernandel et l’amitié qui en découlera seront des éléments déterminants de sa carrière. L’acteur accepte de tourner avec lui, un inconnu, un court-métrage sur Marseille: “Escale au soleil”. Le gadzarts poursuit dans cette voie comme assistant de réalisation, en 1969. En 1951, il tourne enfin son premier grand film, avec Fernandel: “La table aux crevés”, d’après Marcel Aymé. C’est un succès. À tel point que les deux hommes feront encore sept films ensemble. Le jeune réalisateur est devenu entre-temps Henri Verneuil. “Dès cette époque, soulignerat-il plus tard, j’ai toujours fait ce métier avec entrain et jubilation. Si on tourne un film avec plaisir, on évite l’ennui à coup sûr. Tout le monde aime une histoire bien racontée : à l’écran, c’est la même chose. Il faut savoir placer la caméra au bon endroit et avec le bon angle, pour donner à l’histoire le maximum de vérité et de vie. Cet art de raconter, avec des moyens visuels, me vient sans doute de mon père qui possédait ce merveilleux talent souligné de gestes expressifs.”
À la suite de Fernandel, de nombreux acteurs jouent dans les films d’Henri Verneuil : Jean-Paul Belmondo (dans huit films), Jean Gabin, Alain Delon, Lino Ventura, tous trois réunis dans “Le clan des Siciliens” en 1969, suivi de “Le casse” en 1971. Au vu de sa réussite, on reproche au réalisateur de faire du “cinéma commercial”. Il se défend d’avoir un message à délivrer, et dit se contenter de tourner des films qu’il aurait envie de voir. Et comme il a de nombreux points communs avec le spectateur moyen, ses productions rencontrent le succès. Tant pis pour les cinéastes moins heureux que lui et que le public boude régulièrement : ce sont, dit-il, “des petits profs de philo”.
Au terme d’une filmographie impressionnante (voir encadré), il place en point d’orgue de son oeuvre deux films très personnels : “Mayrig” en 1991, “588 rue Paradis” en 1992. Mayrig, cela veut dire “Maman” en arménien… Après la disparition d’Araxi en 1982, à 87 ans, Achod Malakian a publié un livre sous ce titre, pour conter cette histoire d’amour d’un fils avec ses parents, avec son sens profond de la famille. Lui-même, marié, a eu d’abord deux enfants, Patrick et Sophie ; puis, après un divorce et un remariage en 1984, sont nés Sevan et Gayané. Commandeur de la Légion d’honneur, chevalier des Arts et Lettres, Henri Verneuil reçoit en 1973 le prix Nessim Habif en l’hôtel d’Iéna, des mains de Pierre Chaffiotte (Cl. 35), président de la Société.
UN CONTEUR DE BELLES HISTOIRES EN IMAGES
Parmi les 35 films d’Henri Verneuil figurent nombre de grands succès : “L’ennemi public n° 1” en 1953, “Le mouton à cinq pattes” en 1954, “Une manche et la belle” en 1957, “La vache et le prisonnier” en 1959, “Le Président” en 1961, “Un singe en hiver” en 1962, “Mélodie en sous-sol” et “Cent mille dollars au soleil” l’année suivante, “Weekend à Zuydcoote” en 1964, “La vingt-cinquième heure” en 1967, “Le serpent” en 1972 (qui réunit Henry Fonda, Yul Brynner, Dirk Bogarde, Philippe Noiret, Michel Bouquet), “Peur sur la ville” en 1974, “I… comme Icare” en 1979, “Mille milliards de dollars” en 1981, “Les Morfalous” en 1984.

Le Grand prix de l’Académie française lui est remis pour l’ensemble de son oeuvre, ainsi qu’un César d’honneur. “Mayrig” lui vaut le Grand prix de l’Académie du cinéma. Enfin, lors de sa réception sous la coupole de l’Institut de France en décembre 2000 (voir AMM d’avril 2001, p. 54), Henri Verneuil qualifie son élection à l’Académie des Beaux-Arts de “dernière page d’une modeste histoire d’intégration”. Une intégration à la française, qui lui a permis de garder intacts tous les éléments de sa première culture, la seconde devenant alors un enrichissement exceptionnel: “Arménien, je suis ; plus Français que moi, tu meurs!” Henri Verneuil est décédé le 11 janvier 2001, ses obsèques ont été célébrées en l’église arménienne de Paris. Il a été inhumé à Marseille.
Jean Vuillemin (Pa 40)

Réalisé à partir des Portraits issus
du site de la Fondation, créé par Frédéric Champlon Ch 194.
René Baudry

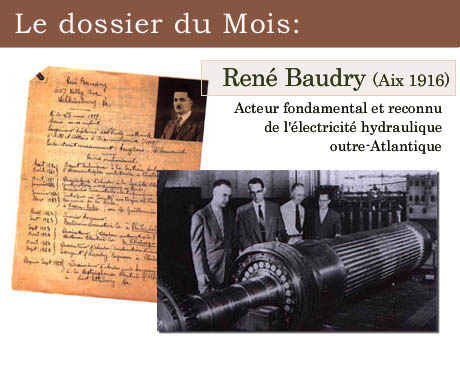
Ormoy sur Aube – Paris 2000
Promotion Aix 1916
René Baudry est né à Ormoy sur Aube (Hte Marne). Sa famille s’installe peu après à Gevrolles (Côte d’Or) où son père est régisseur du château. C’est une famille simple, laborieuse, économe, d’une grande probité. Lui était un enfant calme, sérieux, au regard doux, avec de grands yeux marron, observateurs. Il disait en en rajoutant, que son éducation avait été stricte et sévère. Il était très attaché à la Bourgogne dont il avait gardé l’accent rocailleux, savoureux lorsqu’il parlait anglais. En 1914 il est envoyé en Allemagne pour apprendre la langue et il rentre en France à la déclaration de guerre, par la Suisse. Il prépare le concours et entre aux Arts et Métiers, à Aix, en 1916 et en il gardera toute sa vie un souvenir fantastique, (y compris celui des ” Deux Garçons ” – une brasserie-). Mobilisé en 1918, il participe à la deuxième bataille de la Marne (Juillet-Août 1918). Il fera partie de tous les élèves-combattants diplômés en 1921. En 1923, il part pour les Etats-Unis où il travaille comme tourneur pendant cinq mois et apprend l’anglais. A la suite d’un contact avec un homonyme sans lien de parenté, Paul Baudry (An 1913), qu’il avait connu lors d’un bref passage à ” l’Alsacienne de Constructions Electriques “, il entre en 1925 chez Westinghouse à East Pittsburgh en Pennsylvanie où il fera toute sa carrière.
D’abord dessinateur d’étude, puis ingénieur mécanicien, il est très vite remarqué et dès 1926, il suit les cours spéciaux de mécanique de S.P.Timoshenko, spécialiste mondial de la résistance des matériaux. Pendant la grande crise de 1929, il fait partie des quelques ingénieurs que Westinghouse garde, alors que les places vides se multiplient dans les bureaux. Le ” New Deal ” de F.D.Roosevelt et en particulier le programme de la Tennessee Valley Authority et des grands projets dans l’Ouest tels que les barrages de Grand Coulee et de Hoover, relancent l’industrie de l’énergie électrique. Les puissances des générateurs passent en 10 ans (1930-1940) de 30 à 200 MW, avec une très forte concurrence entre Westinghouse et General Electric, l’innovation technique ayant été de ce fait considérable.
René Baudry est un des acteurs reconnus de ces innovations. Il a en effet déposé 78 brevets entre 1930 et 1969, soit à titre personnel soit associé. La plupart de ces brevets concerne les générateurs entraînés par turbines et il s’est particulièrement intéressé à deux domaines essentiels : les pivots (thrust bearings) et le refroidissement des alternateurs. Le terme français de pivot (Pivoted pads thrust) venant probablement de l’utilisation de parties en contact pivotantes, est celui qui est le plus employé en France mais on trouve aussi quelquefois celui de butée. Il s’agit du dispositif qui encaisse tous les efforts verticaux des générateurs à axe vertical, type turbines Kaplan (poids et poussées dynamiques). La rotation d’un disque tournant sur un disque fixe encaisse ces efforts verticaux. La partie fixe est composée de patins (6 ou 8 par exemple) légèrement pivotants et les frottements réduits grâce à un film d’huile auto créé, c’est-à-dire sans pression extérieure. Les premiers essais de ce type de pivot dataient des années 1910-1912 et réalisés par Kingsbury et Michell. La quinzaine de brevets pris par R.Baudry ( voir encadré) concernent le dessin des patins, l’étanchéité des parties tournantes, la corrosion et s’appliquent à des groupes jusqu’à 200 MW dont le diamètre du pivot peut atteindre 10 pieds soit 3m. et la poussée verticale 1000 tonnes . Les vitesses de rotation étaient relativement réduites dans les premières réalisations mais ont augmenté rapidement pour atteindre 3600 t/mn. Il s’agit donc d’un élément essentiel du dessin de ces groupes turbo-alternateurs.

Quelques uns des brevets
– Dispositif de frettage de rotor (1931)
– Support de pivot (1932)
– Lubrification de palier(1937)
– Refroidissement à l’hydrogène (1940)
– Accouplement électrique (1941)
– Densimètre pour gaz (1949)
– Dispositif anti-corrosion pour pivot (1952)
– Double ventilation à l’hydrogène (1959)
– Patin de pivot indéformable à la chaleur et en charge (1969)
Le refroidissement des générateurs a été à la base d’une vingtaine de brevets,(voir encadré) dont six concernent une innovation intéressante, l’utilisation d’hydrogène soufflé dans les enroulements au travers de parties creuses aménagées, le tout en caisson . En 1954, deux alternateurs de 175 et 200MW, tournant à 3600 t/mn ont utilisé cette technique. Enfin, pendant la guerre de 39/45, il a conduit des études pour la défense américaine dont il n’a jamais révélé la teneur mais qui lui ont valu en 1947 une manifestation de reconnaissance de l’armée. On peut dire enfin qu’étant en retraite en France , il était appelé en consultation comme expert par son ancienne société. Ingénieur mécanicien, il était membre de l’Américan Society of Mechanical Engineers (ASME) et Ingénieur électricien, membre de l’American Institute of Electrical Engineers ( AIEE) devenu depuis 1963 l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Il avait été nommé en 1964 ” Fellow ” de l’ASME, distinction rare attribuée par un jury et réservée à des personnalités éminentes dans leur profession, justifiant de 25 années de remarquables contributions à leur métier et à la Société. Et en 1966 il reçut une autre distinction rare, la Médaille LAMME de l’IEEE. Ses publications et conférences, seul ou associé, dont nous avons 18 exemplaires(voir encadré) soit dans le cadre de l’ASME, soit dans celui de l’AIEE ont jalonné toute sa vie professionnelle et elles étaient très appréciées. La rigueur dans le développement de ces innovations y était certainement pour beaucoup.
Il avait acquis la nationalité américaine peu avant la deuxième guerre mondiale.
Quelques exemples de publications Acceptées par l’AIEE:
– Pivots modernes pour turbo-générateurs (1947)
– Vibrations magnétiques dans les stators à courant alternatif (1954)
– Evolution du dessin des pivots (1959)
– Amélioration du refroidissement des gros alternateurs (1964)
Acceptées par l’ASME:
– Performance des pivots au démarrage (1947)
– Quelques effets thermiques sur les pivots (1958)
– Performance des pivots à la centrale de Hoover (1959)
– Théorie de la détection ultrasonique des fissures (1963)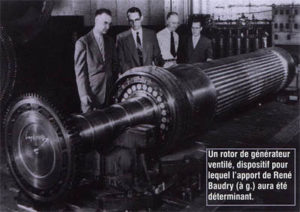 On ne peut parler de René Baudry sans évoquer Louise Bouquet qu’il avait épousée à Chicago en 1926. Elle était issue, elle aussi, d’un milieu simple, avait fréquenté l’école publique, celle de Jules Ferry et de sa morale faite de d’honnêteté, d’économie et…surtout de travail. Immigrés, leurs débuts furent évidemment très difficiles mais très rapidement ils furent amenés à fréquenter les cercles francophones et francophiles des USA (Alliance française et University Club de Pittsburgh).
On ne peut parler de René Baudry sans évoquer Louise Bouquet qu’il avait épousée à Chicago en 1926. Elle était issue, elle aussi, d’un milieu simple, avait fréquenté l’école publique, celle de Jules Ferry et de sa morale faite de d’honnêteté, d’économie et…surtout de travail. Immigrés, leurs débuts furent évidemment très difficiles mais très rapidement ils furent amenés à fréquenter les cercles francophones et francophiles des USA (Alliance française et University Club de Pittsburgh).
Pendant la guerre, Louise prit une part très active dans l’organisation des secours aux Français en organisant l’envoi de milliers de colis. Elle reçut à ce titre la médaille du Mérite Français. Elle a aussi organisé pendant 25 ans la ” Table Française “, déjeuner mensuel où elle accueillait les Français ” en exil ” et de nombreux Américains francophiles. Les Gadzarts de passage ne pouvaient échapper à cette invitation. En 1995, à Paris, Louise reçut les Palmes Académiques pour l’ensemble de ses actions au bénéfice de la France, du français et des Français. Retirés à Paris en 1964 dans le XVIe arrondissement, ils se sont éteints centenaires, lui en 2000, elle en 2001. N’ayant pas d’enfants, c’est leur filleul, Jacques David, qui leur était très proche et qui les a accompagnés pendant une grande partie de leur vie et plus spécialement à la fin. Ils sont inhumés à Vierzon (Cher)
Jacques David
Edmond De Andréa – Aix 45
Louis Bechereau

Durant le premier conflit mondial, les ingénieurs de l’aéronautique jouèrent un rôle obscur mais tout aussi décisif que celui des pilotes. Un jour, l’ingénieur Louis Béchereau voulut voler avec Guynemer. “Pas question, répondit l’as; avec ma sœur et le général Foch, vous êtes la dernière personne que j’emmènerai en avion, de peur qu’il vous arrive quelque chose”.
Plou 1880- Paris 1970
Promotion Angers 1896
Louis Béchereau naquit le 25 juillet 1880 à Plou dans le Cher. Élève de l’école nationale professionnelle de Vierzon, il prépare et réussit le concours des Arts et Métiers. Âgé de 16 ans, il entre à l’école d’Angers en 1896; il est ainsi le contemporain de Clément Ader, de Gabriel Voisin, de Wilbur Wright, de Henri Farman ou encore de Louis Blériot. Il appartient à cette génération de Gadzarts qui allait contribuer à l’envolée des ailes françaises … Ayant achevé ses études en 1901, il participe à la veille de son incorporation, à une compétition de modèles réduits organisé par le journal ‘L’auto’. Béchereau remporte alors le premier prix; son modèle sera fabriqué en série pour le compte des grands magasins parisiens.
Les débuts
Libéré de ses obligations militaires en 1902, Béchereau rejoint un atelier à Bezons où il participe à la construction du prototype automobile dont le concepteur n’est autre que … Clément Ader. Cette expérience au côté du précurseur de l’aviation moderne lui permet d’évoquer fréquemment les essais de vols réalisés avec ‘l’Eole’ ou ‘L’Avion’.
En 1903, Béchereau entre à la ‘Société de Construction d’Appareils Aériens’ fondée à Levallois par le neveu de Clément Ader. Client de cette société, Armand Déperdussin commande en 1909 la réalisation d’un aéroplane, lequel sera exposé sous les verrières du Bon Marché. Enthousiaste, il crée en 1910 la ‘Société des Aéroplanes Déperdussin’ et il confie la conception des avions de la marque au jeune Béchereau. Les ateliers seront établis à Reims-Bétheny et rue des Entrepreneurs à Boulogne.
Le temps de records
Béchereau s’oriente rapidement vers la construction d’appareils ‘monoques’, dont les formes aérodynamiques offrent des performances inaccessibles jusqu’alors. Il s’appuie sur une équipe formée notamment de Gadzarts : Louis Janoir, chef-pilote (Ch 1901), et André Herbemont (Ch 1909) engagé dès sa sortie de l’école en 1912. Forte de collaborateurs dévoués et de choix techniques révolutionnaires, la maison Déperdussin remporte de nombreux prix, dont la fameuse coupe Gordon-Bennet en 1912 avec le pilote Jules Védrine.

Les appareils Déperdussin connaissent une renommée mondiale, cependant la S.P.A.D. (Société de Production des Aéroplanes Déperdussin) est mise en faillite en raison de pratiques frauduleuses de son fondateur. Louis Blériot reprend la S.P.A.D. signifiant désormais : ‘Société Pour l’Aviation et ses Dérivés’. Béchereau, Bourgeois (Ch. 04), Gaillard (Li. 06), Tahon (Li. 08), Leplanquais (An. 10), Papa (An. 97) et Herbemont seront les collaborateurs du nouveau président Blériot.

Dates | Epreuves remportées | Pilote / Avion
12/1911 Record du monde de hauteur avec un passager : 3.200m
Marcel Prévost sur Déperdussin 100 cv
01/1912 Record du monde de hauteur avec 2 passagers : 2.200m
Marcel Prévost sur Déperdussin 100 cv
04/1912 Coupe Pommery: Record du monde de distance à travers la campagne
avec un passager Marcel Prévost sur Déperdussin
09/1912 Coupe Gordon-Bennett: Record du monde de vitesse 167,8 km/h
Jules Védrines sur Déperdussin
04/1913 Coupe Schneider: distance de 270 km parcouru en 3h 48' 22'' Marcel Prévost
sur hydravion Déperdussin 160 cv
07/1913 Record du monde de vitesse : 181 km/h
Marcel Prévost sur monocoque Béchereau 140 HP
09/1913 Coupe Gordon-Bennett: Record du monde de vitesse 203,85 km/h Marcel Prévost
sur monocoque Béchereau 160 HP
10/1913 Coupe Deutsch de la Meurthe Eugène Gilbert sur monocoque Béchereau 160 HP
Une contribution significative à la victoire de 1918
En août 1914, les événements politiques font des Armées alliées les nouveaux clients de la S.P.A.D. Le premier modèle Spad fait une apparition timide au mois de novembre 1914.

Il s’agissait du Spad <<nacelle-avant>>, dont un compartiment situé devant l’hélice devait permettre au mitrailleur de faire feu sur les Fokker et autres aviatiks. Comme l’écrivit son concepteur, le Spad-nacelle n’eut guère qu’un succès d’estime et son expérience fût brève. Peu après, Béchereau étudie différents modèles d’avions, dont le septième est le fameux Spad VII. Produit à partir de 1916, le Spad devient l’avion standard des forces aériennes françaises, il équipera la plupart des puissances alliées.
En 1917, de nouvelles versions du Spad apparaissent successivement : le Spad XII, puis le Spad XIII. Ce dernier est le premier avion à disposer de deux mitrailleuses synchronisées et ses performances en vol sont encore améliorées. Le succès du Spad était attribué “à sa grande maniabilité, à sa grande mobilité en rotation, à son axe longitudinal d’inertie qui lui permettait d’effectuer toutes les acrobaties possibles et imaginables.

Parmi les nombreux pilotes qui chassaient à bord d’un Spad, on peut notamment citer les as français : Fonck, Au mois d’août 1916, les Spad VII sont livrés à l’escadrille des Cigognes et Béchereau fait la rencontre de Guynemer. Après avoir éprouvé sa nouvelle monture, le pilote écrit aussitôt à son concepteur pour lui en communiquer son appréciation: L’appareil est merveilleux. J’ai grimpé à plus de 3.000 mètres en 9 minutes à peine et j’ai exécuté plusieurs renversements complets, sans difficultés et sans que le moteur bafouille. Je passe ma journée dans mon taxi et je voudrais passer mon temps à le retourner dans tous les sens.
Guynemer se rendait fréquemment aux ateliers de la rue des Entrepreneurs. Il contribua ainsi à l’amélioration et à la mise au point des appareils. La correspondance de Guynemer et de Béchereau témoigne des liens fraternels entre les deux hommes. A travers les récits du pilote, Béchereau devient un témoin privilégié de ses combats aériens. On les voyait ensemble au volant d’une petite Hispano-Suiza blanche : ” Tiens, disait-on en les voyant, voilà les deux frères! “.
Le 12 juillet 1917, Béchereau est promu Chevalier de Légion d’Honneur. Quelques jours plus tard, dans le grand hall de la Société Spad, en présence du ministre de la Guerre, la décoration lui est remise par son ami Guynemer,. La lettre de félicitation du pilote légendaire se termine par ces mots : ” Vous avez donné la suprématie aérienne à votre pays, et vous aurez une grande part dans la victoire. C’est un splendide titre de gloire. C’est avec le sentiment de l’admiration et de la grande reconnaissance que nous vous devons tous, que je vous donne l’accolade”.
La paix revenue, Herbemont succède brillamment à Béchereau au poste de directeur technique. Ce dernier vient de quitter la S.P.A.D pour créer la Société des Avions Bernard dite ‘Société des trois B, avec Bernard et Birkigt (fondateur de la Société Hispano-Suiza). Béchereau collabore également avec la Société des moteurs Salmson, et s’associe en 1931 avec le carrossier J.Kellner pour créer la société ‘Kellner-Béchereau’. A la veille du nouveau conflit mondial, il conçoit le monoplan embarqué K.B.E 60 destiné à la Marine Nationale. Cet appareil était considéré comme un chef d’œuvre de l’art aéronautique mais le déroulement de la guerre vint contrarier sa destinée. En 1942, l’usine est détruite par un bombardement, la société ‘Kellner-Béchereau’ fusionne alors avec les ‘Aéroplanes Moranes-Saulnier’. Béchereau exercera une fonction de directeur au sein de cet établissement jusqu’à sa retraite en 1950.
Un génie créateur reconnu par ses pairs
Si le nom de Béchereau reste peu connu du grand public, ses pairs ont su lui rendre hommage et reconnaître en lui, un génie créateur. En 1947, Béchereau est promu Officier de la Légion d’Honneur, il reçoit la Médaille d’Or de l’Aéro-Club de France et est élu membre d’Honneur de l’Union Syndicale des Industries Aéronautiques. En 1950, il reçoit la médaille de l’Aéronautique . En 1959, il est lauréat de l’académie des sciences et reçoit le prix Arthur du Faÿ. Enfin, en 1966, Béchereau reçoit le Prix Nessim Habif et est élevé au grade de Commandeur de Légion d’Honneur. Il décède le 18 mars 1970, en son domicile 2, rue Gervex à Paris, âgé de 89 ans. Celui dont l’avion contribua de manière significative à la supériorité aérienne des troupes alliées, était également connu pour sa simplicité et son extrême modestie.
Frédéric Champlon (Ch 94)
Extrait de Arts et Métiers Magazine – Avril 2003.

Louis Bergeron
 Lagnieu 1876- Colombes 1948
Lagnieu 1876- Colombes 1948
Promotion Aix 1892
Grand patron, mais aussi grand théoricien, Louis Bergeron a laissé son nom à la postérité pour ses travaux sur les pompes. Louis Bergeron naît le 10 mars 1876 à Lagnieu, dans l’Ain (…). Il entreprend ses études à l’École Professionnelle de Voiron et entre major aux Arts et Métiers d’Aix en 1892 (…). Après un stage d’un an dans une maison de chauffage à vapeur, il entre en 1900 à la maison Farcot, grand mécanicien de St Ouen, au bureau d’études électriques. Cette entreprise, connue pour ses machines à vapeur, fabrique aussi des machines électriques de grande puissance (…).
Travailleur acharné, Louis Bergeron complète sa formation par des études approfondies en mathématiques pures et en électricité. Rapidement, de plus grandes responsabilités lui échoient. Il prend la responsabilité des Pompes centrifuges, puis la direction technique de la Société en 1911. Il se rend rapidement compte, à ce poste, que la progression de l’entreprise ne pourra continuer par manque de solidité financière.
Il décide alors de créer, avec Eugène Beaudrey, un bureau d’études et d’entreprises: ” Beaudrey-Bergeron ” à Paris qui deviendra en 1933 : ” Maison L.Bergeron ” et en 1948 : Bergeron SA “. L’objectif n’est pas de fabriquer mais de vendre, d’étudier et d’assurer le montage ” d’installations élévatoires ” à la demande. Cette stratégie, très novatrice à l’époque ne sera jamais reniée et les effectifs de la société ne dépasseront jamais une centaine de personnes. En 1933, les deux associés se séparent à l’amiable, Bergeron gardant les pompes et stations de pompage, Beaudrey les systèmes de filtration (…).
La guerre de 14-18 interrompt l’activité. Louis Bergeron est mobilisé, fait un an dans les tranchées puis est renvoyé en usine pour travailler à la fabrication de munitions. Dès 1916 pourtant, il reprend ses travaux d’électricité et d’hydraulique, en traitant pour le port de Saint-Nazaire. (…)

A partir de 1918, les affaires d’ensembles élévatoires deviennent définitivement son marché. Il traite aussi des installations comportant des matériels mécaniques (ponts roulants), mais sa spécialité, c’est l’hydraulique. Paul Bergeron, le fils de Louis reprend la société après le décès de son Père en 1948 jusqu’à sa propre disparition en 1985. Alain Le Grand, neveu de Paul reprend alors la suite. Pour faire face au besoin impératif de développement à l’international, une société, filiale à 100{7c045177abe3e375b80fdc991a35b0c620d25696bff93cbc663732b700147d79} d’Alstom est créée en regroupant Bergeron SA avec l’activité pompes de Rateau, filiale d’Alstom.
Pendant une vingtaine d’années de travail intense, du point de vue technique et commercial, Louis Bergeron n’a jamais abandonné les études de théorie pure, ce sont elles qui lui ont valu les commandes et les résultats obtenus. Il a aussi écrit des livres dont un Dunod de 1921 : ” Calcul des charpentes avec des solutions graphiques ” et un autre Dunod de 1950 , paru juste après sa mort: ” Du coup de bélier en hydraulique au Coup de foudre en électricité “. Ces livres ont été traduits en plusieurs langues dont l’américain et le russe pour le second (…).
Il a été honoré par divers distinctions : Officier de la Légion d’honneur, docteur honoris causa de l’université de Lausanne, prix Montyon de l’Académie des sciences. Il est décédé le 23 février 1948 et est inhumé au cimetière de Colombes.
Extrait de l’article d’ Edmond De Andrea (Ai 45)
Arts et Métiers Magazine – Septembre 2002.
Joseph Berliat

Curtin 1881- Bormes 1938
Promotion Aix 1897
Bormes-les-Mimosas : ce nom, à lui seul, est évocateur. Situé à 42 km à l’est de Toulon, sur la côte varoise, ce village typiquement provençal accroché au flanc de la colline que dominent les ruines du château était, dans les années trente, complètement ignoré du tourisme. On comprend que Joseph Berliat, parcourant la côte avec son épouse à la recherche d’un point de chute, ait été enthousiasmé par ce site exceptionnel et ait décidé de s’y installer.
Un “bourru tendre” d’une grande délicatesse
Cet ingénieur Arts et Métiers est né en janvier 1881. Sa famille est originaire de Curtin (Isère) où son père, meunier, lui donne tout jeune le goût de la mécanique. Il se souviendra toujours du vieux moulin de son enfance, qu’il rendra plus tard moderne et silencieux.
En bon Dauphinois, il va à l’École nationale de Voiron pour y préparer les Arts et Métiers. Il sera reçu à Aix en 1897. Comme beaucoup de ses camarades, à cette époque, II entre comme compagnon à la Compagnie de Fives-Lille. Il sera ensuite mécanicien à la maison Moisant de Paris, puis traceur et chef d’équipe dans les ateliers de charpente métallique de cette société. Après dix années d’apprentissage, il revient en Dauphiné et entre aux établissements Régis Joya à Grenoble en tant que chef des études. Il s’occupe particulièrement des ponts et charpentes métalliques, ainsi que des travaux de barrages et de caissons métalliques à air comprimé pour les fondations.
Charpentes et levage
Malgré l’importance prise par la maison Joya, réputée pour sa chaudronnerie, et qui compte alors plus de 500 ouvriers, il décide en 1912 de fonder son propre bureau d’études et d’entreprise générale. Mais vient la guerre; en 1914, il est engagé volontaire aux chasseurs alpins. Rappelé, il crée alors les ateliers Joseph Berliat, rue Ampère, toujours à Grenoble. C’est un modeste atelier installé dans de vieux moulins à ciment, qu’il va développer sans trêve ni repos pendant un quart de siècle. À la construction des charpentes métalliques, qu’il connaît bien, il va ajouter les travaux de chaudronnerie, de serrurerie et surtout d’appareils de levage et de manutention, grues, portiques et ponts roulants, qui deviendront sa spécialité et constitueront ses meilleures références, avec les portiques de 120 tonnes des ports d’Oran et de Casablanca. Il réalisera le beau portail d’entrée de l’exposition de la Houille blanche à Grenoble en 1925 et un grand pylône pour la TSF, qui lui vaudront une médaille d’or. Son implantation régionale lui permettra d’équiper en ponts-roulants les centrales hydroélectriques des Alpes et même des Pyrénées.
Fidèle à ses origines, son entreprise est une maison de gadzarts, avec Louis Fautrière, qui sera directeur, et Alexandre Guion, secondés par des plus jeunes, Charles Dalmière, Paul Groslambert et, comme stagiaire, son neveu Gustave Landragin, Ses contemporains le décrivent comme un “bourru tendre”, rude et timide, mais d’une grande délicatesse. Il a une vive aversion pour la publicité tapageuse et les honneurs officiels. Sa seule ambition est de faire marcher sa maison, de procurer du travail à ses employés et ouvriers et, plus discrètement, de faire le bien autour de lui. Le technicien se double d’un artiste; il peint très joliment, et a été l’élève occasionnel d’un grand peintre rencontré lors d’un séjour dans l’Esterel. Quand il découvre le terrain de ses rêves, dans une boucle de la route qui monte vers Bormes, avec vue merveilleuse sur les Îles d’Or, il se transforme en architecte pour édifier son mas, souvent de ses propres mains, avec le concours d’artisans locaux. Il fait également l’acquisition d’un terrain à La Favière, dont la petite plage jouxte celle du Lavandou, alors simple village de pêcheurs. Et sur ce terrain, ou il vient volontiers passer la nuit, il édifie des “cabanons” dont ses collaborateurs et employés peuvent profiter à tour de rôle. En ce temps-là, la Société des anciens élèves des Arts et Métiers et son “entraide” se préoccupent des plus âges, car les lois sociales, les retraites, la “Sécu” n’ont pas leur forme actuelle, et la caisse de secours est très sollicitée pour des anciens aux maigres ressources. L’idée germe depuis longtemps de créer une “maison de retraite des gadzarts”. Animée par le camarade Joannès Tête, une commission est chargée d’étudier et de lancer une souscription pour la réalisation de ce projet, avec le concours des Groupes régionaux et des délégués de promotion, en France et en Algérie. Grâce à la générosité des souscripteurs, cette maison prendra forme et sera inaugurée le 4 mai 1940, par le président des ingénieurs Arts et Métiers Charles Koehier, à La Varenne-Saint-Maur.

Dans ce contexte, Joseph Berliat, qui n’a pas de descendant direct, exprime dès 1935 son intention de faire don à la Société de sa propriété de Bormes. En mars 1939, la Revue publie pour la première fois une photo de cette future maison de retraite destinée à compléter celle de Saint-Maur. Hélas, Berliat décède prématurément, à 58 ans, le 23 novembre 1939, alors que la guerre est commencée.
Bien que destinée à ses collaborateurs, son entreprise est reprise en 1940 par la Société alsacienne d’études et d’exploitation, sous le nouveau sigle de Soretex. Cette entité rejoint par la suite la firme Coupé-Hugot qui, installée à l’origine à Saint-Ouen, se transportera à Cosne-sur-Loire, en association avec Schwartz-Hautmont (CHSL). L’ensemble, toujours dédié aux gros appareils de levage, devient Coupé-Hugot-Soretex-Levage.
Les ateliers de la rue Ampère à Grenoble sont fermés. La Société Coupé-Hugot est par la suite mise en liquidation judiciaire, et ainsi disparaît définitivement l’entreprise Berliat.
Dès août 1942, Mme Berliat confirme son respect des intentions de son époux (…). Le 28 août 1945, la donation est signée par-devant notaire, enregistrée et acceptée avec toutes les autorisations légales par le président Jean Fieux, au nom de la Société AM, en septembre 1946, avec une très vive gratitude. D’autant plus que, pour le premier anniversaire du décès de son mari, Mme Berliat a fait un don de 110 000 F pour les œuvres de secours de guerre de la Société. Comme rien n’est jamais simple, l’association des gadzarts ne peut prendre possession de ce bien, occupé sans titre par un médecin qui y restera quatorze ans, malgré les pressions puis les interminables procédures d’expulsion. Ce n’est qu’en février 1960 que les choses rentrent dans l’ordre.
Utile au plus grand nombre
Pendant ce temps, la maison de Saint-Maur a été fermée. La réglementation sociale a complètement évolué et la nécessité d’une maison de retraite, qui ne peut satisfaire que quelques-uns, a fait place dans les esprits à une formule pouvant être utile à un plus grand nombre, celle d’une maison de repos. Les délibérations du Comité vont dans ce sens, et Mme Berliat elle-même autorise ce changement d’affectation en 1958. Le “mas Berliat” des gadzarts est né. Il ne reste plus… qu’à faire quelques travaux d’aménagement ! D’abord dans la maison d’origine, puis par une première extension, ouvrant ainsi douze studios. En 1975, est érigé un bâtiment neuf comprenant huit appartements de deux pièces. Mme Berliat, qui a continué à habiter Bormes sous le château, décède le 17 octobre 1960.
Si l’entreprise de Joseph Berliat n’a pas survécu à son fondateur, sa belle propriété dans laquelle il s’était tellement impliqué perpétue sa mémoire. Les résidents successifs et tous les ingénieurs AM lui rendent hommage, ainsi qu’à son épouse, pour leur générosité qui a doté la communauté Arts et Métiers de ce “mas” unanimement apprécié.
Extrait de l’article de Jean Vuillemin (Pa 40)
Arts et Métiers Magazine – Mars 2001.
Simon Boussiron
Perpignan 1873 – L’Etang la Ville 1958
Promotion Aix 1888
La fin du XIXe siècle et le début du XXe ont été marqués, dans le domaine industriel, par un nombre important de sauts technologiques ayant un impact direct ou indirect sur notre vie de tous les jours, que ce soit dans l’automobile, l’aviation, la santé …ou le Génie civil. Dans ce dernier domaine, le béton armé a été un incontestable saut, apportant une solution aux défauts de la construction métallique (coût, entretien) malgré les progrès de celle-ci (par exemple par Henri Daydé-Ch 1863). Parmi les hommes qui ont cru en ce nouveau ” matériau “, à côté, entre autres, des Coignet, Hennebique, Monier ou Freyssinet, Simon Boussiron a apporté sa contribution de belle manière, développant son entreprise alors que beaucoup d’autres pionniers disparaissaient.
Simon Boussiron est né le 11 avril 1873 à Perpignan dans une famille de ” classe moyenne ” comme on dirait aujourd’hui ; son Père était employé dans une petite banque et était devenu l’homme de confiance de la maison. Son enfance a été rude : orphelin de Mère à 2 ans, séparé de son frère aîné, Jean, pour être élevé par des cousins. Il retrouve son frère et son Père lors du remariage de celui-ci et aura un demi-frère, Louis, qui travaillera dans l’entreprise, et une demi-sœur, décédée jeune. Il épouse en 1906 Hélène Bras, décédée en 2003, et ils auront une fille, Jeanne.
Après l’école primaire supérieure et un court apprentissage, il entre aux Arts et Métiers à Aix en 1888 et en sortira trois ans après dans un rang moyen. Il était qualifié de ” dissipé, bavard ” et on disait de lui ” peut mieux faire “. Après un service militaire de trois ans, il travaille dans plusieurs entreprises dont les ” Établissements Eiffel “. Il est toutefois plus intéressé par le Ciment Armé que par le métallique et entre dans une société de travaux en ciment armé qu’il quitte rapidement pour créer, avec un ami apportant temporairement les capitaux, son entreprise, le 1er mai 1899. L’entreprise devient en 1901 la société Boussiron et Garric (il s’agit très probablement d’Antoine Garric – Aix 1889), puis devient en 1904 la Société Boussiron après le retrait de Garric et enfin ,en 1929, les Établissements Boussiron.
Le béton armé n’était pas inconnu puisque, dès 1849, un précurseur, Lambot, avait réalisé une barque et en 1867, Monier avait pris un premier brevet. Ce n’est pourtant qu’à la fin du siècle que ce nouveau matériau commence à être utilisé, surtout pour les planchers et dalles. Quelques années plus tard, la circulaire d’octobre 1906 le consacrera.
C’est pendant cette période foisonnante pour ce métier que Simon Boussiron se plonge dans la théorie et publie en 1899 deux ouvrages donnant les bases de calcul du béton armé, appliquées à ” son système breveté “. Les formules générales de compression et flexion du béton armé sont ainsi définies. Si cet événement a son importance, c’est qu’il se situe dans une période où les autres jeunes constructeurs pensaient que ce nouveau matériau avait des caractéristiques qui ne suivaient pas les lois de la résistance des matériaux.
Mis à part quelques dalles, le premier ouvrage construit par Simon Boussiron en 1899 est le pont en arc de 15m de la Basse à Perpignan. En effet, on limitait à l’époque à 15 m les ponts à construire suivant ce nouveau procédé. Suivent en 1900, pour le Génie, qui a été la première administration française à adopter ce type de construction, les 28000 m2 de planchers de la caserne Niel à Toulouse et ce chantier lance véritablement l’entreprise.
Celle-ci étant techniquement et commercialement très compétitive, les ouvrages s’enchaînent de 1900 à 1904, essentiellement pour les chemins de fer, parmi lesquels:
- trois ponts pour les Chemins de fer de l’Est
- murs de soutènement de la gare de Clichy
- halles pour les gares
Toutes les administrations publiques mettent alors au concours les projets de construction, d’où une concurrence très vive entre les jeunes entreprises. C’est alors, en 1906, que Simon Boussiron dépose un brevet pour “l’articulation des arcs en béton ou en maçonnerie”. Le système proposé introduit dans les ouvrages, des articulations en trois points au lieu de deux: à la clef et à proximité de chaque culée. Avec cette innovation, il emporte le marché pour la couverture du canal St Martin, de 27,6 m de portée et 243 m de longueur. Cette réalisation lui assure une réputation qui va lui permettre de construire de nombreux ponts et de proposer des solutions hardies et novatrices, entre autres:
- Pont d’Amélie les Bains, en 1909, portée de 40 m
- Pont de Montauban, en 1911, deux arches de 53 et 56 m
Etant en contact permanent avec les chemins de fer, l’entreprise est au courant des préoccupations de son client et, en particulier, des problèmes et du coût des couvertures de hangars et ateliers, réalisées en charpente métallique. Simon Boussiron propose de réaliser les couvertures en voûte mince. Non seulement la dilatation est rendue possible par des joints mais il a l’audace de couper cette voûte par des lanterneaux, l’étanchéité de l’ensemble étant obtenue par un lissage au mortier de ciment. La première réalisation est celle de Bercy, 8 à 12 m de portée et 8cm d’épaisseur. Il s ‘agit d’une évolution fondamentale et les portées sont poussées à 28 m pour les ateliers de La Garenne-Bezons. La guerre de 1914 interrompt, les premiers mois, l’activité de nombreuses entreprises, dont Boussiron. La guerre de position qui s’installe montre bientôt que la guerre sera longue et qu’il est nécessaire de mobiliser l’ensemble de l’économie. L’action des hommes politiques (Alexandre Millerand, Albert Thomas, Louis Loucheur, puis Albert Claveille) conduit à définir trois priorités : armes, usines, centrales électriques. Il y a une forte demande de bâtiments nouveaux et Simon Boussiron est sollicité pour assurer, par exemple :
- Arsenal de Tarbes
- Poudrerie de Toulouse
- Ateliers de locomotives de Nevers
- Fonderie de Montbrison
- Ateliers de Nevers pour les Américains (17500 m2 et ponts de 60 T réalisés en 7 mois).
La reconversion, après la guerre est difficile. L’entreprise essaie de se diversifier et s’oriente vers les travaux publics , par exemple les travaux de renforcement et d’élargissement des ouvrages d’art pour le ferroviaire: Pont de la Haute Chaîne à Angers, portée 100m
C’est toutefois dans les grands ouvrages qu’elle tire parti au mieux de ses innovations:
- Pont sur le Lot en 1925, portée 91m
- Pont sur l’Oise à Conflans en 1929, portée 126m
- Pont suspendu sur la Durance, en 1931, portée 300m
L’entreprise entreprend aussi des travaux en Afrique du Nord :
- Viaduc de l’Oued Habra, Algérie, en 1930, portée 42m
- Pont en courbe sur l’Oued Korifla, Maroc, en 1931, portée 70m
L’année 1936 marque un changement important dans l’entreprise. Simon Boussiron vit assez mal les mouvements sociaux qui se sont développés partout et ne se sent peut-être pas l’interlocuteur idéal pour discuter avec les syndicats. Il décide de confier la direction de l’entreprise à son gendre Jacques Fougerolle,époux de sa fille Jeanne Solange Fougerolle, fille de Jacques et Jeanne Fougerolle, et petite fille de Simon Boussiron, décrit celui-ci comme quelqu’un de foncièrement bon, proche de son personnel, exigeant pour lui comme pour les autres, large d’esprit mais soupe-au-lait, capable de colères terribles mais réparant rapidement. Il avait probablement une approche plutôt paternaliste de l’entreprise qu’il avait créée de toute pièce, ce qui était courant à l’époque. Ceci est confirmé par le fait que de véritables dynasties ouvrières s’y étaient constituées. Il était reconnu par l’ensemble du personnel comme un grand patron, sachant recruter, motiver et soutenir les meilleurs, par exemple Nicolas Esquillan (Ch 1919) (voir AMM Ja-Fe 2003) ou André Forestier (Ch 1918). Une photo de 1949 réunit environ 200 cadres et employés de l’entreprise. A la suite du décès brutal de Jacques Fougerolle en 1965, l’entreprise est cédée en 1969 à la CFE, puis se retrouve en 1974 chez Bouygues où elle a pratiquement disparu. Il était Commandeur de la Légion d’honneur et une rue porte son nom à Perpignan. Son extrême discrétion fait que peu de choses ont été écrites sur lui mais on sait que son implication à la Société dans la mise en place de la 4e année à Paris (on disait qu’il ” couchait avec la 4e année), en 1947-1950 a été très importante. Il est décédé le 25 décembre 1958 et est inhumé à L’Etang-la-Ville (78)
Edmond De Andrea (Ai 45)
Emile Brizay

De la Malaisie à la Touraine, il a réuni l’imagination, la faculté d’adaptation et l’esprit d’entreprise
Nantes 1900 – Louveciennes 1983
Promotion Angers 1917
Il a réuni l’imagination, la faculté d’adaptation et l’esprit d’entreprise.
Emile Brizay naît le 25 février 1900 à Nantes . Son père était un instituteur très laïque, comme la plupart de ses confrères de l’époque, mais il était aussi très dévoué, conscient de sa mission, exigeant pour lui-même et pour les autres. Son oncle, frère de son père, très entreprenant, avait monté une société d’importation, achetant le charbon par péniches entières en Russie, le lavant à Rouen et le commercialisant . On voyait encore avant la dernière guerre des publicités pour le ” Charbon lavé à Rouen “. Il avait aussi mis au point avec l’aide d’un technicien, un tapis roulant pour accélérer les manutentions.
En 1916, peut être influencé par le milieu enseignant, il s’engage et fait les deux dernières années de guerre. On a en effet dit que le discours très patriotique tenu par les instituteurs de l’époque avait pesé sur l’engagement en faveur de la guerre de la population, on le leur a même reproché. Il sort de la guerre indemne et on peut imaginer ce que ces deux années ont représenté pour un gamin de seize ans ! Son fils Claude raconte que son père n’a jamais parlé de son expérience des combats et n’a même jamais dit à ses enfants qu’il était titulaire de la croix de guerre. Celle-ci a été retrouvée par hasard, après son décès, au fond d’un tiroir.
Il entre aux Arts et Métiers d’Angers à la démobilisation et en sort avec une grande partie des autres promotions de guerre en 1921. A sa sortie, il travaille dans deux sociétés pendant deux ans, puis est embauché par Freyssinet, le père du béton précontraint. Il participe ainsi à la construction d’une des plus fameuses réalisations de ce grand ingénieur, le pont de Plougastel sur l’Elorn, ainsi que les hangars de Villacoublay. La construction se ralentissant : ” il n’y avait plus une seule grue dans Paris ” aimait-il à dire, il répond à une annonce de la Société Brossard-Maupin qui recherchait un ingénieur connaissant le béton précontraint pour sa filiale de Singapour, est embauché et part pour la Malaisie en 1926, ne connaissant pas un mot d’anglais. Il trouve là une intense activité à sa mesure, ayant à réaliser de remarquables ouvrages, souvent avec les moyens du bord (voir encadré). Il comprend aussi très rapidement qu’il peut, dans ce pays qu’il commence à connaître, tenter sa chance en créant son entreprise. Il démissionne en décembre 1928, retourne en France pour une période de congés. Il y rencontre en Algérie Madeleine Dyonnet, fille d’un fonctionnaire militaire, et ils se marient le 20 juillet 1929. Ils auront quatre garçons (qui deviendront stomato, architecte, ingénieur et avocat) dont trois sont toujours en vie. En septembre 1929 il revient en Malaisie, il crée donc son entreprise et gagne quelques contrats (voir encadré) malgré la période très difficile de la grande dépression, ceci grâce aux prix qu’il consent, se contentant d’un faible profit mais surtout tirant un gros avantage de sa connaissance technique des constructions en béton. Les choses s’améliorent à partir de 1934. Il s’installe alors définitivement à Singapour et, devant les difficultés de logement, se fait promoteur-constructeur : il achète un terrain de 6 hectares, le lotit et se réserve la première maison. Les autorités locales lui demandent d’appeler ce lotissement ” Brizay Parc “.
En 1940, il se range du côté de la ” France Libre “, devient fervent gaulliste et parle à la radio pour les francophones, un quart d’heure tous les jours, jusqu’à son départ pour l’Australie. Il héberge, à la même époque deux français, Pierre Boulle, l’auteur, après la guerre, de ” Aux sources de la Rivière Kwaï ” dont on a tiré le film ” Le Pont de la rivière Kwaï “, l’auteur aussi de ” La Planète des Singes “. Ils restèrent des amis très proches jusqu’à la mort de E. Brizay. Le deuxième français hébergé était Edouard Corniglion-Molinier, qui a servi dans l’aviation, est devenu Général de l’Armée de l’Air, Compagnon de la Libération et homme politique. A eux trois, ils avaient formé un petit groupe essayant de venir en aide aux Français pris dans la tourmente.

En décembre 1941, devant l’avance japonaise, l’Air Vice-Marshal anglais, voulant protéger les avions de l’armée, lui téléphone un jour à 6 H du matin pour lui demander dans quel délai minimum il pourrait construire des hangars, ses services lui ayant dit que ce serait 16 mois. Il répond qu’il a une idée et qu’il aurait un prototype pour le soir même à 18H. C’était une construction en bois, assemblage par clous. Il obtient le contrat pour en construire 150 … qui ne serviront jamais (du moins par les Anglais).
Les évènements font que son épouse, avec ses quatre enfants part, par avion, s’installer, fin 1941, en Australie. Il quitte, lui, Singapour en février 1942 sur un bateau hollandais qui, ne voulant pas se joindre à un convoi, échappe miraculeusement aux Japonais, le convoi, lui, ayant été coulé.
Sitôt arrivé, il se met à la disposition du Général Casey, un adjoint de Mac Arthur et lui fait part de son expérience de Singapour, entre autres de la dispersion des avions dans des hangars camouflés. Il est présenté à Mc Arthur qui le fait nommer Ingénieur consultant auprès de l’Ingénieur en chef de l’armée US. A ce poste il construit, en deux ans, des centaines de hangars dans les environs de Brisbane et Sydney pour abriter les avions, et, pour les construire, obtient l’importation de deux cargos (Liberty ships) de bois de l’Orégon. En effet les bâtiments construits étaient en bois y compris les poutres en treillis.
Parmi ces hangars, certains étaient destinés à abriter des avions, d’autres, beaucoup plus importants (largeur de 33 à 55m) à stocker les milliers de tonnes de matériel destinés à l’armée. Sa mission était de construire pour deux ans : ” si les hangars duraient plus longtemps, c’est que l’on avait dépensé trop “. Certains d’entre eux étaient toujours utilisés à la fin des années 1970 et le sont peut-être encore aujourd’hui. Le modèle de ces bâtiments a été d’ailleurs repris par les Anglais pour les besoins de l’armée en Inde.
Toujours en 1943, et dans les mêmes fonctions de conseiller, il propose une solution pour renflouer les bateaux coulés par l’aviation japonaise. Il veut utiliser des ballons gonflables, en toile, de 20 à 40 tonnes de déplacement, l’étanchéité étant obtenue par des ballons légers caoutchoutés faisant office de chambres à air. Ces ballons étaient amarrés au bateau coulé par du personnel plongeur. Un essai est fait le 3 décembre 1943 sur un remorqueur coulé par 30m de fond et est un succès à la suite de quoi il fait un rapport au commandement US sur la méthode utilisée, valable pour des bateaux jusqu’à 2000 tonnes. En 1945, il retourne en Malaisie et est chargé de reconstruire une grande partie des ponts qu’il avait construits avant la guerre et qui avaient été détruits. Il y passe trois ans puis décide de rentrer définitivement en France en 1948.
Il investit ses économies dans l’achat d’une propriété de 50 hectares en Touraine, après avoir prospecté en Normandie. Il arrache les vignes devant des vignerons scandalisés, et plante des pommiers et poiriers suivant la technique de Mr Bouchet-Thomas qui assurait une croissance rapide des arbres. Il avait connu ce botaniste quand il avait projeté cet investissement, une véritable reconversion. Les rendements étaient rapidement très bons mais les prix très concurrentiels. Il imagine alors de mettre sur le marché ses fruits à contre-saison, chose qui n’était pas ou peu pratiquée à l’époque. Il transforme pour ce faire, des caves à vin creusées dans le tuffeau en mûrisseries climatisées .
Quand on demande à son fils Claude comment il voyait son Père, il parle d’abord de son intégrité, ” c’était un honnête homme dans tous les sens du terme “. C’était aussi un homme d’engagement, son parcours l’a prouvé. Il avait la curiosité des choses et une grande imagination. Son fils architecte lui expliquant par exemple la peinture abstraite, il essayait de la comprendre alors que son milieu la rejetait. Sa sociabilité lui faisait aborder les gens sans réticence aucune et enfin son sens de l’opportunité lui a permis, au travers des péripéties de sa vie, de toujours rebondir.
En 1979, à l’Université de Singapour, lors d’une conférence sur ” Our world in Concrete and Structures “, un hommage appuyé sur ses réalisations lui a été rendu par le Professeur Jon Lim, et il a été reconnu comme digne de figurer dans les annales de l’Engineering de toute cette partie du monde Il est décédé le 16 mars 1983 à Louveciennes où il est inhumé.

Principales réalisations:
En France:
– Pont sur l’Elorn Hangars d’aviation à Villacoublay.
En Malaisie:
– Eglise catholique de Singapour Pont de Rasa
– Réservoirs à Batu Pahat en béton vibré
– Brizay Parc
– Pont de Muda River, un des plus longs de Malaisie
– Hangars avec poutres en treillis en bois pour l’armée.
Edmond De Andrea (Ai 45)
Sévérin Casacci
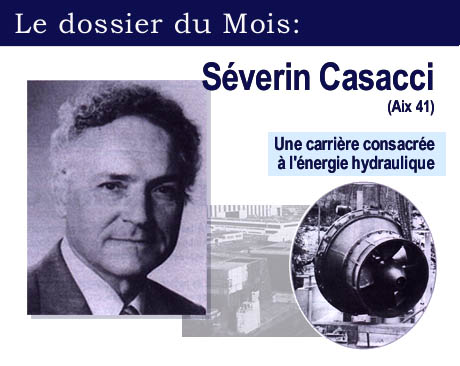
“Une carrière d’ingénieur ne pouvait suffire à absorber l’inlassable activité de Séverin Casacci”
Philippe Boulin, PDG de Creusot-Loire.
Carqueiranne 1923 – Meylan 1983
Promotion Aix 1941
Homme d’action, de sciences et de coeur, Séverin Casacci a consacré sa carrière à l’énergie hydraulique.
Il naît le 19 janvier 1923 à Carqueiranne, près de Toulon. Son père, ouvrier maçon et sa mère l’accompagnent dans ses études et s’investissent en lui ; il faut dire que ses aptitudes sont très tôt remarquées. Il poursuit ses études au lycée Rouvière à Toulon, puis à l’Ecole Pratique où il obtient un brevet industriel. En 1941, il est admis aux Arts-et-Métiers à Aix-en-Provence où son surnom, ” philo ” lui est donné. Son père décède en 1942, ce qui ne facilite pas matériellement la poursuite de ses études et, étant fils unique, il n’est pas boursier. Entré chez Pechiney en juillet 1944, il est appelé sous les drapeaux de juillet à décembre 1945 dans l’aviation comme élève-aspirant. .On peut dire qu’à partir de 1946 et jusqu’à sa mort, sa vie va être consacrée presque exclusivement à l’étude, à l’action professionnelle et à la réflexion humaniste.
Mathématiques
Le fil conducteur de ses études, c’est les mathématiques et la rigueur qu’elles imposent. Il obtient en 1946 les certificats de mathématiques générales et de mécanique rationnelle. Son employeur, Neyrpic, où il a été embauché en 1946, l’autorise à ” Préparer le certificat de calcul différentiel et intégral ou de mécanique des fluides … sous réserve de compenser le temps des cours par du travail le samedi “.
Chez Neyrpic, il prend la tête de l’équipe de jeunes ” Forts en maths ” dont fait partie, entre autres Jacques Bosc (Aix 1950) qui lui succèdera chez Neyrpic plus tard. Il va approfondir sans cesse sa maîtrise mathématique en utilisant, comme le dit joliment sa secrétaire, ” des formules à six étages et des équations dont la somme est toujours zéro “.. S’il est passionné de mathématiques, ce n’est pas à titre spéculatif mais pour résoudre des problèmes techniques difficiles et souvent, à l’époque, traités en partie à l’intuition, comme les vibrations hydroélastiques des structures, la mécanique des fluides des turbomachines, la résistance des structures.
Son parcours professionnel se confond entièrement avec le développement de Neyrpic pendant 37 ans, où il a été successivement ingénieur d’études, responsable des études de turbines, ingénieur en chef, directeur technique, directeur général adjoint. Il a écrit , seul ou en collaboration, plus de 50 articles et 4 livres techniques. A la sortie de la guerre, en 1945, Neyrpic était une entreprise moyenne grenobloise, mais ses dirigeants de l’époque avaient pressenti le rôle qu’elle pourrait jouer dans la reconstruction et le développement de ce pays ravagé qu’était la France. Ils embauchèrent de jeunes scientifiques, Séverin Casacci étant l’un de ceux-là.
Publication d’études
Ses premiers articles sur la pivoterie, les paliers et les frottements fluides des machines tournantes, paraissent en 1948 dans la Revue de la Houille blanche et le bulletin de la Société française des Electriciens. Il dépose avec deux autres cadres, la même année, un premier brevet sur la pivoterie. Même s’il s’est intéressé à des améliorations dans des domaines divers, ses études ont porté, dès lors sur les turbines de basses chutes et, en particulier sur les groupes-bulbes. L’idée ne lui appartient pas mais il a réalisé le premier prototype de ces bulbes à Castet. Avec Paul Jarriand (Cl 1945), il conduit les études de quatre autres groupes expérimentaux réalisés entre 1953 et 1956.
Entre 1954 et 1962, il est responsable des études Turbines et Régulation. A ce titre, douze articles paraissent sur la flexion des coques et l’équipement des basses chutes. Sa compétence est maintenant reconnue en France et à l’étranger où il donne des conférences, en particulier à Moscou et aux Etats-Unis. Il présente sa thèse d’ingénieur docteur en 1960 et commence à donner des cours de mécanique à l’Institut de Mathématique Appliquée de Grenoble. De 1963 à 1973, il est Ingénieur en chef de Neyrpic, division Energie d’Alsthom et aborde la technique difficile des turbines-pompes en coopération avec l’entreprise Bergeron, créée par Louis Bergeron. Les réalisations commencent avec l’usine marée-motrice de la Rance et Pierre-Bénite qui a été le point de départ de toute une génération d’usines.
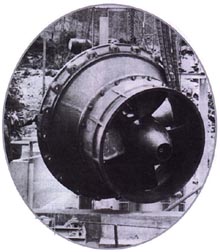
En 1966, il soutient sa thèse de Doctorat d’Etat es Sciences sur ” La flexion des coques minces “. Il fait paraître, une vingtaine d’articles sur les études de turbines. De 1974 à 1983, il est Directeur Scientifique et Technique de Neyrpic, au sein de Creusot-Loire et comme tel, il est amené à gérer les conséquences du choc pétrolier de 1973. Grâce à son niveau scientifique et technologique, Neyrpic résiste et reste dans les années 80, la seule société active dans son domaine. Une vingtaine de brevets sont déposés, Neyrpic et Séverin Casacci étant reconnus dans le monde entier et classés parmi les meilleurs mondiaux. A ce titre, des réalisations prestigieuses sont à signaler : l’usine d’Itaïpu au Brésil avec des turbines de 750 MW, taille jamais réalisée jusque là et la centrale de Love, aux Etats-Unis, construite et complètement équipée à St Nazaire, transportée par flottaison à travers l’Atlantique, remontant le Mississipi et l’Ohio pour y être installée.
Ce parcours illustre les qualités de Séverin Casacci, l’intelligence des choses, la faculté de synthèse, la capacité à traiter les problèmes par le haut à partir d’un concept général, la rigueur scientifique. Il faisait partie de ces rares Ingénieurs qui sont capables de trouver un juste équilibre entre les spéculations scientifiques et les réalisations dans l’action. Ce parcours met en relief aussi sa puissance de travail, son dynamisme, sa tension permanente vers un but, en un mot, sa passion.
Curieux et cultivé
On pourrait le croire complètement immergé dans ses études théoriques, ses réalisations industrielles, son enseignement à l’Université de Grenoble et sa participation à la création du Centre de Recherche et d’Essais de Machines Hydraulique de Grenoble, aussi est-on surpris de découvrir un homme dont les centres d’intérêt étaient multiples . On a dit que ses facultés d’assimilation et sa curiosité toujours en éveil lui avaient ouvert bien d’autres champs de connaissances, un peu à la manière des humanistes de la Renaissance. Il était passionné de musique, féru de littérature, érudit en histoire dans laquelle il marquait un intérêt particulier pour l’antiquité méditerranéenne. ” Attiré par toutes les civilisations du globe, depuis les Etrusques jusqu’aux Mayas, il revenait naturellement à ses ancêtres grecs et latins qui ont tant marqué sa Provence natale. ” Grand voyageur, sa pratique de quatre langues européennes, avec des notions de russe, lui facilitait les contacts et les négociations parfois difficiles qu’il avait à mener.
Ce parcours éblouissant était celui d’un homme qui, par son exemple, par sa facilité de communication et par la passion qu’il mettait en toute chose, savait entraîner les hommes. Ses collaborateurs avaient confiance en lui, sachant qu’il assumait et que l’on pouvait compter sur lui au plan technique et humain, dans les moments difficiles. Sa vie familiale est un élément important de son parcours. Renée Tétaz, aixoise, et Séverin se sont mariés en 1944 et leur premier enfant est décédé en bas âge, resserrant encore leurs liens. Il s eurent quatre autres enfants et son épouse a su le comprendre et l’aider en créant le climat familial qui lui a permis de pousser à sa limite l’exploitation des dons qu’il avait reçus. Si sa vie d’étude et d’engagements techniques, ses absences nombreuses, n’ont pas permis une présence continuelle, il restait très proche de sa famille par ailleurs admirative de ce qu’il accomplissait.
Il est décédé le 4 juin 1983 et est inhumé à Meylan.

Distinctions:
– Prix Oppenheim par la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale le 15 octobre 1981
– Officier dans l’Ordre National du Mérite le 21 janvier 1982
– Prix Nessim Habif par la Société des Ingénieurs Arts et métiers le 28 juin 1984
Edmond De Andrea (Ai 45)
Camille Cavallier

1854 – 1926
Promotion Châlons 1871
Près de Pompey (Meurthe et Moselle), les terrassiers trouvent dans les déblais des pierres gris rougeâtre. Intéressé par ce minerai, connu dans la région, Frédéric Mansuy, un négociant établi à Pont-à-Mousson, obtient la concession du gisement. En juillet 1856, il crée une ” usine à fer “, achetant pour cela six hectares au sud de la ville, entre route, voie ferrée et canal. (…) Il prend comme directeur Xavier Rogé (Ch. 1850), qui devient en 1865 cogérant de la société transformée par la suite en Société anonyme des hauts-fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson (…). Xavier Rogé connaît la famille Cavallier et ayant remarqué les qualités du garçon, conseille aux parents de l’envoyer aux Arts et Métiers de Châlons, où il est reçu en 1871. Après un an de service militaire, il entre à Pont-à-Mousson en 1875. Très vite, il est l’adjoint immédiat, l’ombre fidèle de Rogé, et lorsque ce dernier, atteint par la maladie, doit se retirer, sa succession est assurée.
En janvier 1901, l’assemblée générale des actionnaires nomme Camille Cavallier, administrateur unique à sa place avec les mêmes pouvoirs. Dès lors, l’histoire de l’homme et de la société vont se confondre pendant cinquante années. Pont-à-Mousson a, dès ses débuts, fabriqué des éléments de canalisations et rapporte d’Angleterre l’idée de couler les tuyaux debout et non plus couchés (…). Comme il se veut ” au milieu de sa ruche “, il fait construire sa maison contre l’usine, sur la route Nancy-Metz. Il peut être à la fois au chargement du fourneau, la nuit si un incident cassait le rythme des soufflantes, et à l’entrée matinale des bureaux, où il arrivait le premier…
Comme son prédécesseur, Camille Cavallier connaissait l’importance du minerai, et la chasse à la mine devient une véritable passion. Des premières recherches dans le bassin de Nancy sont sans succès. Des sondages sont alors effectués dans la région d’Auboué. La France a perdu, par le traité de Francfort, ses ressources du nord de la Lorraine. Bien que placé dans des terrains aquifères, le puits est réalisé en employant la méthode de congélation et, en 1913, Auboué est la plus importante mine de fer de France. Une nouvelle fonderie est installée à Foug, près de Toul, et la production atteint 187 000 tonnes en 1913.
Camille Cavallier pense que l’exportation est un impératif national et, sous son impulsion, un réseau commercial est créé et réparti sur les cinq parties du Monde. Rien n’est épargné pour le rendre solide et efficace, en particulier dans le choix des hommes, formés pour être envoyés à l’étranger, mais ayant une tête suffisamment solide pour ” résister aux charmes des tropiques ” et conserver sous tous les cieux les vertus lorraines et l’esprit maison. Les résultats sont à la mesure de l’énergie déployée. En 1913, le tonnage de canalisations exporté atteint près de la moitié du tonnage coulé.
La Première Guerre mondiale frappe directement Pont-à-Mousson, aidé de son frère Henri (Ch. 1884) et de quelques collaborateurs non mobilisés, Camille Cavallier met sur pied un programme considérable de fabrication de guerre. À la fin du conflit, 20 {7c045177abe3e375b80fdc991a35b0c620d25696bff93cbc663732b700147d79} des obus français de 155 en fonte aciérée sortent de Foug. Mais la Lorraine est trop près du front, et après avoir parcouru la vallée de la Seine, il achète 50 hectares à Saint-Étienne-du-Rouvray entre chemin de fer et fleuve, et confie à Marcel Paul, son gendre polytechnicien, entré chez Pont-à-Mousson en 1906, les destinées de la nouvelle usine (…).
Plus que jamais, pendant ces quatre années, la vie de la société s’identifie à celle de son dirigeant : création d’usines, prospection minière, développement des fabrications, l’entraînant à de multiples déplacements. Administrateur unique, il fait nommer, en 1917, un conseil d’administration, et désigne son gendre comme successeur. À partir de l’armistice de novembre 1918, la vie de la société tient en trois mots impératifs : reconversion, reconstruction, expansion, utilisés avec une énergie indomptable.
Pour l’implantation du siège administratif de la société, Camille Cavallier choisit non pas Paris, où il s’était replié, mais Nancy, car ” le chef industriel doit être au centre du groupe “. Ce regroupement à proximité des usines accélère le mouvement de reconstruction. Et tant que la société n’a pas retrouvé sa production d’avant-guerre, il travaille, sans un instant de repos, menant de front tous les problèmes techniques, financiers, sociaux, reconstruction des usines, réadaptation aux fabrications de paix. Le premier haut-fourneau en état est solennellement allumé par le président Raymond Poincaré le 23 novembre 1919 (…).
Le 18 octobre 1925, un vibrant hommage est rendu à Camille Cavallier pour son jubilé industriel. Il est un des rares chefs d’entreprise dans l’industrie lourde à s’être élevé au dessus des problèmes de gestion pour assigner à l’entreprise des objectifs d’ordre moral et dégager les principes d’une éthique industrielle. Et ce jour-là, il s’exprime ainsi : ” Travailleur acharné moi-même, je mets le travail au-dessus de tout. Le travail, retenez cela, les jeunes, comporte en lui-même toutes les récompenses. Il donne la santé de l’esprit, il donne la santé du corps, c’est le refuge en toute chose. Le travail est la base de la dignité humaine “. Et il a fixé un but élevé à la société : ” Donner du bien-être, soulager des misères par le travail, la solidarité, élever moralement tous ceux sur lesquels on a quelque action “.
Le 5 juin 1926, il confie par écrit à son collaborateur et ami de toujours, Charles Grandpierre, qu’il est conscient de toucher au terme de son existence. Il meurt le 10 juin, à 72 ans, après avoir présidé la veille encore l’assemblée générale des actionnaires. Comme prévu, c’est Marcel Paul qui lui succède, assisté d’Henri Cavallier
Extrait de l’article de Jean Vuillemin (Pa 40), parut dans Arts et Métiers Magazine – Octobre 2002.
Paul Cayère
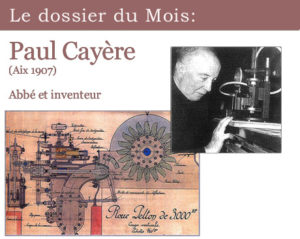
Ce qui frappait dans son intelligence, c’était la faculté d’aborder les sujets les plus divers associée à un pouvoir de pénétration peu commun. André Bérard (Cl 1924)
Grenoble 1892 – Grenoble 1967
Promotion Aix 1907
“Ce qui frappait dans son intelligence était la faculté d’aborder les sujets les plus divers associée à un pouvoir de pénétration peu commun.” André Bérard (Cl 1924).
Paul-Elie-Alphonse Cayère naît le 25 juin 1892 à Grenoble, 9 rue Billerey, dans le quartier Saint Laurent, fils de Paul-Jean Cayère, gantier et de Marie Ageron, son épouse. A la fin du 19e, vivait là un milieu populaire d’une petite classe moyenne, employés ou artisans, traditionnel et de grande conscience professionnelle. Il prépare à Vaucanson le concours aux Arts et Métiers où il entre en 1907, 4e sur 112, l’un des plus jeunes. Il en sort en 1910 avec une médaille d’argent. Il trouve son premier emploi à la Société Nouvelle des Moteurs Sabathe à Saint Etienne mais il décide, au bout d’un an, de suivre les cours de l’Institut Electrotechnique de Grenoble d’où il sort diplômé en 1912. Il y rencontrera Louis Barbillion, ancien de Sup Elec, le fondateur de cet institut en 1906, qui restera pour lui un maître vénéré tout au long de sa vie. La même année il commence à préparer son premier brevet sur les régulateurs tachyaccélérométriques pour turbines hydrauliques.
Il est incorporé en 1913 au 5e dépôt des Equipages de la Flotte et embarque comme matelot-dessinateur sur le cuirassé Paris qui assurera la protection des convois en Méditerranée. Il y restera pendant ses deux premières années de guerre, l’esprit en éveil et faisant son profit de l’étude des systèmes de régulation (torpilles et conduite du navire) utilisés sur ce bâtiment.
En 1916, ayant probablement fait le plein de ce qui pouvait satisfaire sa curiosité et alimenter sa réflexion, il est volontaire pour l’aéronavale, où il est nommé pilote débutant après sa formation et où il sera démobilisé avec le grade de Maître et la croix de guerre. Il fait alors équipe avec l’Enseigne de vaisseau Robert Montagne, qui enseignera en 1948 au Collège de France, et qui sera, lui aussi un de ses modèles. Entre temps, en 1917, il fait breveter son invention sur les régulateurs et en 1919, il rédige un mémoire sur la stabilité des aéroplanes, prélude à un brevet sur un viseur de bombardement.
Démobilisé, il entre chez Neyret-Beylier, qui deviendra Neyrpic après la seconde guerre mondiale. Il en sera l’Ingénieur en Chef et il assurera la paternité d’un certain nombre de brevets, toujours dans ses domaines de prédilection : la régulation et la métrologie. Dans ce parcours classique pour un brillant Ingénieur, intervient alors un changement radical. Il entre au Grand Séminaire en 1924 et est ordonné prêtre le 14 Juin 1930. Dire l’incompréhension du milieu grenoblois et même, pour certains, la consternation, est une évidence, d’autant plus qu’il semblait être un athée. Il n’est pourtant pas, pendant ses études au séminaire, hors du siècle. Il intervient, par exemple, dans son ancienne entreprise où il a été appelé en consultation technique. C’est après son ordination qu’il adopte ce qui sera sa signature désormais:
Abbé Cayère
Ingénieur A. et M. et I. E. G.
Après quatre ans d’affectations sacerdotales diverses pendant lesquelles il réfléchit et prépare ce qui sera son projet de vie, il fonde en 1935 l’Ecole Libre d’Apprentissage de Grenoble : l’ELAG. Il s’y consacrera toute sa vie sans retenue et en fera une réussite si l’on en juge par les résultats obtenus avec des moyens qu’il lui a fallu trouver car il a toujours refusé les subventions sollicitées, y compris celles de l’Église. Cette école était originale à plus d’un titre:
– Elle a été fondée par un Syndicat d’Apprentissage composé de patrons, de cadres et d’ouvriers
– La méthode d’enseignement s’appuie sur l’expérience et l’observation par la mesure
– Les élèves réalisent des fabrications pour l’industrie
– L’éducation vise à préparer des hommes responsables
Ce n’est donc pas une école technique comme il en existe déjà beaucoup à l’époque mais une école d’apprentissage, ce que Georges Charpak a bien illustré récemment avec son slogan : ” mettre la main à la pâte “. Paul Cayère utilise une formule choc , s’adressant à ses élèves : ” Soyez des cérébraux-manuels “.
Une école à bâtir à partir de rien, un programme novateur, pas ou peu d’argent, voilà un projet à sa mesure, dans lequel il s’investit totalement et qui est probablement pour lui une mission au sens chrétien du terme. Il est seul et sans moyens et pourtant réussit. En quelques années, il aura son école, ses machines et un nombre de candidatures à l’entrée qui l’oblige à faire une sélection sévère. Cette sélection est d’ailleurs bien dans l’air du temps, l’enseignement technique en général drainant les meilleurs éléments des classes primaires et primaire supérieure vers le technique. Les résultats sont bientôt là : la réussite au CAP atteint 100{7c045177abe3e375b80fdc991a35b0c620d25696bff93cbc663732b700147d79} et la renommée de son établissement franchit rapidement le cadre local.
En 1949, ayant déjà des soucis de santé, il demande à sa hiérarchie catholique de l’aider et l’enseignement général de son école est confié aux Frères des Ecoles Chrétiennes, lui-même se réservant les études techniques. L’effectif de l’école atteindra 150 élèves. S’ouvre alors pour lui une période très riche qui dure une dizaine d’années et pendant laquelle, dégagé des soucis administratifs, il dépose l’essentiel de ses brevets, une trentaine, et rédige ses articles d’enseignement ou résumés d’études la plupart publiés dans le bulletin trimestriel de l’ELAG. En 1959, les Frères ne pouvant plus assure l’enseignement général, quittent l’Ecole et il reprend le flambeau malgré un état de santé inquiétant.
Si l’on sent bien que la Régulation, au sens large du terme, c’est-à-dire la maîtrise du fonctionnement des systèmes en mouvement, et la Métrologie allant du comparateur à la mesure des états de surface, sont toujours ses deux domaines de prédilection, il s’intéresse aussi à d’autres domaines. On trouve par exemple, dans le bulletin trimestriel de l’ELAG d’avril 1957, une étude sur l’oreille intitulée : ” Un Mécanicien contemple la Création : L’Oreille. “
En 1959, les Frères quittent l’École et il reprend le flambeau, seul, malgré un état de santé inquiétant. Son œuvre a survécu ; elle existe toujours aujourd’hui. Quelques uns des articles :
– Les régulateurs de turbines hydrauliques (Arts et Métiers octobre 1927)
– Métrologie des angles
– Métrologie des états de surface:1962
– Le niveau à bulle: 1962
– Recherches expérimentales sur le contrôle opératoire (tournage, rectification…)
– Rugomètre à empreintes
– Un pionnier de l’automatisme, Louis Barbillion et l’École grenobloise de régulation
Pratiquement tous les bulletins de l’ELAG comprennent un article de Paul Cayère, souvent couplé avec un catalogue de prix des outils pour la métrologie fabriqués par l’Elag
– Études sur l’oreille et le grain de blé.
Nous n’avons pas de documents concernant personnellement Paul Cayère et son ascendance. Il n’a pas de descendance directe ou indirecte pouvant témoigner. On ne sait rien de ses premières années ni de sa famille d’origine ; les trous dans la partie privée de sa biographie sont d’ailleurs très grands et pour appréhender l’homme, on en est réduit aux hypothèses. On sait seulement qu’il avait une sœur décédée sans enfant. Le seul témoignage, à notre connaissance, sur ce qu’était l’homme Paul Cayère est de André Bérard (Cl 1924) , un ami proche, qui a écrit un article dans Arts et Métiers d’octobre 1967. Il écrit : ” Tout ceci ne donnerait de Paul Cayère qu’un image bien incolore si l’on taisait sa foi chrétienne. Ne pas en parler serait le trahir. Seule pourrait retenir la crainte de ne pas être assez délicat vis-à-vis de la conscience de nos camarades qui ne partagent pas sa foi…. Pour lui qui a créé toute sa vie, Dieu était d ‘abord le Créateur dont il contemplait l’œuvre à travers les lois de la mécanique qui lui étaient si familières, et dans la nature qui ne cessait de l’émerveiller. “
Trouver, à ce point, chez le même homme, la Raison et la Foi, la Science et la Religion, n’est pas courant, du moins chez les ingénieurs. Claude Bernard, cité par Pierre Chaffiotte (Cl 1935) dans son ouvrage ” Le Charbonnier et le Savant “, écrit : ” le pourquoi des choses dépasse nos possibilités d’analyse, nous devons nous contenter du comment “. La vie de Paul Cayère montre portant qu’il avait trouvé ” son ” équilibre avec la Foi et la Raison.
Il est décédé le 26 février 1967 après avoir subi l’amputation des deux jambes et est inhumé à Grenoble, au cimetière Saint Roch.

En 1912, Paul Cayère illustre à l’encre de Chine son rapport de stage dans une usine hydroélectrique.
- Quelques brevets:
- 496926 en 1917: Régulateur de vitesse à action indirecte (Tachyaccélérométrique)
- 552010 en 1921: Tachymètre à force centrifuge (brevet Neyrpic)
- 563760 en 1922: Mécanismes répartiteurs réalisant automatiquement entre les machines motrices d’une usine la répartition de la puissance qui donne le rendement optimum de l’ensemble
- 955610 en 1947: Dispositif de triage et classement des poudres fines
- 1024183 en 1950: Brides autoclaves pour fluide surchauffé à haute pression
- 1084711 en 1953: Servo-micromètre pneumatique
- 1245665 en 1959: Appareil pour mesurer la rugosité, à coupe virtuelle par empreintes
Edmond De Andrea (Ai 45)
Pierre-Philippe Chaffiote

Le Creusot 1917 – Voisins-le-Bretonneux 1998
Promotion Cluny 1934
Ce spécialiste de la mécanique fine des moteurs a déposé plus de 30 brevets au cours de sa carrière. Ce qui ne l’empêcha pas de multiplier les engagements associatifs.
Pierre Chaffiotte naît au Creusot le 28 janvier 1917, après une sœur et un frère, Philippe (Cl. 20), d’un père contremaître chez Schneider. Il prépare les Arts et Métiers à l’École spéciale du Creusot avec un fils de voisins, Jacques Cliton (Cl. 35). Il y est admis en 1934 mais, malade, ne peut intégrer qu’en 1935. Il en sort major. Polytechnique et Centrale lui proposent l’admission directe en deuxième année, mais sur les conseils de Pierre Pillot (Li. 23), délégué général de la Société des Ingénieurs AM, il cherche à entrer à l’École des moteurs, alors dirigée par Paul Dumanois, inspecteur général de l’Aéronautique et spécialiste des moteurs Diesel. Il essuie d’abord un refus poli mais, recommandé par Jean Fieux (Cl. 1902), il est admis avec huit autres élèves et termine major en 1939. Peu après sa sortie, Pierre Chaffiotte travaille quelques jours chez Hispano-Suiza (HS), est mobilisé comme aspirant à l’École d’application d’artillerie de Fontainebleau, puis en sort en janvier 1940, encore une fois major. Engagé avec sa division sur le front de l’Aisne, il est fait prisonnier et part en captivité.
Les Allemands ne considérant pas les aspirants comme des officiers, Pierre Chaffiotte est interné en Stalag et non en Oflag. Homme d’action, il réunit en association les aspirants du camp, ce qui lui permet de discuter avec les responsables du Stalag des conditions de détention: en effet, il parle allemand.
Il devient ainsi “l’homme de confiance” des aspirants à Stablack: c’est dans ce camp que la majorité des “aspis”, population turbulente, a été groupée. Les prisonniers “transformés”, c’est-à-dire ayant choisi de travailler comme “travailleurs libres”, parmi lesquels on comptait des aspis, étaient principalement affectés à l’agriculture. Ils étaient donc dispersés et Pierre Chaffiotte, aidé d’une équipe, était chargé de veiller sur eux en relation avec le ministère de l’Agriculture allemand. Il a ainsi contribué à organiser leur rapatriement en 1945. Ces activités n’ont à aucun moment franchi la frontière de la collaboration, malgré la pression de certaines personnalités françaises. Pierre Chaffiotte est toutefois appelé à se justifier à son retour en France, ce qu’il fait par un rapport détaillé. Le dossier est ensuite clos. Après son retour, il épouse Elisabeth Gravey. Ils auront 4 enfants et 10 petits-enfants.
En 1945, il revient chez Hispano-Suiza et y restera jusqu’en 1973. Il devient directeur technique du groupe en 1962. Il y déploie ses talents d’ingénieur, d’abord dans l’aéronautique et surtout dans les moteurs. En 1939, il avait admiré chez HS le moteur à pistons 12Y, qui équipait les avions de chasse Morane 406. Porté à 1 000 CV, il donnait une très belle machine, malheureusement supplantée par le fameux ME 109 allemand qui utilisait l’injection directe du moteur Daimler-Bentz 601. En 1946, Pierre Chaffiotte, alors ingénieur d’essais, participe à l’évolution du 12Y en 12Z. Envoyé au sein d’une équipe chez Rolls-Royce pour se familiariser avec la technique des premiers avions à réaction, il découvre le prototype du premier turbo-réacteur, le Nene, dont Snecma acquiert la licence en 1951. Il équipera, entre autres, l’Ouragan et le Nord 2200. Pierre Chaffiotte met au point la postcombustion montée sur l’Ouragan, qui mènera une belle carrière. Snecma produira 3 500 turboréacteurs Nene. Mais cette activité militaire, essentiellement due à des commandes de l’État, est progressivement détournée d’HS vers Snecma. Il faut alors trouver un plan de charge hors aéronautique. D’où la mise au point de turbocompresseurs, d’abord pour les diesels de la SNCF, et plus généralement des turbomachines, parmi lesquelles les turbines à gaz industrielles. HS acquiert ainsi une expérience dans les grandes vitesses de rotation et les aciers inoxydables, ce qui lui permet d’aborder le nucléaire. Le groupe crée, par exemple, des pompes à sodium pour la pile Rapsodie. Cette activité prend toute son importance avec la fourniture des compresseurs à hexafluorure d’uranium pour l’enrichissement en uranium des usines de Pierrelatte, puis de Tricastin (usine Georges Besse). Dans le nucléaire encore, l’expérience de la mécanique fine de HS l’amène à participer à la mise au point des installations qui ont équipé Mururoa, pour la première explosion nucléaire de 1966, en présence de Charles de Gaulle et à laquelle il assiste également, ce qui ne va pas sans lui poser un grave cas de conscience.
Un homme de réflexion.
Le dévouement de Pierre Chaffiotte envers la Société des ingénieurs AM a été constant et il a fait partie des instances représentatives pendant 13 ans, dont 3 ans comme vice-président Enseignement (il est notamment l’auteur d’un rapport sur l’évolution de l’École), et 3 ans comme président. Durant ce dernier mandat, il a la lourde charge de négocier le nouveau statut de l’École avec les pouvoirs publics, en souffrance depuis de nombreuses années. Il obtient de préserver les caractéristiques de la formation Arts et Métiers. Il faut ajouter à ses mandats la présidence du Centre de Paris en 1979. Il reçoit de la Société le prix Nessim Habif en 1989. Pierre Chaffiotte a aussi été vice-président de la Fasfid (Fédération des associations et sociétés françaises d’ingénieurs diplômés) en 1964; membre du conseil des Ingénieurs civils de France, de la Société d’encouragement pour l’Industrie nationale et du comité directeur du CNISF (Conseil national des ingénieurs et scientifiques de France). Il était également un homme de réflexion, on peut dire un penseur. Ceux qui ont lu son livre, “Le charbonnier et le savant”, connaissent l’étendue de sa culture scientifique jointe à une argumentation serrée. Ces qualités lui ont permis d’aborder le thème de la foi et de la science dans une étude de haute tenue, imprégnée d’une culture de fraternité entre les peuples. Il était doté d’une forte personnalité et ne refusait jamais l’engagement. Esprit scientifique par la rigueur et l’analyse, il était aussi profondément ingénieur par la faculté de trouver les solutions pratiques à ses analyses. Ses camarades ont gardé de lui l’image d’un grand gadzarts. Une maladie a affecté ses dix dernières années; il est décédé le 24 décembre 1998 et repose à Voisins-le-Bretonneux. Il était chevalier dans l’ordre national du Mérite depuis 1967, dans la Légion d’honneur depuis 1988 et avait reçu la Croix de guerre 1939-45 en 1940.
Edmond De Andrea (Ai 45)
Charles Clerc

Bilbao 1908 – Nancy 1967
Promotion Châlons 1927
Chapô : Mon cher ami, Très touché de votre lettre au moment où vous quittez l’uniforme, je vous remercie encore une fois de l’impulsion que vous avez su donner à votre service. C’est vous qui avez animé cette direction des matériels qui nous a permis de réaliser nos performances de guerre. Et maintenant au travail, luttez, produisez, relevez le Pays. Général Leclerc (2e DB)
Charles Clerc est né le 20 mai 1908 à Bilbao où son Père, Victor Clerc ( Ch 1891), était ingénieur aux usines Solvay. Charles fait ses études à Dijon et entre aux Arts et Métiers, à Chalons en 1927. A sa sortie, il fait son service militaire qu’il termine comme sous-lieutenant de réserve au 510e régiment de chars de combat à Nancy. Il entre alors en 1931 aux ” Laiteries Saint Hubert “, à Nancy, entreprise fondée par Mr Couillard qui avait deux fils (Louis, Pierre) et une fille (Simone) qu’il épouse en 1933.
A la déclaration de guerre, il est mobilisé comme lieutenant de chars mais la ” drôle de guerre ” ne le satisfait pas et il part volontaire pour la Syrie où il est affecté au bataillon de chars de Homs, et, en tant que Gadzarts, au matériel. Après l’armistice, il prend connaissance de l’appel du 18 juin 40 et décide de se lancer dans la grande aventure. Il quitte Homs avec un convoi de camions, rejoint à Haïfa la 3e compagnie du 24e RIC, passée en Palestine (anglaise). Le 2 juillet, un escadron de spahis rejoint à son tour. Le 18 juillet, tous les contingents français ayant fait ce choix se retrouvent à Ismaïlia, sur les bords du canal de Suez. D’autres groupes de Français rejoignent et l’ensemble constitue alors le ” 1er bataillon d’Infanterie de Marine “. Avec un équipement minimum, la 1re compagnie, celle du capitaine Folliot, ou sert C.Clerc, rejoint la 7e division blindée du général Wawell, ” Les rats du désert “, qui engage les premiers combats. La 1re compagnie y participe et y compte ses premiers morts. Une série de victoires suit, parmi lesquelles un raid sur Tobrouk où le lieutenant Clerc capture six postes de défense ennemis. Churchill pourra annoncer aux Communes : ” La Prise de Tobrouk par les Forces Britanniques et les Forces Françaises Libres “. Pour marquer la reprise des opérations de guerre, le général De Gaulle nomme les premiers Compagnons de l’Ordre de la Libération, sans distinction de grade, parmi les hommes de la 1re compagnie., C. Clerc avec le n° 34 le 7 mars 1941 avec la croix de la Libération et une citation à l’Ordre de l’Armée. (Un 2ème Gadzarts a reçu la Croix de la Libération : Louis Magnat, Cl 1932 le 13 juillet 1945).
Les combats de Cyrénaïque et de Tripolitaine des années 1941, 42, 43 ont été une suite d’aller-retours des adversaires, fonctions des renforts reçus de part et d’autre. Ce n’est pas le propos de cet article de détailler ces combats, l’excellent ouvrage de Marcel Fels (Ch 1928) faisant référence. En ce qui concerne C. Clerc, il a été de tous les combats, d’abord au feu, puis comme organisateur des moyens mécanisés, essentiels dans cette guerre de mouvement. En août 1941, il devient Chef du service auto du Levant (dotation des Unités, Atelier lourd de réparation, Maintenance) et, comme tel, rattaché à l’Etat-Major des Troupes. Les combats de Bir-Hakeim, Tobrouk, El-Alamein où les 1re et 2e brigades du général de Larminat se sont illustrées, sont dans toutes les mémoires. Quant au Commandant C.Clerc, après avoir créé de toutes pièces le premier Atelier Lourd mobile de soutien, il avait continué son œuvre d’organisateur et d’innovateur. On dit qu’un de ces Ateliers Lourds avait un camion-fonderie avec un cubilot !
Après la victoire du 4 octobre 1942 à El Alamein, , les ateliers du matériel eurent à fabriquer des pièces, presque en série. Grâce à la qualité du travail de ces ateliers, remarquable si l’on considère les moyens et les conditions de travail, la 2e DFL n’a perdu que 5 véhicules sur 2200, après un parcours de 2100km pour rallier la Tunisie, ce qui valut un message de félicitations du général Koenig transmis par le Cdt Clerc au personnel des ateliers (150 hommes). Le 31 juillet 1943, les forces françaises sont unifiées et les engagements au titre des Forces Françaises Libres sont clos. La 2e DB du général Leclerc se forme et C.Clerc y est affecté, où il retrouve Marie (Aix1920), puis son camarade de promotion Gaudet. Leclerc nomme C.Clerc Directeur du Matériel de la Division. ” Ses contacts efficaces avec les Services Américains, ses talents d’organisateur, sa bienveillante fermeté, son rayonnement humain permettent de servir dans les meilleures conditions toutes les Unités de la Division en chars, véhicules, canons, matériels de tous ordres . ” La 2e DB est transférée en Angleterre début 1944 et elle débarque à Utah-Beach le 1er août 1944. Les combats de Normandie, de la Libération de Paris, d’Alsace et d’Allemagne ont fait souffrir, on l’imagine tous les matériels et C.Clerc s’y est illustré. Il reçoit son 5e galon en novembre 1944. Il est démobilisé en juillet 1945.
Après ces années de ” bruit et de fureur “, Charles Clerc, Cincinnatus moderne, reprend à Nancy ses fonctions à la Laiterie de St Hubert. Il a certainement eu d’autres opportunités mais il a fait son choix. Il est probable que son épouse, co-actionnaire de la Société, qui avait totalement partagé son engagement dans la guerre et qui avait, elle-même, pris des risques sérieux durant l’occupation, a influencé cette décision, mais C.Clerc n’était certainement pas homme à faire un choix opposé à ses convictions. Il a montré par la suite qu’il n’a jamais utilisé ses relations de guerre et ses engagements pour en tirer un profit personnel. Ce n’était pas non plus un homme sensible aux honneurs, à la politique et à la médiatisation. Par contre il a toujours été disponible pour les autres, pour des œuvres locales et il était administrateur de plusieurs sociétés et organismes locaux.
Il s’est donc appliqué à participer au développement de la PMI qu’était son entreprise (3 millions d’Euros en 1952 et une centaine d’employés) . Ayant suivi des cours de biologie avant la guerre pour apprendre ” à sentir le microbe “, et par ses compétences dans l’organisation et la gestion des équipements, il était certainement un élément essentiel dans la direction de la société qu’il partageait avec son beau-frère Pierre Couillard. L’entreprise a beaucoup prospéré pendant vingt ans encore que nous n’ayons pu obtenir des chiffres précis ; en particulier, elle a pris le virage de l’agroalimentaire. Ce que l’on sait aussi, c’est que peu avant sa mort, des pourparlers avaient été engagés avec un grand groupe pour céder l’affaire . Ces discussions qui avaient lieu à Paris l’affectaient beaucoup car il se retrouvait, seul, devant une technostructure et cette situation, nouvelle pour lui, le faisait beaucoup souffrir.
On le décrit comme un homme toujours sous tension, sévère, exigeant, juste et respecté, mais humain ; quelques innovations sociales l’ont montré. Il adhérait aux idées d’avant-garde ; il pensait par exemple que la transmission automatique d’une entreprise au fils du fondateur ne devait se faire que si sa compétence était indiscutable, que, quoique n’en ayant pas souffert, les Traditions pratiquées à l’Ecole étaient obsolètes, que les méthodes de direction devaient être transformées. Il fallait toutefois être prudent car, comme il le disait à Pierre Devignot (Ch 1952) son petit-filleul : ” Les choix ne sont pas faciles dans la vie “. Que ce soit à titre militaire ou civil, un grand nombre de titres honorifiques lui ont été décernés (voir encadré). L’Établissement Régional du Matériel militaire, à Metz, porte son nom. Il est décédé le 2 janvier 1967 à Nancy et est inhumé au cimetière du Sud à Nancy.
Edmond De Andrea, Ingénieur A&M (Ai 45).
Extrait de Arts et Métiers Magazine Mai 2003.
Alexandre Correard

Le groupe principal est composé de M. Savigny au pied du mât, et de M. Corréard, dont le bras étendu vers l’horizon et la tête tournée vers M. Savigny indiquent à celui-ci le côté où se dirige un bâtiment aperçu au large par deux matelots, qui lui font des signaux avec des lambeaux d’étoffes de couleur (…). Croyant remarquer que la corvette signalée fait une route opposée à celle qu’on espère , le chirurgien Savigny indique à ses amis qu’ils se flattent en vain (…). Les hommes qui agitent leurs signaux poussent des cris de joie, auxquels répond M.Coudin, qui se traînent jusqu’à eux. L’une des victimes, presque mourante, entend cette clameur, qui pénètre jusqu’au fond de son cœur; elle lève sa tête décolorée et semble exprimer son bonheur par ces mots: “Au moins nous ne mourrons pas sur ce funeste radeau.” Derrière cet homme, abattu, exténué de maux et de besoin, un Africain n’entend rien de tout ce qui se passe autour de lui; il est morne, et sa figure immobile accuse la situation de son âme. Plus loin, dans un état d’anéantissement et de douleur, un vieillard, tenant couché sur ses genoux le cadavre de son fils expiré, se refuse à toutes les impressions de la joie que peut faire éprouver la nouvelle de sa délivrance […]. Enfin, ça et là, sur le premier et le second plan, des corps morts ou des malheureux prêts à rendre le dernier soupir.
A.Corréard et H. Savigny, Naufrage de la frégate La Méduse, 5e édition, Paris 1821
Serres 1788 – Avon 1857
Promotion Compiègne-Châlons 1803
Né le 08-10-1788, décédé le 16-02-1857, il fut Ingénieur, libraire et journaliste. En 1816 il participa à une expédition en partance pour le Sénégal en qualité d’Ingénieur-Géographe. Le 17 juin 1816 il embarqua à bord de la frégate La Méduse parmi 230 passagers. Le 2 juillet 1816, le navire échoue sur le banc d’Arguin au large des côtes Mauritanienne. Les tentatives pour remettre le navire à flot étaient vaines; le 5 au matin la décision d’évacuer fût prise. Les embarcations de bord étant insuffisantes, on construisit un radeau sur lequel montèrent 152 personnes.
Trois canots assuraient le remorquage du radeau, mais ils s’en séparèrent tour à tour. Le radeau et ses 152 passagers furent ainsi abandonnés au milieu de l’atlantique … bientôt tourmentés par le manque d’approvisionnement :
“Sur cet étroit théâtre, où tant de douleurs se réunissaient, où les plus cruelles extrémités de la faim et de la soif se faisaient sentir, des hommes vigoureux, infatigables, exercés aux professions les plus laborieuses, succombèrent l’un après l’autre sous le poids de la destinée commune[…]”(Corréard-Savigny).
“Parmi les malheureux que la mort avait épargnés, les plus affamés se précipitèrent sur les restes inanimés d’un de leurs malheureux frères d’infortune, mirent le cadavre en pièces et se rassasièrent de ce mets horrible. A l’instant même, beaucoup de nous n’y touchèrent pas. Ce ne fut que quelques temps après, que nous fûmes tous obligés d’en venir à cette extrémité.” (Coudein)
Après 13 jours de dérive, quinze hommes vivant furent recueillis par un navire envoyé à la recherche du radeau. Ils furent débarqués à Saint-Louis (Sénégal), les plus atteints transportés à l’hôpital; cinq y décèdèrent.
Ne survécurent que 10 hommes, parmi lesquels : Coudein (aspirant de marine), Corréard et Savigny (chirurgien de marine). Ces deux derniers relatèrent leurs émouvantes péripéties dans un récit publié un an plus tard.
Le peintre Géricault s’inspira du Naufrage pour réaliser l’un des chefs-d’oeuvre de l’école française.
Marqué à juste titre par ce naufrage, Corréard “garde une sorte d’excitation nerveuse”. D’aucuns le qualifièrement même, à certains égards déséquilibrés”. Cette suractivité se manifesta par la publication de nombreuses brochures, lesquelles provocantes lui valurent autant de procès.
‘Questions à l’ordre du jour’ (4 mois de prison et 1000F d’amende) ‘Le temps qui court’ (3 mois de prison et 400 F d’amende) ‘Pièces politiques’ (400 F d’amende)
Selon les rapports de la Police politique de l’époque, Corréard était en outre membre influent de “Chevaliers de la Liberté”, une organisation clandestine dont l’objectif était de proclamer l’avènement de Napoléon II et de renverser Louis XVIII.
En 1825 et 1828, il fonde succéssivement : “le journal des sciences militaires”,”Le journal du Génie Civil, des sciences et des Arts”. Puis il s’intéressa aux Chemins de fer et dessina notamment les plans de la future gare d’Austerlitz et le tracé de plusieurs grandes lignes.
“En 1848, il tenta sans succès de se faire élire député, se qualifiant dans ses affiches et son programme d’ingénieur de la Méduse. Il se retira dans sa propriété des Basses-Loges près de la forêt de Fontainebleau. Il mourut en 1857, âgé de quarante-huit ans et repose dans le cimetière d’Avon. On retrouva dans sa succession quatre aquarelles de la main de Géricault.”
Sources : Georges Bordonove, ‘Le naufrage de la Méduse’, édition Robert Laffont 1973 Prosper-Jean Levot, ‘La Méduse et autres naufrages’, éditions Raymond Castells 1998
Pour approfondir le sujet : Corréard et Savigny, ‘Naufrage de la frégate La Méduse faisant partie de l’expédition du Sénégal en 1816’. Paris 1817 Tonnelé Jean, Le naufrage de La Méduse, “Revue Historique de l’armée”, 1965 (n°1). Dutrech Jean, Le naufrage de La Méduse “Revue Franco-limousine”, Limouzi n°139, Paris 1908.
Document : Page de titre de la “Relation de Corrérd et Savigny” et le plan du radeau de “La Méduse”, édition de 1817.
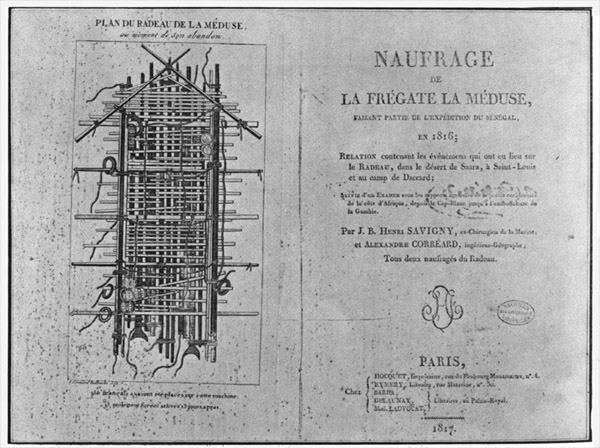
Charles Daudan
 Buste de C. Dauban, par Hippolyte Maindron (An.1816)
Buste de C. Dauban, par Hippolyte Maindron (An.1816)Paris 1790 – Angers 1868
Promotion Compiègne 1800 – Châlons 1806
J.-L. C. Dauban a lié son destin à la naissance des Écoles d’Arts et Métiers et à l’implantation en Anjou de la deuxième École, au cœur d’une période chahutée de l’histoire de France.
Né à Paris le 24 juin 1790 , J.-L. C. Dauban grandit dans l’atmosphère très patriotique de l’après-Révolution de 1789. Il aimait raconter qu’âgé de cinq ans, il récita au peuple la Déclaration des Droits de l’Homme, lors d’une fête nationale. Son père, d’Auban, fut un des auxiliaires les plus actifs du général Lafayette pour l’organisation de la garde nationale.
Il devient orphelin à dix ans : l’État l’adopte et le place au Prytanée militaire de Compiègne, puis le transfère à Châlons-sur-Marne. Son éducation terminée, Dauban reste à l’École d’Arts et Métiers de Châlons en tant que maître… à 16 ans ! Le 25 novembre 1811, il reçoit l’ordre de La Rochefoucauld-Liancourt de convoyer soixante élèves de Châlons à Beaupréau (du 28 novembre au 13 décembre 1811), où il dirige une partie des cours en tant que professeur d’arithmétique et d’écriture (1811-1815).
Avec la fin de l’Empire (1813-1815), la Vendée reprend les armes. Les souvenirs de la chouannerie n’étant pas éteints, la vieille querelle des Bleus et des Blancs se réveille. Dauban se jette à corps perdu dans la lutte avec la fougue de son âge et l’impétuosité de son caractère. Il forme une compagnie franche dont il est nommé capitaine par le sous-préfet de Beaupréau, avec l’accord de son directeur, M. Molard. En mai 1815, l’École quitte Beaupréau et se replie sur Angers dans le cloître du Ronceray. L’Empire s’écroule…
L’homme de la situation !
Compromis par son patriotisme, Dauban doit renoncer à ses fonctions en août 1816 et quitte l’Anjou. Il entre comme maître d’études au collège Henri IV et devient deux ans après sous-directeur de cet établissement, puis professeur de mathématique. Il est unanimement apprécié par ses supérieurs, mais aussi par les élèves et leurs familles. Le Duc d’Orléans, futur roi Louis-Philippe, qui a scolarisé ses deux fils, Ferdinand-Philippe duc de Chartres et Louis duc de Nemours, au collège Henri IV, n’oubliera pas ce sous-directeur et ce professeur aux états de services excellents. La Révolution de juillet éclate. Les Écoles d’Arts et Métiers négligées par la Restauration, du fait de leur origine impériale, retrouvent une certaine audience. J.-L. C. Dauban devient alors l’homme de la situation. Recommandé au roi, il est nommé directeur de l’École d’Angers par Adolphe Thiers le 28 janvier 1831, afin de restaurer cet établissement et de compléter son enseignement. À l’évidence, cette mission n’est pas une sinécure : bâtiments vétustes dans l’ancienne abbaye du Ronceray, ateliers incommodes et très limités, élèves indisciplinés… Mais en quelques mois, les résistances sont brisées, l’ordre matériel et moral se rétablit.
Dès 1832, Dauban supprime les ateliers d’ébénisterie et de serrurerie trop concurrentiels, et crée des ateliers plus près des préoccupations industrielles : fonderie et sa modèlerie, forge, ajustage. L’École acquiert en très peu d’années une réputation et un savoir-faire incontestables. Elle est récompensée de nombreuses fois lors de ses participations aux expositions industrielles. En 1835, suite à de nombreux vols, Dauban accepte les démissions des trois chefs d’ateliers et du responsable du magasin et nomme des personnes dignes de confiance. En 1836, le comptable, soupçonné, se donne la mort avant que l’enquête en cours ne confirme des détournements à son profit afin d’honorer des dettes de jeux.
Une autorité morale incontestée.
Comme au collège Henri IV, Dauban réussit à dompter la jeunesse et à l’entraîner vers l’amour du travail bien fait. “La discipline y est douce, tout s’examine et s’explique. Une sollicitude empressée et de tous les moments y tend plutôt à prévenir les désordres qu’à les réprimer…”. (*) C’est ainsi qu’indulgent pour les bons, inexorable pour les mauvais, l’habile directeur s’assure une autorité morale sans faille. L’obéissance de ses élèves reposait moins sur la crainte de la répression que sur un immense respect. De 1841 à 1861, Dauban entreprend des travaux considérables afin de renouveler complètement les locaux, côté Maine, le long de la rue du Godet, mais aussi rue de la Censerie et rue Creuse, y compris les premières machines à vapeur installées en 1848 pour assurer les entraînements des machines et des ventilateurs. Sous l’Empire, Louis Napoléon Bonaparte accorde enfin des crédits supplémentaires. L’achat de maisons particulières en 1854 et l’aménagement du Tertre permettent d’agrandir l’École et de réaliser de nouvelles constructions, bordant la rue de la Censerie. Ces bâtiments de 1857 restent l’image de l’École d’Arts et Métiers d’Angers. En 1861, La construction du grand bâtiment permet le doublement de l’atelier d’ajustage au rez-de-chaussée et la réalisation de trois salles de dessin au premier étage. La forge, la fonderie et sa modèlerie, l’ajustage donnent sur la cour des ateliers (à droite) nouvellement créée. Cette École a fière allure après l’élan donné par Dauban, directeur pendant 19 ans, jusqu’au 17 avril 1849, date de sa mise à la retraite anticipée suite aux agitations qui accompagnent l’avènement de la deuxième République. À l’évidence, Dauban paie ce bouleversement politique malgré les démarches pressantes de nombreux anciens élèves ainsi que du maire d’Angers. En réponse, Dauban reçoit la Légion d’honneur et est nommé directeur honoraire des trois Écoles d’Arts et Métiers.
Au cours de sa retraite, entouré de l’affection de sa seconde femme, il apprécie pleinement les succès de ses fils Charles-Aimé, professeur et auteur de nombreux ouvrages d’histoire contemporaine, et Jules-Joseph, (An. 1839), artiste peintre, directeur de l’École des Beaux-Arts et conservateur du musée des Beaux-Arts d’Angers. Sa fille Jeanne-Marie épouse un des membres les plus distingués de l’Université angevine.
Dauban participa activement à la création de l’Association des anciens élèves. En 1856, les anciens élèves le convient à Paris pour présider leur première fête fraternelle. Il est reçu avec de telles démonstrations de respect et d’empressement qu’il ne peut dominer son émotion et répondre à l’ovation qui lui est faite. Ce buste de Dauban, décédé le 11 mai 1868 à Angers, est l’une des œuvres d’Hippolyte Maindron (An. 1816 – voir AMM d’octobre 2001). Il est toujours visible sur la tombe de Dauban au cimetière de l’Est d’Angers. Cette sculpture funéraire a fait l’objet d’une souscription auprès des anciens élèves des trois Écoles.
Jean-Louis Eytier (Bo 68)
(*) Extrait d’une lettre au maire d’Angers en date du premier décembre 1836.
Emile Delahaye

Tours 1843 – Saint Raphaël 1905
Promotion Angers 1859
En 1900, les “Formule 1” françaises avaient pour nom Delahaye… Cet ingénieur a su intégrer, dans ses automobiles, les innovations qui en feront des mythes.
Émile Delahaye naît le 16 octobre 1843 à Tours, où son père, Pierre-François, est maître tapissier et son oncle, Théodore, ferblantier lampiste. Il entre à l’École impériale d’Arts et Métiers d’Angers le 1er octobre 1859 et, après deux années fort brillantes (il est major), en sort le 4 août 1863 avec la 4e médaille. Le jeune gadzarts commence sa carrière comme dessinateur aux ateliers Cail & Cie, spécialisés dans le matériel ferroviaire. On lui confie rapidement un poste d’ingénieur. Au cours de la guerre de 1870-1871, il est ingénieur délégué à la commission régionale d’artillerie du Nord-Ouest. La paix revenue, il réintègre la société belge Cail en tant qu’ingénieur en chef et épouse près de Tours, le 11 novembre 1873, Adèle Blanchet, fille d’un entrepreneur de travaux publics. Envoyé à Bruxelles, il est promu responsable de l’usine Cail Halot, mais il sera contraint de quitter ce bel emploi à cause du climat du Nord, que son épouse et lui supportent difficilement.
De retour dans sa ville natale en 1878, il prend la direction de l’usine de Louis-Julien Brethon, qui fabrique des machines agricoles et des outillages pour tuileries et briqueteries depuis 1845. Succédant au fondateur le 30 juin 1879, il développe considérablement l’entreprise et la diversifie avec la création d’un département de machines à vapeur, de moteurs à gaz puis à pétrole, ainsi que de pompes.
Ingénieur de talent, il crée, en 1888, un moteur à combustion interne pour les bateaux. L’année suivante, il obtient une médaille d’or et deux d’argent à l’Exposition universelle de Paris. Il décide de se lancer finalement dans la construction automobile. À l’époque, d’autres précurseurs tels Levassor, Panhard, Peugeot… réalisent aussi des voitures, mais à partir de moteurs à pétrole fabriqués sous licences allemandes, Benz ou Daimler. Émile Delahaye va créer et fabriquer la première automobile cent pour cent française, intégrant le châssis, la carrosserie et le moteur. Son premier modèle, la célèbre “Type 1” portant la marque Delahaye, est conçue et fabriquée 34 rue du Gazomètre, à Tours. Elle sera présentée et commercialisée dès 1894, puis lors du premier Salon de l’automobile qui se tient du 6 au 20 juin 1895 dans la galerie Rapp, au Champ de Mars à Paris. Dès le 15 octobre 1895, Delahaye prend le brevet français 251010 pour son fameux système de refroidissement en circuit fermé à eau, avec une pompe de circulation et un radiateur constitué d’un serpentin en cuivre rouge. Il est évidemment le premier à utiliser un tel système. C’est pour faire connaître la valeur de ses voitures qu’Émile Delahaye choisit, comme publicité, de s’engager dans la compétition. Il n’hésite pas à prendre lui-même le volant de sa Type 1, dans des courses mémorables, comme en 1896 la Paris-Marseille-Paris (1 710 km à parcourir en 10 étapes, à la vitesse moyenne de 25 km/h). Sa voiture, équipée à l’arrière d’un moteur à deux cylindres horizontaux bien équilibré, d’une puissance utile de 6 ch (régime normal 450 t/min), se comporte admirablement, malgré des conditions de courses abominables. Le refroidissement par circulation d’eau, dans des tubes repliés en serpentins disposés au-dessus des roues avant, se montre très performant. L’allumage est électrique : une bobine d’induction, alimentée par un accumulateur, dont l’avance réglable suit le régime du moteur. La transmission intermédiaire et le changement de vitesse se font par courroies et poulies. Les roues sont munies de pneumatiques Michelin. L’empattement est augmenté pour une meilleure stabilité, mais aussi une meilleure habitabilité. La plupart des concurrents en sont encore aux voitures hippomobiles (dont le moteur, à l’avant, remplace les chevaux et émet une odeur peu agréable), aux bandages en caoutchouc plein increvables, (mais peu confortables sur des routes caillouteuses), à l’allumage par des tubes de platine portés à l’incandescence (peu performant)…
Émile Delahaye aime se démarquer en faisant appel d’emblée à des solutions d’avant-garde dont il a l’entière paternité. Il ne copie pas, mais innove et se préoccupe de donner à sa voiture un aspect “élégant et élancé, qui habitue le regard à ne plus chercher les chevaux devant la voiture”.
Rapidement, les résultats des courses (premier au Paris-Dieppe en 1897, premier au Paris-Amsterdam-Paris en 1898) portent leurs fruits. Il se lance alors dans la fabrication “industrielle”, en série, des voitures. Il crée des montages d’usinage et des calibres pour chaque pièce. La qualité s’accroît, le prix de revient s’abaisse. Et, croulant sous les commandes, sa petite usine de 75 personnes ne peut satisfaire la demande. À tel point que, par manque de place, le montage des voitures doit être parachevé dans les rues voisines…
Dès 1898, une implantation parisienne se révèle nécessaire. Avec de nouveaux associés, Léon Desmarais et Georges Morane, la maison-mère se déplace au 10 de la rue du Banquier, dans le 13e arrondissement, à quelques pas de l’Ensam Paris actuelle. D’imposants bâtiments modernes sont édifiés. Là verront le jour de nombreux véhicules, la “gamme” s’échelonnant à travers le monocylindre de 1,4 ch et les bicylindres de 4,5 et 6 ch. Les premiers véhicules utilitaires, des autobus, apparaissent. Puis, en 1900, Émile Delahaye lance un nouveau modèle de voiture avec moteur de 14 ou 18 ch. Sous son impulsion, la firme se taille une grande réputation pour la qualité, la solidité extrême voire la robustesse de ses fabrications, ainsi que l’élégance et le confort de ses produits, mais aussi pour leur faible consommation, argument encore peu porteur à l’époque.
Cependant la santé affaiblie du fondateur complique les choses. Dès 1899, il doit s’entourer de collaborateurs talentueux, dont Charles Weiffenbach (1870-1959), le mythique “Monsieur Charles”, qui occupera successivement, de 1898 à 1954 (soit pendant plus de cinquante ans) les postes d’ingénieur en chef, de directeur des usines puis de directeur général.
Le 31 janvier 1901, comme envisagé lors de la constitution de la maison “Émile Delahaye et Cie”, Émile passe les rênes de l’entreprise qu’il a créée, développée, mise sur les rails du succès. Sa santé fragile l’a beaucoup diminué. Désormais, ses deux associés, Desmarais et Morane, sont seuls chefs de l’entreprise. Monsieur Charles veillera à l’évolution technique de la marque Delahaye et, dès 1906, à la bonne marche de l’entreprise. Ne souhaitant pas développer plus avant des voitures de course déjà trop éloignées des voitures demandées par la clientèle, la marque abandonne la compétition dès 1902, pour se consacrer uniquement et définitivement à des voitures de tourisme robustes, élégantes et économiques, ainsi qu’à des véhicules utilitaires. Mais l’innovation reste de mise. Delahaye utilise les moteurs à 4 cylindres. La (type) 10 B a droit à deux moteurs de 9 et 12 ch verticaux, placés à l’avant, mais le haut de gamme de la marque arrive à tirer 28 ch d’un “majestueux” 4,9 l. Ce qui fait, dès 1904, pas moins de 2 bicylindres et trois 4 cylindres, dont le plus huppé est déjà un… 8 l !
Émile Delahaye, retiré dans sa propriété de “La Roche fleurie” à Vouvray, non loin de Tours, meurt sans descendance le 1er juin 1905, à Saint-Raphaël (Var) où il était en villégiature. Il est inhumé à Vouvray le 7 juin 1905 dans la chapelle funéraire de la famille, en présence d’une foule nombreuse. Il n’assistera pas à l’incroyable réussite de sa marque. Rachetant de nombreuses sociétés, notamment Chaigneau-Brasier (Ch. 1880) en 1933 et Delage (An. 1890) en 1935, elle persistera pendant plus de soixante ans, jusqu’en 1955. Les voitures Delahaye survivantes sont parmi les pièces les plus prestigieuses des musées automobiles. Le Club Delahaye, particulièrement dynamique, fait revivre sur les routes d’Europe ce brillant passé, partie intégrante du patrimoine technologique français.
Jean-Louis Eytier (Bo 68)
André Ertaud

Sabarat 1910 – Montparnasse 2003
Promotion Paris 1928
D’abord engagé dans la marine de guerre, André Ertaud vivra un parcours hors du commun parmi les pionniers de l’énergie nucléaire.
Si André Ertaud a connu une carrière et une vie exceptionnelles, l’hérédité familiale n’y est certainement pas étrangère. Installé sur l’île de Trentemoult, en face de Nantes, sa famille véhicule une longue tradition de marins, de pêcheurs et d’armateurs (sept Ertaud ont péri en mer entre 1874 et 1908). Fait rarissime, les Ertaud bénéficient d’un double privilège : celui de pouvoir pêcher dans l’estuaire de la Loire, mais aussi d’exercer le métier de monnayeur à l’Hôtel des monnaies de Nantes. Son ancêtre direct, qui s’appelait aussi André Ertaud, occupa notamment cette fonction. André naît le 3 septembre 1910 à Sabarat, dans l’Ariège. Il est le fils de Fernand Ertaud et de Thérèse Delrieu. Fernand est cap-hornier et fils de Gédéon Ertaud, capitaine au long cours. André a un frère prénommé Jacques. Celui-ci deviendra cinéaste et réalisera, avec Jacques-Yves Cousteau, le célèbre documentaire “Le Monde du silence”. André et Jacques feront partie d’un groupe de spéléologues très liés à Haroun Tazieff, Maurice Herzog et Jacques-Yves Cousteau.
Après l’école primaire supérieure complétée au collège technique Lavoisier, André entre aux Arts et Métiers à Paris en 1928 et en sort dans les tout premiers en 1931. Il est admis la même année à l’École des ingénieurs mécaniciens de l’École navale et embarque pour la première fois en 1934, sur le torpilleur La Bourrasque, après le traditionnel tour du monde sur la “Jeanne”.
Débuts maritimes
En 1935, il navigue sur le croiseur léger “Émile Bertin”. Ce bâtiment étant très moderne pour l’époque, il atteint aux essais une vitesse de 37,9 nœuds (70 km/h). Il fait partie des rares bâtiments de la très belle flotte française de 1939 à avoir survécu à la guerre. Après une courte formation, il est affecté en 1940 sur le “Souffleur”, puis sur l'”Actéon”, des bâtiments sous-marins. La période 1939-1942 est très traumatisante pour le personnel de la marine de guerre française. Un bref survol de l’histoire des quatre bâtiments sur lesquels a opéré André Ertaud donne un aperçu de ces destins fluctuants et dramatiques.
En 1940, il épouse Yvonne Reverdy, décédée en 1998 ; ils auront trois filles et dix petits-enfants. L’année 1943 constitue un tournant essentiel dans la carrière d’André Ertaud car, détaché de la Marine, il s’engage entièrement dans une carrière scientifique. Successivement il suit une courte année à l’École supérieure d’électricité, obtient son doctorat ès sciences et est affecté au Collège de France. En 1945, on le charge d’une mission d’investigation scientifique à caractère militaire dans l’Allemagne occupée, avec succès puisque celle-ci lui vaudra la Légion d’honneur.
En 1946, il découvre le nucléaire et fera partie des ingénieurs ayant vécu l’épopée de ce secteur, de Zoé à Superphénix. À trente-huit ans, il intègre le Commissariat à l’énergie atomique tout nouvellement créé. Sous la direction de Frédéric Joliot-Curie, le CEA groupe une douzaine de scientifiques français qui lancent le pari de rattraper le retard français en la matière. Avant la guerre pourtant, la physique était un domaine où les scientifiques français tenaient un rang plus qu’honorable. Sur la célèbre photo du conseil de physique Solvay de 1927, qui réunit les meilleurs physiciens mondiaux, figurent trois Français : Marie Curie, Paul Langevin et Louis de Broglie, aux côtés d’Albert Einstein, Max Planck ou Niels Bohr. Cette équipe a vécu une aventure scientifique exaltante !. Désormais, il faut tout reprendre : élaborer les théories scientifiques, créer les technologies et même fabriquer certains composants. André Ertaud se sent d’emblée à l’aise dans cette tâche, car il cumule les connaissances scientifiques et technologiques nécessaires, assorties d’une expérience technique et humaine de la marine militaire.
L’aventure du nucléaire
L’intense collaboration de l’équipe du CEA se concrétise par la création de Zoé, première pile atomique européenne. Installée au fort de Châtillon, à Fontenay-aux-Roses, elle est activée pour la première fois le 15 décembre 1948 et est utilisée sans incident jusqu’en 1976. Cette réussite connaît un retentissement mondial et marque le retour de la France dans la compétition scientifique.
En 1954 se profile un ambitieux programme industriel : il comporte un volet militaire, la production de plutonium, et un volet civil, la production d’électricité nucléaire. André Ertaud, dont l’autorité est reconnue du fait de sa rigueur et de son expérience, est détaché à la Société alsacienne de construction mécanique (SACM), dans son tout nouveau département créé par Roger Julia, frère du grand mathématicien Gaston Julia. André Ertaud relève le défi du déchargement en service des deux énormes réacteurs G2 et G3, qui constitue une première mondiale.
Fin 1959, la SACM groupe ses moyens d’ingénierie nucléaire avec ceux des Chantiers de l’Atlantique, pour former le Groupement atomique alsacienne atlantique (GAAA), dont André Ertaud prend la direction technique. GAAA poursuit son développement et réalise de nombreux projets de réacteurs aux technologies très différentes : réacteurs à eau lourde ou refroidis par liquide organique, projets avancés de réacteurs gaz-graphite… Au début des années 70, se décide le remplacement des 9 centrales uranium naturel-gaz-graphite, malgré leurs excellents états de service, par des centrales équipées de réacteurs à eau sous pression fonctionnant à l’uranium enrichi de technologie américaine. André Ertaud s’investit alors de plus en plus dans la réalisation de Superphénix. Après un premier changement d’actionnariat, GAAA devient en 1976 Novatome, filiale de Framatome. À 65 ans, André Ertaud devient le conseiller technique du président du groupe de GAAA, mais il garde de ses dernières années d’activité un souvenir amer : il assiste à la levée d’une opposition passionnelle contre Superphénix, jusqu’à ce que le réacteur soit arrêté, malgré une dernière année d’exploitation sans incident. Il en restera très affecté.
Pour cet homme de rigueur, sérieux et réfléchi, seul un raisonnement argumenté est acceptable, y compris dans la sphère privée. On rapporte qu’au sein de son groupe de travail, il attendait de tous un investissement approfondi. Il pouvait, dans le cas contraire, se montrer odieux. Avec ce caractère entier, il compte quelques ennemis, mais aussi de nombreux fidèles. Sa fille, Florence, confirme ce trait de caractère. “On ne parle pas pour ne rien dire”, se plaît-il à affirmer, lui qui n’apprécie pas les bavards et le fait sentir, même dans les dîners privés. Il accorde peu d’importance à l’argent et la supériorité financière l’horripile, seul le travail comptant à ses yeux. Il fait par ailleurs preuve d’humilité et se rend abordable. Il s’intéresse également à des sujets très différents, mais toujours avec application et en examinant à fond chaque sujet. Lorsqu’il s’interroge sur le sentiment religieux, il étudie les grands penseurs ; de même, il établit une anthologie des poètes lorsqu’il s’intéresse à la poésie. Il aborde la musique en mélomane éclairé.
Ses 75 publications, sans compter les conférences, concernent essentiellement le nucléaire, mais quelques-unes portent sur l’optique électronique, sujet de sa thèse de doctorat. Ses cours à l’Ensam, à l’université Paris VI, au Cnam et à l’École de guerre remplissent plusieurs volumes. Il est également l’auteur d’un ouvrage en deux volumes : “Le second feu de Prométhée”, dans lequel il apporte des réponses aux questions récurrentes sur l’énergie. Enfin, seul ou associé, il fait breveter 7 découvertes. André Ertaud est également officier de la Légion d’honneur, officier d’académie, titulaire d’un “Exceptional Award of the American Nuclear Society” et capitaine de vaisseau de réserve. Il fait partie du Comité de la Société des ingénieurs Arts et Métiers de 1957 à 1960. Il décède le 25 décembre 2003 et est inhumé au cimetière Montparnasse.
Edmond De Andrea (Ai 45), avec l’aide et la compétence de Pierre Boiron (An 52)
Joachim Estrade

Beyrède-Jumet 1857 – Caunes en Minervois 1936
Promotion Cluny 1934
Si les premiers éclairages de rues à Paris datent de la fin du 17e siècle avec chandelles puis lampes à huile, il a fallu attendre le milieu du 19e pour voir le gaz de ville les remplacer, mais dès la fin du 19e, l’électricité arriva en force . Dans toutes les régions et surtout dans les villes d’une certaine importance, des pionniers se lancèrent dans l’aventure de l’électrification et un certain nombre d’entre eux réussirent Parmi eux, Joachim Estrade fut l’homme de l’électrification dans toute la vallée de l’Aude ( Aude et Pyrénées orientales).
Il est né le 9 janvier 1857 à Beyrède-Jumet (Hautes Pyrénées), fils de Jean Estrade, instituteur communal à Camous et de Jeanne Marie Mont, son épouse ; un des témoins à la déclaration de naissance est instituteur public à Beyrède-Jumet. Il passe sa petite enfance beaucoup avec son grand-père, un géant, ancien grenadier de la garde.
A douze ans, il est envoyé dans une institution religieuse mais il est renvoyé rapidement après avoir manifesté son indépendance en lançant un dictionnaire latin à la tête du père supérieur. Il est alors mis en pension au collège à Carcassonne où il prépare les Arts et Métiers et y est admis en 1873. Il en sort en 1876 major de sa promotion.
Il entre aux Ponts et Chaussées où il travaille aux chemins de fer. C’est ainsi qu’il est amené à connaître la haute vallée de l’Aude et ses habitants. Or dans les années 1880-90, on parlait beaucoup de l’éclairage par l’électricité, il fait un projet pour l’éclairage public de la ville de Quillan et le soumet aux édiles municipaux. Adjudicataire, l’éclairage public de Quillan avec 67 lampes remplaçant trois douzaines de lampes à pétrole, va lui servir de banc d’essai. En fait, pour ce nouveau produit qu’était l’électricité, les difficultés étaient de trois ordres : techniques, de concurrence avec un autre produit installé, le gaz, et d’ordre politique car la décision était le fait d’hommes politiques soumis aux pressions habituelles. Pour donner une idée des arguments contre l’électrification, on peut citer quelques perles:
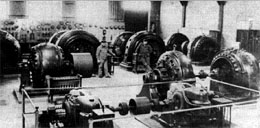
Faisons des vœux pour que le nouvel éclairage éclaire les électeurs (de Carcassonne) et leur fasse voir que les promesses républicaines ne sont que des mirages trompeurs. Des savants sont prêts à accuser le courant électrique de favoriser, par la condensation des bactéries, le développement des maladies épidémiques. Une lampe de 10 bougies donnant un pouvoir éclairant de un carcel, est équivalente à un bec de gaz ordinaire dépensant 105 litres à l’heure (suit un calcul démontrant que le gaz est moins cher.)
C’est dans ce climat que Joachim Estrade crée en 1891 son entreprise, la ” Société Méridionale d’électricité “ayant comme objet ” les usines, les forces hydrauliques et les forces électriques. ” S’enchaînent alors très rapidement les réalisations, par exemple:
- l'éclairage d'Alet-les-Bains en 1891
- l'éclairage de Carcassonne, à partir de 1891
- l'éclairage de Narbonne à partir de 1893
L’éclairage public ne doit pas faire oublier l’éclairage pour les particuliers pour lesquels il avait opté pour l’abonnement au nombre de lampes, rendu possible par l’invention du ” basculateur Estrade ” réglé pour couper le courant si l’on dépassait ce nombre. Distribuer l’électricité supposait que des usines soient construites, soit par reconversion d’usines existantes, soit par constructions nouvelles. Les villes ci-dessus ont été alimentées :
– Quillan, par reconversion d’une ancienne scierie pour une puissance de 40cv
– Carcassonne, par reconversion d’une usine au fil de l’eau, pour ” lainer et tondre les draps “, puis au début du siècle, par transformation de cette usine en centrale thermique pour une puissance de 300 kw.
– Narbonne, par une centrale thermique installée sur l’ancien ” terrain des pestiférés ” à proximité du canal de la Robine.

Distribuer voulait dire aussi transporter de l’usine aux villes une électricité qui était en courant continu, ce qui empêchait le transport sur de grandes distances. Une seule expérience industrielle en courant alternatif avait été faite en Italie, sans lendemain. Joachim Estrade conçut le projet de transporter sur une centaine de communes de l’Aude plusieurs milliers de KW sous une tension alternative de 20000volts. Cette décision, pour l’époque, était très audacieuse et les soutiens étaient rares. Pour ce faire, il créa une filiale, la ” Société méridionale de Transport de Force ” qui mit en service fin 1900 une première grosse centrale hydroélectrique dans les gorges de St Georges. Un canal d’amenée permettait de disposer d’une chute de 100m alimentant des turbines Pelton pour une puissance totale de 4000 à 6000cv suivant les saisons. Le transport du courant se faisait par une ligne en courant alternatif à 20000 volts. On imagine facilement les problèmes posés par l’installation d’une ligne dans un relief aussi accidenté (crêtes à 1000 m) et les problèmes ensuite de l’exploitation d’une ligne à haute tension ( orages, vent, neige, tenue des isolateurs, oiseaux de proie provoquant des court-circuits, animaux nuisibles dans l’usine, etc.) Après l’incendie de cette première usine, une deuxième est construite en 1914 à Gesse avec une chute de 200m, une puissance de 6000kw et une ligne de transport à 35000 volts.
Dépassant le problème de la seule production d’électricité, un barrage est construit ensuite à Puyvalador pour régulariser le cours de la rivière, très demandé par les agriculteurs pour l’irrigation, et permettant aussi d’exploiter par d’autres usines toute la haute vallée de l’Aude. Ce barrage poids, le seul à cette date barrant une vallée des Pyrénées, permet une retenue de 10 millions de m3 et est inauguré en 1928 par le Président de la République Gaston Doumergue, le premier discours étant celui de Joachim Estrade, accueillant les invités.
En 1936, les usines installées développaient une puissance de 44000cv et alimentaient par 3000km de lignes haute tension, 425 communes et 400000 habitants. On ne peut oublier, qu’en plus d’être un chef d’entreprise, Joachim Estrade a été vice-président en 1921 puis de 1924 à sa mort en 1936, président de la Chambre de Commerce de Carcassonne. Au delà des réalisations techniques telles que le ” poteau noir ” ou ” poteau Estrade “, obtenu par imprégnation de créosote, ce qui l’amène à s’inquiéter de la gestion des forêts, il a des vues d’ensemble de l’économie régionale où il s’impose rapidement. Il est d’ailleurs vice-président de la 10e Région économique. Il est soucieux des problèmes des agriculteurs ; il est un des premiers administrateurs de la Caisse Régionale du Crédit Agricole et en 1914, il offre à la Banque de France la signature de sa Société pour garantir un emprunt des vignerons. Il soutient la création d’une fromagerie coopérative à Saissac et contribue à créer le Frigorifique de Nissan , destiné à la fabrication du jus de raisin frais, pour écouler la surproduction viticole. Il crée enfin en 1920 la Société d’Electro-Motoculture pour vulgariser l’emploi de l’électricité à la ferme.
Il a acquis la réputation d’un ” patron social ” en créant au sein de sa Société , dès 1904, une caisse de prévoyance et d’assurance, puis de congés payés et des aides pour les études des enfants de ses employés. Veuf sans enfant, il épouse en 1926 Jeanne Marguerite Vinceneau qui avait deux enfants d’un premier mariage et dont il aura un fils, René. L’épouse de celui-ci, Céline Estrade, se souvient très bien de son beau-père et le décrit comme quelqu’un qui n’était pas seulement un ingénieur, mais aussi un commerçant et un homme d’entreprise aux vues très larges. Quelque temps avant sa mort, il épaule son fils qui reprend l’entreprise. Sa vie a été consacrée essentiellement au travail ; quand il prenait quelques vacances, c’était dans la propriété qu’il avait acquise dans l’Aude, entre St Denis et Saissac. Joachim Estrade est décédé le 13 février 1936 et est inhumé à Caunes Minervois. Il était Officier de la Légion d’honneur. Une rue porte son nom à Carcassonne et un monument rappelle son souvenir à Puyvalador.
Edmond De Andrea (Aix 45)
Jean Fieux
 Dompierre sur Mont 1886 – St Rémy 1969
Dompierre sur Mont 1886 – St Rémy 1969
Promotion Cluny 1902
Jean Fieux est né le 28 mars 1886 à Dompierre-sur-Mont (Jura), fils de Victor Eléonor Fieux, cultivateur et de Caroline Eléna Monnier, son épouse. Il est le troisième dans une fratrie de quatre, après une sœur, et un frère aîné qui reprendra la ferme familiale. Sa maison natale, à Dompierre est occupée aujourd’hui par un de ses arrière-petit-neveu.
Sa fille,Yvonne Caron, rapporte la tradition familiale par laquelle, dès son plus jeune âge il était un esprit inventif et observateur : ayant fabriqué un petit manège, il remarque que celui-ci tourne quand on le place dans la cheminée. Il dira d’ailleurs beaucoup plus tard : ” Tout ce qui tourne m’intéresse “. Reçu premier au certificat d’études, son instituteur veut l’orienter vers l’Ecole Normale mais il opte pour l’ENP d’Oyonnax, prépare le concours des Arts et Métiers et entre à Cluny dont il sort dans les tout premiers. Il est embauché en 1906 comme dessinateur chez Schneider, aux Ateliers d’artillerie du Havre. Mobilisé comme officier d’artillerie, en 1916, il est rappelé du front et affecté à cette même usine pour fabriquer des moteurs d’avion. Ces débuts peuvent paraître très modestes mais il s’est déjà fait remarquer par sa puissance de travail et son esprit inventif. En 1921 il est appelé au siège de Schneider à Paris, entreprise où il restera jusqu’en 1960.
Il épouse en 1906 Marie Michel-Schmidt, fille de Maurice Michel-Schmidt, directeur de l’usine Schneider de Chalons sur Saône, constructeur de la grande forme de radoub du Havre destinée à accueillir le Normandie ainsi que le pont Alexandre III à Paris. Deux enfants naîtront, une fille en 1917 et un garçon en 1921. L’Académie Bourdon, au Creusot, conserve une masse très importante de dossiers : documents, plans, notes de calcul, résultats d’essais, brevets, qui rendent compte de l’activité créatrice de Jean Fieux, celui que l’on a appelé l’homme aux 400 brevets, entre 1920 et 1960. On ne peut évidemment parler longuement, dans cette courte biographie, de tout ce qu’il a créé. On ne peut que donner quelques exemples de ses travaux . En particulier, on peut s’attarder un instant sur la gyroscopie. C’est en août 1910, il a 24 ans, qu’il élabore sa ” théorie élémentaire de l’effet gyroscopique “, c’est-à-dire du mouvement de la toupie. Les spécialistes savent que les forces engendrées par l’effet gyroscopique peuvent être considérables. Très succinctement, elles sont engendrées par ce qu’ils appellent la Précession, c’est-à-dire la force réactive qui s’exerce sur un corps de révolution en rotation rapide, quand on essaie de lui appliquer une force latérale extérieure qui perturbe ce mouvement. La difficulté réside dans la captation et l’utilisation de cette propriété et de son application à la correction de phénomènes dont on veut minimiser l’effet ou le supprimer, c’est- à- dire à transmettre cette force à des appareils autres que le gyroscope lui-même. On le fait au moyen d’une liaison plus ou moins rigide.
Ses inventions gyroscopiques

Appareils anti-roulis pour la marine (1925 -1928)
Équilibrage des gyroscopes, (1928-1929)
Transmission gyroscopique à embrayage contrôlé, (1914-1928)
Conduites de tir gyroscopiques pour avions (1946-1950)
Horizons artificiels -Télépointeur stabilisé pour l’artillerie de marine (1921-1938)
Cannelures d’ogives pour stabiliser les obus (1917)
Stabilisateur de caméra de télévision
Un exemple intéressant est celui du stabilisateur de roulis monté sur des navires . Les premiers essais de stabilisateurs de navires appelés gyrostats, soumis au roulis, ont été le fait de deux inventeurs, Schlick, autour de 1910, puis Sperry, au début des années 1920, mais les premiers furent décevants en eau agitée, et les seconds, plus efficaces, étaient très lourds (autour de 3{7c045177abe3e375b80fdc991a35b0c620d25696bff93cbc663732b700147d79} du déplacement du navire). Le gyrostat Schneider-Fieux, objet de nombreux brevets, présenté en 1927 et objet d’une communication à l’Association Technique et Maritime de juin 1928, est d’une efficacité remarquable par l’amortissement très rapide du mouvement de roulis, constatée par les diagrammes d’enregistrement . Son poids est inférieur à 1.5{7c045177abe3e375b80fdc991a35b0c620d25696bff93cbc663732b700147d79} du déplacement, moitié de celui du Sperry.. Disons que le principe était de jumeler deux gyros à rotations et précessions contraires. De nombreuses autres inventions sont du domaine de la gyroscopie. Si la gyroscopie l’a longtemps intéressé, il a exploré bien d’autres domaines de la mécanique, par exemple les catapultes-freins pour avions embarqués légers et lourds (1953-1955) ou les freins d’appontage dans les années (1926-1948). Le principe de ces derniers est toujours utilisé : cables placés en travers de la piste, enroulés sur deux tambours freinés. Enfin on ne peut oublier les études théoriques qui portent son nom ni son appareil d’expériences pour l’enseignement du gyroscope dans les écoles d’ingénieurs et les facultés.
Des études théoriques

Détermination des pouvoirs lubrifiants des huiles (1926)
La mécanique descriptive (1926)
Pouvoir lubrifiant des huiles (1920-1926)
Réaction au déplacement oblique de l’axe d’un gyroscope (précession)
Loi du frottement des disques ans l’eau
Frein pour torpilles (1938)
Calculs sur le mouvement de la Terre (énorme toupie)(1943)
Cette intense activité scientifique et technique ne doit pas occulter ses autres engagements, tous concourant à rapprocher les hommes dans leurs activités. Il était profondément attaché à une ouverture de l’enseignement technique. Cette filière était en effet indépendante de l’enseignement général, ce qui avait l’avantage de faciliter la sélection des meilleurs sans les voir systématiquement absorbés par l’enseignement général, mais avait l’inconvénient de les confiner dans une sorte de ghetto. Il a beaucoup œuvré pour réformer l’enseignement technique. C’est dans ce courant que, devenu Président de la Société des Anciens Elèves des Arts et Métiers entre 1946 et 1948, il s’est consacré à la mise en place de la quatrième année. On imagine les réticences de nombre de camarades qui voyaient dans cette évolution une perte d’identité et un affaiblissement de l’efficacité de la formation. On retrouve là la même difficulté que celle rencontrée un demi-siècle plus tôt, l’opposition des ” conservateurs ” et des ” libéraux ” (Voir Denis Poulot, AMM mars 2003). Il a d’ailleurs rédigé une plaquette intitulée : ” Les raisons de la quatrième année commune ” qui, après une analyse fine des évolutions scientifiques, techniques et sociales, présente le projet de ce changement de façon très convaincante.
Il faut mentionner qu’en corollaire de la création d’une quatrième année à Paris, il a apporté toute son autorité à rassembler la Société autour du projet de maison des Arts et Métiers à la Cité universitaire, permettant ainsi, par les dons reçus, d’en lancer le financement. Il était Président de la Société des Ingénieurs Civils en 1944 et dans cette période troublée, sa personnalité irréprochable a permis d’en atténuer les remous. Il assura aussi la présidence de la FASFID et facilita la création du Conseil national des Ingénieurs français. Après le grade de Chevalier en 1924, il a été fait Officier de la Légion d’honneur pour son travail d’inventeur et a reçu la cravate de Commandeur pour son engagement dans la réforme de l’enseignement technique. Il avait reçu en 1933 le prix de la Marine, décerné par l’Académie des Sciences. Enfin mentionnons la fondation à St Remy (71100), avec son fils, de la ” Cité d’entraide sociale “, connue sous le nom de ” Cité Jean Fieux ” dont la famille est toujours actionnaire.

La transmission gyroscopique Fieux, d’une grande souplesse,
était applicable à la traction ferroviaire.
Ce bilan extraordinaire laisse supposer un esprit toujours préoccupé par les problèmes qui lui étaient posés et par ceux que repérait son inlassable curiosité. Comment était-il perçu dans sa famille et à l’extérieur ? Homme intègre, fidèle à ses engagements, bourreau de travail, exigeant même pour les études de ses enfants, ne tirant pas la ” couverture à lui “, certainement avec beaucoup de respect et d’admiration. Il a probablement laissé quelques regrets dans son entourage pour sa disponibilité réduite et une chaude présence qui aurait été appréciée. Il avait des amis, surtout parmi les Gadzarts mais les voyait peu, pris dans le tourbillon de ses projets. Dernière touche de ce portrait rapide, il était très amateur d’opéra. Mobilisé en 1914, officier, il partageait avec un de ses compagnons, choriste à l’Opéra, cette passion et, au repos, ils chantaient, sa voix étant qualifiée de ” ténor quart de tour ” ? C’est ainsi que, rapporté par sa fille, il marchait de long en large quand il réfléchissait et parfois chantait des airs d’opéra. Il est décédé le 6 avril 1969, et la veille, il travaillait encore à un mémoire sur les anomalies de la rotation de la terre, œuvre inachevée. Il est inhumé à St Remy (71100).
Edmond De Andrea (Aix 45)
Hippolyte Fontaine

Dijon 1833 – Hyères 1910
Promotion Châlons 1848
Compagnon modeleur devenu grand patron, Hippolyte Fontaine sut triompher de tous les obstacles grâce à sa volonté, son savoir et son sens pratique.
1833 : la France de Louis-Philippe est toujours sujette à l’agitation politique, mais la monarchie de Juillet va favoriser l’instruction publique et l’essor de l’industrie et du commerce. C’est dans cette ambiance générale que naît, le 12 avril à Dijon, Hippolyte Fontaine, deuxième fils d’une famille modeste qui comptera treize enfants. Son père est un petit patron menuisier. À l’âge de six ans, le garçon, dont on a remarqué la vive intelligence, est mis en pension chez un ami de son père, l’instituteur G. Couchey, près de Dijon. À douze ans, aussi instruit que son maître, il seconde celui-ci dans ses fonctions de secrétaire de mairie, assiste au conseil municipal et en rédige souvent les procès-verbaux. À l’heure des émeutes de février 1848, bien que n’ayant pas encore quinze ans, il est enthousiasmé par les idées d’égalité et de fraternité qu’elles défendent. La même année, il est admis à l’École d’Arts et Métiers de Châlons.
Doué intellectuellement, Hippolyte est moins gâté physiquement : une légère paralysie latente, non soupçonnée alors, le rend assez maladroit de ses mains et peu habile pour le dessin et l’atelier. Pourtant, à peine diplômé, persuadé que, pour commencer une carrière, il faut d’abord passer par l’atelier, il n’hésite pas à partir faire son tour de France, à l’instar de son père. Il se dirige vers Lyon, à pied, avec pour objectif d’arriver à gagner trois francs par jour ! Son manque d’habileté ne l’aide pas, jusqu’au jour où, embauché par un patron qui utilise ses compétences en dessin pour le tracé d’un escalier, sa journée est enfin portée au salaire qu’il ambitionne ! Alors, conseillé par des camarades, il entre aux Ateliers d’Oullins, au bureau de dessin, dont il devient le chef. Mais en 1859, à vingt-six ans, il est atteint de paralysie musculaire, et devient incapable du moindre mouvement. Son oncle parisien, éditeur, le fait admettre à l’hôpital Saint-Louis à Paris, puis à l’établissement hydrothérapique d’Auteuil. Pendant longtemps, il se voit condamné par la médecine, obligé de subir des soins constants. Son intelligence étant restée intacte, il met à profit ce repos forcé pour étendre ses connaissances en mathématique et en électricité ; dans les livres de médecine que lui apporte son oncle, il étudie aussi ce qui a trait à sa maladie. Un traitement hydroélectrique, auquel il est soumis à sa demande, parvient à lui rendre l’usage de ses bras et, à un degré moindre, celui de ses jambes. Et il peut reprendre avec succès un poste aux Chemins de fer du Nord. Néanmoins, en 1865, il préfère le poste d’ingénieur chargé de la construction des nouveaux docks de Saint-Ouen. En 1870, arrive la guerre, et les docks de Saint-Ouen sont mis en liquidation. Avec quelques ingénieurs, Hippolyte Fontaine est délégué pour organiser le contrôle et la fabrication de canons, à Paris. Après la tourmente, désirant se créer une situation indépendante, il fonde, avec son camarade Amédée Buquet, la “Revue industrielle”, et crée la même année le “moteur domestique”, une ingénieuse petite machine à vapeur de 15 kg, chauffée au gaz, destinée à fournir la force motrice aux artisans travaillant en chambre.
Succès complet à Philadelphie
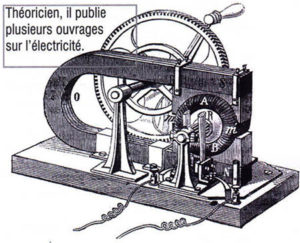
C’est en 1871 que se produit l’événement culminant de sa destinée : un des administrateurs des docks de Saint-Ouen lui confie la direction d’une société qu’il vient de créer avec Zenobe Gramme (1826-1901), le génial inventeur belge d’une machine “magnéto-électrique” (en 1869). Leur association féconde va assurer le succès de la dynamo électrique. L’inventeur s’adonne tout entier au perfectionnement de sa machine et à ses applications, telles que l’électrolyse de l’argent pour la société Cristofle ou l’éclairage; de son côté, Hippolyte Fontaine s’efforce de faire connaître l’invention et d’en tirer des résultats pratiques. Il produit la dynamo dans toutes les expositions.
En 1873, à Vienne, il présente ainsi deux machines Gramme. L’une est entraînée par un moteur à gaz, et, démonstration de la réversibilité, l’autre fonctionne en moteur, entraînant une petite pompe alimentée par des accus. À l’inauguration, la batterie est à plat ! Notre exposant relie alors le moteur à la dynamo Gramme, et ça marche… trop bien même, car l’assistance est éclaboussée ! Fontaine interpose alors entre les deux machines des couronnes de fil de cuivre jusqu’à ce que la vitesse redevienne normale ; il place ainsi 2 km de conducteurs. Et quand le cortège passe, il peut expliquer à l’empereur d’Autriche qu’il vient de réaliser un transport à distance de l’électricité. Cette expérience a un grand retentissement. En 1876, succès complet à Philadelphie, où l’État achète tout son matériel. Même succès en Angleterre, en Belgique et en Russie.
En 1881, se tient à Paris la première Exposition internationale d’électricité, avec un Congrès des électriciens. George Berger, commissaire général, associe deux hommes exceptionnels : Eleuthère Mascart et Hippolyte Fontaine. Mascart a su réaliser avec un tact parfait l’accord des électriciens de toutes nationalités sur de nouvelles unités internationales ; Fontaine regroupe autour de lui tous les représentants de cette nouvelle industrie. Ses qualités d’organisateur assurent le plein succès de l’exposition, qui est bénéficiaire. Et le boni de 325 000 francs attribué à la toute jeune Société internationale des électriciens, née en 1883 (et dont Fontaine sera président en 1889), permet de fonder le Laboratoire central d’électricité, inauguré en 1888. Le LCE donnera naissance à l’École supérieure d’électricité, qui prendra son autonomie en 1897. Les liens étroits créés par les travaux communs sont concrétisés, grâce à l’ascendant d’Hippolyte Fontaine, en une Chambre syndicale d’électricité, dont il devient le premier président, et qui se transforme ensuite en Syndicat professionnel des industries électriques.
Fontaines lumineuses

Pour l’exposition de 1889, il assure l’organisation du colossal service de l’éclairage et de la force motrice, dont le bon fonctionnement est essentiel à la manifestation (qui utilise trois fois plus de lumière que tout Paris !). Et, pour la première fois, une exposition reste ouverte le soir, avec ses fontaines lumineuses. Pour ces deux expositions, Hippolyte Fontaine recevra les croix de chevalier, puis d’officier de la Légion d’honneur. Jusqu’en 1901, il préside aux destinées de la société Gramme. Mais parallèlement, en 1887, il fonde la société “L’éclairage électrique”, après avoir organisé dès 1883 la Compagnie électrique pour le transport de l’énergie. En 1894, il prend la présidence de la Compagnie française des Métaux, puis en 1896 celle de la société “L’acétylène dissous”. Sa notoriété le fait élire juge au Tribunal de commerce de la Seine. Infatigable, outre ses communications dans les bulletins des Arts et Métiers, dans celui des Ingénieurs civils de France et dans la Revue industrielle, il publiera plusieurs ouvrages, dont “L’éclairage à l’électricité” (1876), réédité trois fois, et “L’électrolyse” qui fera autorité. Il est invité à participer à l’élaboration des Règlements pour la distribution de l’énergie électrique, nommé membre du Conseil supérieur de l’enseignement technique, et inspecteur de cet enseignement.
D’une humeur toujours égale, l’esprit large et désintéressé, d’une grande bonté, Hippolyte Fontaine est généreux, dans toute la plénitude du terme. Il ne cessera de travailler au développement de la Société des Arts et Métiers : membre du Comité dès 1865, il y apporte sa méthode, sa capacité de travail, son énergie. Il est porté à la présidence pour un an en 1885 puis en 1889, et devient membre du Conseil de perfectionnement de l’École. Il s’intéresse par ailleurs à de nombreuses œuvres de bienfaisance, qu’il dote généreusement et souvent de façon anonyme, comme les Caisses des Écoles. Sous des dehors volontairement rudes, il porte à ses amis une affection pleine de délicatesse. Il ne décide de fonder une famille que le jour où, ayant triomphé des obstacles, il peut se consacrer à elle tout entier. En janvier 1910, il quitte Paris pour passer l’hiver à Hyères. Le 10 février, il est atteint d’une grippe qui se transforme en broncho-pneumonie. Son gendre, le docteur Bordas, accourt de Paris, mais le gadzarts s’éteint sans souffrance le 17 février. À ses obsèques, célébrées à Paris, de nombreuses personnalités prennent la parole pour rendre hommage à son exceptionnelle réussite. Un lycée porte son nom à Dijon.
Jean Vuillemin – Pa 40 et ESE 47
Claude Goubet
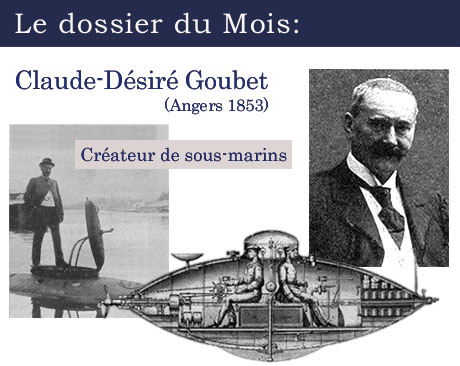
“Goubet fut l’inventeur complet : celui qui ne se borne pas à avoir des conceptions hautes et neuves, mais qui les mets au point et les réalise intégralement.”
Camille Pelletan – Ministre de la Marine.
Lyon 1837 – 1903
Promotion Angers 1853
Un inventeur né
Claude-Désiré Goubet naquit à Lyon en 1837. A l’image de son père, Chef de dépôt pour la Compagnie des Chemins de fer d’Orléans, il entre à l’ Ecole d’Arts et Métiers d’Angers en 1853. Goubet se plaisait à rappeler que son père, Désiré Goubet (Ch. 1828), était un des membres fondateurs de la Société des Anciens Elèves. Qualifié d’inventeur né, Goubet dépose de nombreux brevets dans le domaine de la mécanique. Ses travaux s’appliquent à des machines à imprimer, des machines à renvider, ou encore des systèmes d’embrayages. Jusqu’alors rien ne laisse présager qu’il soit un jour considéré comme le digne successeur de l’américain Fulton.
Aux environs de 1880, il étudie un modèle de joint sphérique baptisé au nom de Goubet. En fait, ces travaux sont réalisés pour le compte d’un ingénieur russe Mr Drzewiecki, lequel souhaite construire un petit sous-marin à pédales. Cette expérience apparaît comme le point de départ d’une nouvelle carrière, désormais consacrée à la construction sous-marine.
Un contexte favorable à l’innovation
Goubet démarre l’étude de son propre sous-marin à partir de 1881. Les plans finalisés, ils sont brevetés et présentés au Ministère de la Marine en 1885. Les circonstances sont alors très favorables au projet de Goubet. En effet, l’amiral Aube, nouveau Ministre de la Marine est particulièrement attentif aux idées novatrices. Il souhaite en outre moderniser les forces navales françaises ; tandis qu’à l’étranger les nations de la future ‘Triple Alliance’, s’accordent à des velléités guerrières.
L’amiral Aube commande la fourniture d’un petit sous marin destiné à la défense des côtes. Baptisé, ‘Goubet I’ cet engin est mis en chantier à Paris, le 26 septembre 1886 ; et lancé 5 mois plus tard, en mars 1887. On procède alors aux premiers essais dans la Seine au niveau du pont d’Auteuil. Cette campagne de tests se poursuit dans différents bassins des ports de guerre et de commerce, puis à Cherbourg et enfin à Toulon. Bien que les résultats obtenus paraissent encourageants, tant en terme d’habitabilité que de maniabilité, le petit sous-marin trouve ses détracteurs. En effet, à cette époque de nombreux ingénieurs se concurrençaient dans la construction de ce type d’engin. Par ailleurs, force est de constater que les services de la Marine sont peu enclins à faciliter la tâche de Goubet, ingénieur civil. En 1892, invoquant finalement des dimensions trop petites, le Ministre de la Marine décide de refuser définitivement le Goubet I. L’inventeur est cependant encouragé à présenter un nouveau sous-marin plus grand.
Polémique entre pionniers
Bien qu’étant refusé par les services de la marine, le premier sous-marin de Goubet fait l’objet d’un article élogieux dans la revue technique parisienne ‘L’électricien’. Probablement, non content de ne pas avoir obtenu la même publicité, l’ingénieur russe Drzewiecki accuse son homologue français de n’avoir réalisé qu’une reproduction de son propre engin. Goubet réplique en affirmant que les similitudes entre les deux modèles se limite à la coque, soit comme il écrivait ” le noyau sans l’amande… “. En effet, le sous-marin de Drzewiecki est propulsé au moyen d’un pédalier actionné par 4 hommes d’équipage, alors que le Goubet comprend un moteur électrique. Par ailleurs, le sous-marin russe ne dispose ni d’appareil de tenue automatique d’assiette ni de régulateur d’immersion.
Goubet II – Extrait du journal de bord de Toulon

10 janvier 1900. – Nettoyage. Sortie en rade à 2h. 35 après midi. Le Goubet met directement le cap sur la Grosse-Tour. Le vent venant N. -O., il sort de la rade et prend son point pour courir la base de la digue : 1,212 mètres. Cette longueur est parcourue en 7 minutes ½ environ. Le bateau procède à des règlages en plongeant à plusieurs reprises. Prenant le large, on ajoute 4 accumulateurs de réserve. Le bateau accentue sa vitesse et dépasse la chaloupe à vapeur qui l’escorte à chaque sortie. Entre cap Brun et le cap Cépet, la mer devient très forte, la chaloupe fait signe de revenir ; le Goubet revient vers la rade en passant à travers d’énormes lames qui le couvrent et le découvrent à chaque instant, sans le déranger de sa route (…). On met la grande vitesse et la passe est franchie au milieu de l’écume et sans que nous sentions le moindre mouvement d’oscillation (…). Le Goubet rentre à son poste d’amarrage, il est 4h.35. Tout va bien à bord!
Le Goubet II, fruit d’une ténacité exemplaire
Bien que les frais de construction d’un nouveau sous-marin soient encore à la charge de l’inventeur, celui-ci est loin de se résigner. Il réunit les fonds nécessaires et met le Goubet II en chantier à Argenteuil. Destiné initialement au Brésil, ce nouveau sous-marin témoigne des efforts d’inventivité de Goubet, il comporte de nombreuses évolutions permettant de palier aux défauts de son prédécesseur. Ainsi, ses trois ailerons longitudinaux garantissent une meilleure stabilité, le moteur électrique de 4 ch est désormais alimenté par une batterie d’accumulateurs, l’armement est constitué de deux torpilles, alors qu’un régulateur automatique d’immersion améliore la tenue de plongée.
Tandis que les négociations avec les commanditaires Brésiliens échouent, le Goubet II est lancé en 1895. L’inventeur présente alors son nouvel engin à la Marine Nationale. Les nombreux essais exécutés à Toulon de 1900 à 1901, parfois dans des conditions météorologiques extrêmes, révèlent les améliorations apportées au Goubet II (cf encadré 2). Prétextant, une vitesse insuffisante et une taille encore trop petite, le Goubet II subit le même verdict que son prédécesseur, il est refusé.
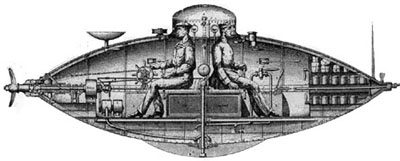
Caractéristiques du Goubet I
Longueur : 5 m Largeur au maître couple : 1 m Hauteur : 1,78 m Matériaux : bronze Section : ovale Capacité d’embarquement : 2 hommes Propulsion : moteur électrique Edison de 1 ch alimenté par des piles Armement : mine à flottabilité positive.
Caractéristiques du Goubet II
Longueur : 8 m Hauteur : 1,85 m Poids : 5.000 kg Matériaux : bronze Section : circulaire Capacité d’embarquement : 3 hommes Propulsion : moteur électrique Siemens de 4 ch alimenté par des accumulateurs au plomb Armement : 2 torpilles Whitehead de 450 mm
Une fortune malheureuse
N’ayant bénéficié d’aucune subvention de l’Etat, l’éminent inventeur est désormais la proie de ses créanciers. Le sous-marin est transféré de Toulon à Saint-Ouen, où il sera saisi, puis vendu au plus offrant. Ruiné et malade, Goubet se réfugie chez les Frères hospitaliers de Saint-Jean de Dieu, auprès desquels il décède le 15 janvier 1903. Tandis qu’une foule d’admirateurs se presse aux obsèques de l’inventeur, au cimetière Montparnasse, ses plus fervents défenseurs dénoncent, non sans émoi, l’injustice dont il fut victime. Ainsi, Camille Pelletan, ministre de la Marine du moment, salue la ténacité et l’enthousiasme de Goubet, précurseur de la navigation sous-marine, contre lequel se déchaînèrent les esprits routiniers, hostiles aux idées nouvelles.
Frédéric Champlon (Ch 94)
Xavier Grall
 Landévennec 1907 – Mers el-Kébir 1940
Landévennec 1907 – Mers el-Kébir 1940
Promotion Angers 1924
Une mort héroïque sous un feu fratricide : ingénieur mécanicien dans la marine, Xavier Grall a succombé sous le tir britannique lors d’un épisode peu connu de la terrible année 1940.
Le 22 juin 1940, Pétain signe l’armistice. Le Royaume-Uni demeure le dernier pays en guerre contre Hitler. La flotte française se disperse dans des ports hors de France métropolitaine. Cela préoccupe Churchill, Premier ministre depuis un peu plus d’un mois : il ordonne que, où qu’ils se trouvent dans le monde, ces bâtiments soient désarmés en pays neutre, invités à se rallier ou détruits. L’opération “Catapult”, planifiée pour le 3 juillet 1940, va coûter la vie à 1 297 marins français, dont Xavier Grall.
Celui-ci est né le 1er septembre 1907, à Landévennec, petit port de la rade de Brest. Son grand-père paternel, premier-maître fusilier, et son grand-père maternel, ancien compagnon du Tour de France premier-maître mécanicien, ont servi dans la marine. Son père, premier-maître fourrier, a participé à des campagnes en Chine, aux Dardanelles, en mer Noire… Alors qu’il a douze ans, l’oncle de Xavier, charpentier de marine, lui construit un petit voilier à l’ancienne sur lequel il naviguera en rade de Brest. Enfant, Xavier fréquente l’école communale de Landévennec, puis l’école des frères de Recouvrance, enfin l’école Chevrolier de Nantes où il prépare le concours d’entrée à l’École nationale d’arts et métiers. Il entre à Angers à dix-sept ans.
À sa sortie, en 1927, ses brillants résultats lui permettent d’entrer sans concours à l’École navale et, en raison d’une acuité visuelle insuffisante, il intègre l’École des ingénieurs mécaniciens de la Marine (EIMM). Sa promotion compte 44 élèves, dont 37 ingénieurs Arts et Métiers. Xavier est le plus jeune des gadzarts admis sans concours. Il montre rapidement ses qualités de marin et, bien que mécanicien, est affectueusement surnommé par ses camarades “le Bosco” (maître de manœuvres).
Nommé ingénieur mécanicien de 3e classe (un galon) le 15 septembre 1929, il embarque sur un croiseur léger (8 000 t), le “Primauguet”, puis sur le “Duguay-Trouin”, du même type, sur le “Provence”, son premier cuirassé, sur le torpilleur de 700 t “Hova” et le contre-torpilleur “Bison”. Il reçoit son deuxième galon le 1er octobre 1931 et embarque à bord du croiseur “Dupleix” alors en essais à Lorient, puis trois ans plus tard, sur le cuirassé “Bretagne”.
La même année, il épouse à Landevennec une fille de marin, Herveline. Yvonne, leur première fille, naît en 1935. Promu l’année suivante, l’ingénieur mécanicien de 1re classe Xavier Grall devient chef du service machines de l’escorteur de 610 t “La Flore” en construction à Nantes, puis en essais à Lorient. Sous les ordres du capitaine de frégate Ortoli, la “Flore” participe en Méditerranée aux opérations de surveillance de l’embargo pendant la guerre d’Espagne. Une deuxième fille, Jeannick, naît en 1938. Xavier revient à Brest, en tant qu’instructeur à l’École navale qui vient de s’installer dans de fastueux bâtiments à Lannion.
À la déclaration de guerre, il est affecté à la batterie côtière de Toulbroc’h, à l’entrée de la rade de Brest. Cela lui permet une vie familiale agréable, mais ne correspond pas à sa volonté profonde. Il a compris que l’enjeu de cette guerre n’est pas seulement territorial, comme en 1914, mais va bien au-delà : c’est l’affrontement de la liberté et du totalitarisme. Avec l’accord de son épouse qui attend leur troisième enfant, il demande un embarquement.
En octobre 1939, il monte à bord du navire amiral de la Flotte de l’Atlantique, le “Dunkerque”, où il est placé sous les ordres de l’ingénieur en chef Edmond Egon (Ch. 10). Il retrouve son camarade de promotion Albert Borey (Pa. 24) qu’il a connu à l’EIMM, ainsi que Fernand Lecrocq (Li. 30), Maurice Rousset (Ch. 35) et Maurice Lemoine (Li. 35). La Flotte de l’Atlantique est commandée par l’amiral Gensoul et compte des bâtiments de ligne de la Royal Navy, en particulier le croiseur “Hood” : 42 000 t, 4 tourelles doubles de 381 mm. L’escadre franco-britannique demeure très active en Atlantique Nord durant la “drôle de guerre”. Au cours de son dernier passage à Brest, Xavier assiste à la naissance de son troisième enfant, Hervé, le 30 mars 1940. Il ne reverra jamais les siens.
Le 26 avril, le “Dunkerque” appareille de Brest. Les événements se précipitent : défaite de la France, armistice, et “catapult”. Le 3 juillet, la flotte britannique est devant Mers-el-Kebir et adresse son ultimatum. Dès qu’il en prend connaissance, à huit heures du matin, l’amiral Gensoul ordonne aux navires français présents sur rade de se préparer au combat, puis à neuf heures, de s’apprêter à appareiller. Les équipages sont aux postes de combat, les mécaniciens ont pris leur quart dans les machines. L’ultimatum expire à 18 heures. Tous les navires britanniques présents, dont le “Hood”, ouvrent le feu sur les français.
Le 4 janvier 1945, l’ingénieur mécanicien de 1re classe Borey se souvient : “Autour du pupitre machines du “Bretagne” se tiennent l’ingénieur mécanicien en chef Egon, chef de service, l’ingénieur mécanicien de première classe Grall, chef de quart et de sécurité du groupe avant, l’ingénieur mécanicien Quentel, de quart en sous-ordre. Autour d’eux et au parquet inférieur s’affairent 80 hommes et gradés. Tous sont parfaitement calmes et confiants. Un peu après 18 heures, les machines centrales viennent de démarrer en arrière, la passerelle signale “Attention” puis “Arrière 50 tours” des deux bords… À ce moment précis, une grande flamme jaillit sur l’arrière, entre la descente et le tableau électrique, accompagnée d’un fracas terrible auquel succèdent plusieurs détonations rapprochées. En quelques instants, déversée à flot par toutes les manches de ventilation, une âcre fumée jaune, brûlante, suffocante, envahit le compartiment. Ceux qui, placés devant les bouches d’aération, ont reçu en plein le flux empoisonné, s’abattent, le souffle coupé, la gorge en feu, les yeux brûlés… Alors, suivi de l’ingénieur en chef (…), l’ingénieur Quentel (…) enjambe les fugitifs et parvient en haut de l’échelle (…). Méthodiquement, il procède à la laborieuse manœuvre qui permettra de soulager le panneau à l’aide de la pompe de secours ; enfin le passage est libre, ils sont sauvés.
Monsieur Egon tente d’entraîner Grall en partant, mais celui-ci refuse. Voilà Grall au parquet inférieur ; Grall parle, essaie de réconforter les hommes piégés : “Courage, on va sûrement venir à notre secours… Ne vous affolez pas…” Un homme a reconnu sa voix, il implore : “Monsieur Grall, on ne va pas nous laisser mourir comme ça, dites ? Vous n’allez pas nous abandonner ?” “Non, mon petit, réplique Grall, je ne vous quitte pas.” Et, péniblement, à tâtons, il remonte au parquet supérieur. En chemin, il a dû buter ou manquer l’échelle (peut-être déjà se sent-il mal ?) : il perd un soulier qu’on retrouvera dans la cale, au pied de l’échelle. Parvenu en haut, que va-t-il faire ? La température est maintenant insupportable et l’atmosphère complètement empoisonnée… Il peut encore fuir, la chose est relativement aisée. Vers 20 h 30, une nouvelle fait rapidement le tour du bord : “On a retrouvé monsieur Grall, il respirait encore, on l’a trouvé à genoux.” Trois médecins s’acharnent pendant des heures. À 22 h 55 (…) Grall a cessé de vivre.”
Quelques semaines plus tard, Grall fut proposé pour la Légion d’honneur avec une proposition de citation à l’ordre de l’Armée: “Officier d’élite, tué glorieusement à son poste de combat lors de l’agression britannique, à Mers el-Kébir, le 3 juillet 1940”. La Croix de guerre, avec palme, sanctionna cette proposition.
Les victimes de la tragédie reposent pour la plupart dans le cimetière marin de Mers el-Kébir. Quelques corps furent rapatriés : un marin inconnu repose dans le cimetière Kerfautras de Brest, au pied du monument commémorant l’événement. Le corps de Xavier Grall a également été rapatrié. Seule la mort l’a séparé de ses hommes. Celui qui répondait à la confiance par la fidélité repose dans sa terre natale de Landévennec au pied de l’abbaye Saint Guénolé. L’attachement à la terre natale, la passion de la mer, la foi sincère en Dieu ainsi que l’amour des siens avaient constitué les repères cardinaux de son existence.
Bernard Jacquet (Cl 77)
Remerciements à Hervé Grall, fils de Xavier.
Arthur Groussier
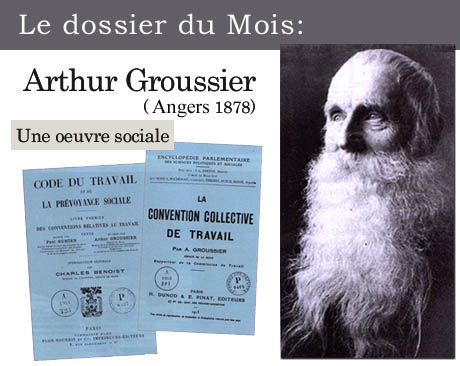
“On ne peut pas connaître Arthur Groussier sans l’aimer. On ne peut pas connaître Groussier sans le respecter…”
Léon Blum
Orléans 1863 – 1957
Promotion Angers 1878
Rien n’est possible sans le don total de soi à l’œuvre envisagée et l’on n’a rien donné si l’on n’a pas donné tout.
Arthur Jules Hippolyte Groussier naît le 16 août 1863 à Orléans. Son père, Hippolyte François, facteur au chemin de fer à Orléans a 24 ans et sa mère, née Félicie Proust, fille de restaurateur, 21 ans. Il est l’aîné dans une fratrie de quatre. La souche des Groussier dans la région est ancienne. Il entre aux Arts et Métiers en 1878 et travaille à sa sortie dans le bureau d’études de Charles Armengaud jeune (Ch 1828) puis comme dessinateur chez Eugène Ravasse (Ch 1859), Ingénieur constructeur. Il rencontre alors Julie Roux, par principe libertaire ; ils ne se marient pas, mais elle restera sa compagne jusqu’à son décès en 1918 . Ils auront un enfant, Jean.
Très vite pourtant il s’intéresse au syndicalisme et devient de 1890 à 1893, secrétaire général de la Fédération Nationale des Ouvriers Métallurgistes, précurseur de la CGT fondée au tournant du siècle. En 1893, il est élu député du Xe arrondissement de Paris.
Il est élu comme candidat du ” Parti ouvrier socialiste révolutionnaire “, il est proche de Allemane. Ce parti sera fusionné en 1898 avec les groupes de Jules Guesde, Edouard Vaillant, Marcel Sembat, et les indépendants Jean Jaurès, René Viviani, Alexandre Millerand, etc., pour fonder le Parti Socialiste.
Son programme législatif de 1892, adopté par un congrès, est très radical ; on pourrait dire extrémiste, préconisant déjà le gouvernement direct du peuple dans tous les domaines, ce qui est bien dans l’air du temps. Pourtant on y voit aussi ses préoccupations essentielles et la ligne de force de son action dans ses successives mandatures : les changements de fond à apporter à la façon dont le travail est organisé.
En effet, quand on examine le détail de ses interventions, amendements et projets de lois, leur très grande majorité concerne les pratiques dans l’organisation du travail : législation du travail, organisation syndicale, contrats de travail , prud’hommes, travail des enfants, etc. (encadré). S’il n’est pas un parlementaire qui a participé aux grands débats idéologiques de son temps, qui n’est donc pas connu du grand public, il est considéré par ses pairs comme un orateur écouté et un travailleur acharné.
Son grand œuvre sera la réunion dans un Code du Travail, de tous les textes de loi votés ou préparés et des idées nouvelles exprimées. Ce code du travail comprend deux livres , le premier édité en 1911, le second édité en 1913, écrits en collaboration avec un juriste, Paul Sumien. En 1913 paraît aussi son ouvrage sur la Convention collective du travail. Ce travail législatif avait commencé dès1893 et le code lui-même ne sera voté qu’en décembre 1910 et juin 1913. C’est dire la ténacité de l’homme tout au long de son engagement politique.
En 1914, président du groupe socialiste à la Chambre et partisan de la défense de Paris alors que beaucoup de députés voulaient l’évacuation du gouvernement, il est nommé au Comité de défense du camp retranché de Paris, comme adjoint de Gallieni. A la même époque, il refusera à plusieurs reprises le poste de Ministre du Travail, sollicité par Ribot, Painlevé et Clemenceau pour se consacrer presque secrètement à l’armement. Par contre il a été Président de la Commission du travail et Vice-Président de la Chambre en 1917, poste ” occupé avec une telle autorité que sa présidence a été longtemps citée en exemple par les habitués du Palais-Bourbon . ” Il aura été élu et réélu député de 1893 à 1924 sauf entre 1902 et 1904, période où il a repris un travail d’Ingénieur sur le chantier du tube Berlier sous la Seine, pour le métro Nord-Sud.

En 1924, il est battu et se désintéresse petit à petit de la politique active.
En ce qui concerne notre école, il en est membre du Conseil de perfectionnement et il interviendra à plusieurs reprises pour résoudre les différends entre les élèves, dont il est le défenseur, et l’administration. En 1907, il est pour beaucoup dans le décret qui institue le brevet d’Ingénieur des Arts et Métiers. Ami des présidents Delage, Ramas, Monteil, comme lui Francs-maçons, il continue à s’intéresser à la Société des Anciens Elèves et à ses travaux.
Il avait été initié en Maçonnerie en 1885, à l’âge de 22 ans et en 1907, à 44 ans, il était élu membre du Conseil de l’Ordre du Grand Orient de France, l’une des trois obédiences importantes existant aujourd’hui. En 1925, après avoir abandonné la vie politique militante, il est choisi comme Président du Conseil de l’Ordre du Grand Orient de France, c’est-à-dire Grand Maître. Son mandat est interrompu en 1940 quand les ordres maçonniques sont dissous par le gouvernement de Vichy, après une dernière intervention qu’il fait auprès de Pétain, mais il sera renouvelé en 1944-45. Il a d’ailleurs été arrêté par la Gestapo, chez lui.
Son œuvre en tant que Maçon a été, d’après les archives du Grand Orient, considérable, aussi bien en France qu’à l’étranger, surtout en Europe centrale et Amérique latine, où il était particulièrement reconnu et honoré. La grande salle de réception du Grand Orient, rue Cadet, porte son nom.
Il a participé aux controverses maçonniques sur le spiritualisme et le déterminisme par deux essais et un livre (encadré). Son livre surtout, écrit à plus de quatre-vingts ans, essaie de jeter un pont entre spiritualisme et matérialisme, thème récurrent.
Pour mieux connaître l’homme, quelques uns des témoignages qui abondent parmi ceux qui l’ont connu:
“Au physique, un petit homme, bien proportionné, dont il était impossible d’oublier le visage dès lors qu’on l’avait vu. Le front, grand, intelligent, dominant des yeux aux lueurs tantôt douces, tantôt fulgurantes. Le bas du visage était encadré, prolongé par une barbe tôt blanchie mais d’une longueur inhabituelle, qui lui faisait une allure particulière. Silhouette anachronique sans doute, mais forçant le respect, par je ne sais quel fluide qui en émanait.” (hommage posthume).
“On ne peut pas connaître Arthur Groussier sans l’aimer. on ne peut pas connaître Groussier sans le respecter… On reconnaît en lui l’homme qui n’a jamais menti, l’homme dont toutes les pensées sont bonnes, dont tous les actes ont été justes et l’on sent sous la tranquillité et la simplicité de l’apparence, l’homme inflexible, incorruptible qui n’a jamais transigé avec une conviction ou un devoir. Léon Blum ”
Son petit-fils, Georges Groussier, professeur de faculté en retraite, qui habite la maison où vécut son grand-père garde de lui ” l’image d’un homme d’une très grande cohérence, syndicale, politique, maçonnique : faire le bien, s’occuper des pauvres, ne pas profiter pour s’enrichir…et il l’a fait. C’est un homme sans tache.”
Arthur Groussier est décédé le 6 février 1957 et a été incinéré.
Ayant toujours refusé les honneurs, il n’aurait pas approuvé que la rue Parmentier, après sa mort, devienne la rue Arthur Groussier. Elle se trouve près de l’hôpital St Louis dans le 10e arrondissement de Paris.
Edmond De Andrea (Aix 45)
André Guinard

Blanzy 1891 – St Cloud 1960
Promotion Cluny 1908
André Guinard est né le 4 avril 1891 à Blanzy (Saône et Loire)(…). Après l’Ecole Professionnelle de Chalon-sur-Saône, il entre aux Arts et Métiers de Cluny en 1908, et après son service militaire, il travaille chez Schneider puis chez Hamm, ascenseurs hydrauliques. Il est mobilisé en 1914 et envoyé au front mais il est affecté, en 1915, chez Citroën pour la fabrication d’armement. Cette période de guerre est peu connue, même de ses proches car, comme beaucoup de ” poilus “, il n’en parlait jamais (…).
André Guinard était déjà intéressé par les pompes alors qu’il était à Cluny. En 1918, il avait étudié, breveté et proposé une pompe qui permettait de résoudre le problème d’alimentation en essence des avions ressourçant après un piqué, projet jamais réalisé car la guerre prit fin.
En 1919, il propose à Hamm sa pompe volumétrique à pistons qui est refusée et il décide alors de créer son entreprise. Avec l’aide de 10 associés (…), il crée une société en commandite simple avec un capital de 155000 F.
La fabrication de sa première pompe rotative à pistons, qu’il avait fait breveter, est lancée. L’étude en était si bien faite qu’elle était encore fabriquée dans les années 1980, pratiquement sans modifications. Cette pompe était révolutionnaire et présentait de tels avantages qu’elle trouva très rapidement de nombreux débouchés, pour les usages domestiques, agricoles et industriels. Elle était réversible et d’un rendement élevé (…).
En 1921, devant l’expansion, une usine fut transférée 54, avenue Foch, à St Cloud, les bureaux installés à Paris, 21, rue Carnot.
En 1928, les locaux devenant insuffisants, une usine et des bureaux furent construits sur des terrains disponibles, chemin de la Fouilleuse, à St Cloud.
Les moyens industriels devaient rapidement croître : en 1928 : 6000m2 et 300 salariés; en 1931 : 10000 et 450 ; en 1940 après création de l’usine de Châteauroux : 25000 et 2000, ce chiffre tombant à 1100 en 1945.
En 1969, pour le cinquantenaire de la société, les Établissements Pompes Guinard étaient devenus un groupe international avec de nombreuses filiales et sept usines principales en France et à l’étranger. Elle comptait 2500 personnes et 62000 pompes avaient été fabriquées cette année-là (40{7c045177abe3e375b80fdc991a35b0c620d25696bff93cbc663732b700147d79} du marché français).
Pour les produits, l’évolution a été considérable : à la première pompe rotative à pistons est venue se rajouter une petite pompe alternative à pistons, puis une pompe centrifuge à amorçage automatique, puis une gamme de pompes centrifuges mono et multicellulaires en commençant par les petites à amorçage automatique. Les modèles ont été adaptés aux applications : adduction d’eau, marine, incendie, hydrocarbures, mazout, liquides grippants, etc , et les puissances étagées de 0,25 à 8 CV.
En 1933 est créé le département Incendie. Guinard fournissant déjà les pompes à des fabricants de moteurs à explosion , décide de fournir lui-même les groupes moto-pompes. Grand succès auprès des services Incendie publics et privés. Pompes Guinard ne s’arrêtent pas à la fourniture des pompes et moto-pompes mais fournissent bientôt les véhicules équipés, le matériel annexe, par exemple les tuyaux (produits très techniques, fabriqués sous licence). Il faut signaler, à titre de référence historique et sans qu’il y ait de filiation industrielle, qu’un grand ancien, Henri Flaud (An 1830) avait créé une société de matériel incendie vers 1850.
Ce prodigieux développement, conduit sur une vingtaine d’années (1919-1939) ne pouvait être conduit que par un homme de très grande qualité. Partant d’un produit innovant (la pompe rotative à pistons), il a décliné toute une gamme lui permettant, au fur et à mesure de l’apparition des besoins, de remplir les niches qui se présentaient. Ce qui est remarquable, c’est que toutes les lignes de produits qui ont été développées existent encore.
Il était un ingénieur certes, mais il était aussi un homme de marketing : ses calendriers se retrouvaient partout en France, par exemple dans presque toutes les fermes. Il était très près du terrain. Son fils raconte un souvenir d’enfance: départ en vacances en voiture où tout d’un coup arrêt devant l’échoppe d’un plombier. Il descend et commence à discuter avec l’artisan, continue, reste dans l’atelier assez longtemps pour que tout le monde s’impatiente et répondant tout le temps : “J’ en ai pour une minute”. Il ramenait ainsi des informations importantes pour son bureau d’études (…).
Il aimait le contact avec le personnel et avant les lois sociales, il avait créé les œuvres sociales : aide au logement, jardins ouvriers, cantine, service médico-social, colonies de vacances, bibliothèque, etc…Les salaires étaient bons. On peut comprendre que le personnel était très stable : on entrait ” chez Guinard ” comme apprenti et on y restait. Pendant toute la guerre, la cantine Guinard a remarquablement fonctionné pour l’époque ,alors qu’elle ne bénéficiait d’aucune attribution officielle (…).
Il avait un sens artistique très fort. Le dessin en particulier l’attirait beaucoup et ses enfants ont retrouvé ses dessins des Arts et Métiers qui, outre l’aspect technique, l’illustrait déjà. C’est apparent dans certains de ses produits. On raconte qu’il aimait bien ” croquer ” , au théâtre par exemple ; ce pouvait être un voisin ou un acteur.
Les sujets de ses peintures sont des portraits de sa famille, des natures mortes, des bouquets et quelques paysages. Une exposition privée a été organisée par ses petits-enfants en 1988. La veille de sa mort, survenue le 2 décembre 1960, entre deux coups de téléphone avec ses principaux collaborateurs, il peignait encore. Il est inhumé à St Cloud.
Edmond De Andrea, Ingénieur A&M (Aix 45).
Extrait de ‘Arts et Métiers Magazine’ – Juin / Juillet 2002.
Henri Guinier
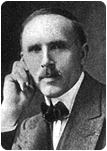
1867 – 1927
Promotion Châlons 1883
“En mai 1943, dans une galerie de l’avenue de l’Opéra, a lieu le vernissage d’une exposition rétrospective des œuvres d’Henri Guinier, disparu prématurément en 1927. Une foule d’artistes, de parents, d’amis et d’ingénieurs Arts et Métiers s’y presse pour y admirer les tableaux. Henri Guinier, né le 20 novembre 1867, entre à l’École des Arts et Métiers de Châlons en 1883, en même temps que son frère jumeau Edouard, tous deux fils de Simon (Ch. 1836) et neveux de Nicolas (Ch. 1838). Ainsi, Henri Guinier avait, par sa famille et par sa formation, de fortes et affectueuses attaches avec les hommes de l’industrie.
Dès sa sortie de Châlons en 1886, il va s’appliquer à développer ses dons artistiques. Pour cela, après l’académie Julian, il entre aux Beaux-Arts en 1887. Élève de Jules Lefebvre et de Benjamin Constant, II monte en loge, et participe au concours de Rome en 1893 et 1894. Il obtient le second grand prix de Rome en 1896, à 29 ans. De plus, la médaille d’or au Salon de 1898 le place hors concours et, la même année, une bourse de voyage affirme sa maîtrise. Sa carrière est brillante et rapide.

[L’automne]
À l’Exposition universelle de 1900, il reçoit une médaille d’argent et, en 1907 il devient lauréat du prix Henner. Plus tard, en 1913, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur. À la même époque, il devient membre du jury et membre de la Société des artistes français. Henri Guinier a exécuté de nombreux portraits (…); plusieurs de ses œuvres ont été acquises par l’État et figurent dans des collections des musées français et étrangers, notamment au Luxembourg, Pologne et Chili.
Parmi les œuvres présentées lors de l’exposition de 1943, on retrouve un chef-d’œuvre dans son parcours, présenté à l’occasion du Salon de 1911, qui eut un grand succès. Cette toile prestigieuse de 3,90 m x 2,80 m, ” Un Pardon en Finistère “, où l’on voit près de cinquante visages, est d’une puissance d’expression, d’une vigueur et d’un coloris magnifiques. Elle fut acquise par la Société des anciens élèves. Et se trouve maintenant dans le grand escalier de l’hôtel d’Iéna (…).
[Portrait d’Ernest Marché]

PARMI LES ŒUVRES D’HENRI GUINIER :
Petite fille des champs (Salon 1893), musée d’Amboise
Automne (Salon 1895), palais du Luxembourg
Jésus pleuré par les Saintes femmes : deuxième grand prix de Rome (1896), musée de Joigny
Psyché et l’Amour (Salon 1897), musée de Poitiers
Chant du soir (Salon 1899), musée national du Chili Amour chaste (Exposition de 1900), médaille d’argent
Pardon de Sainte-Anne (Salon 1902), musée de Dijon
Ophélie (Salon 1903), musée Vannier-Reins
Femme pensive (Salon 1907), musée de Mulhouse
Décorations, mairie de Neuilly (1909)
La France victorieuse (1919)
Bretonne au chapelet (1927), musée de Quimper
Le vieux mendiant, musée du Luxembourg…-‘
Dans les dernières années de sa vie, il s’intéresse beaucoup au dessin, ne se contenant plus d’exprimer les jeux changeants de la lumière, mais s’attachant à la précision de la forme qu’il aime à ciseler (…). Henri Guinier, entré dans le monde des artistes français, n’a jamais oublié ses origines et reste, comme son frère, un gadzarts militant. Il fut même l’auteur de la composition allégorique pour la médaille décernée aux sociétaires de l’époque.
Avec son fin et franc sourire, sa main amicalement ouverte, il était toujours présent quand il le fallait. En 1915, bien que dégagé de toute obligation militaire, il ne peut se résoudre à l’inaction ; il part alors, comme volontaire, au service de la Défense nationale dans la section de camouflage, et contribue à la formation de cette unité. En ce temps-là, sa santé est bonne. Malheureusement, elle décline par suite d’une grave imprudence qu’il commet poursuivant, dehors, à la campagne, ses travaux de peinture. Il meurt en 1927 à soixante ans. Grâce à la présence de ses œuvres, les gadzarts ne peuvent oublier ce camarade qui sut faire de l’art un métier.”
Jean Vuillemin, ingénieur Arts et Métiers (Pa 40).
Extrait de ‘Arts et Métiers Magazine’ – Décembre 2002.
Marcel Hanra
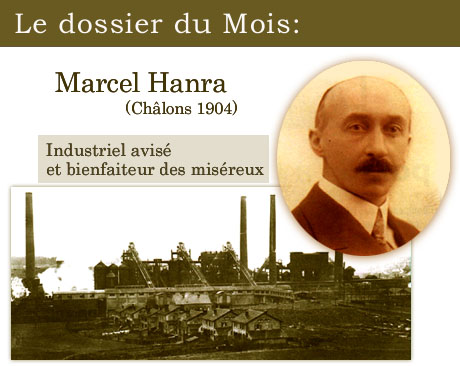
Châlons sur Marne 1887 – Châlons sur Marne 1987
Promotion Châlons 1904
“Organiser, animer et servir ! Telles ont été les idées forces qui déterminèrent l’exemplaire destinée de Marcel Hanra “ ( allocution du Sénateur-Maire Robert Calmejane lors des cérémonies du centenaire de M.H.)
Il est né le 26 février 1887 à Châlons sur Marne, troisième enfant d’une fratrie de cinq, son père Dorimond Hanra, d’origine modeste, était agrégé de physique et professeur aux Arts et métiers à Châlons. Il se décrit comme un élève turbulent et chahuteur qui avait quelquefois le ” bonnet d’âne “. Cela ne l’empêcha pas de faire une bonne préparation au collège de Châlons et de réussir le concours d’entrée aux Arts et Métiers à Châlons. Il en sort diplômé en 1907. Ses trois frères sont des Gadzarts, Gabriel (Ch 1895), André (Ch 1897) et Fernand (Ch1914).
Soulager les souffrances
Après son service militaire dans le génie à Verdun, il est engagé aux Hauts Fourneaux d’Esch sur Alzette, au Luxembourg où il perfectionne son allemand. Les conditions de travail dans la sidérurgie, à l’époque, étaient très dures, et conduisaient à un grand nombre d’accidents. C’est là qu’il prend conscience de cette vie difficile, on dirait aujourd’hui inhumaine, et qu’il va s’efforcer d’améliorer. Ce premier engagement, à 25 ans, va orienter sa vie. Il épouse en 1911 Léa Billot (décédée en 1966), ils auront quatre filles puis 17 petits-enfants et arrière-petits-enfant.
A la déclaration de guerre en 1914, Marcel Hanra réussit difficilement à rejoindre à temps la France et Verdun, son poste de mobilisation. L’horreur de ces premiers mois de guerre ne va que conforter son inclination vers le soulagement des souffrances des hommes. Fin 1915, devant l’enlisement de la guerre et pour augmenter la production d’armement, il est rappelé du front et affecté à Neuves-Maisons où, sous les bombardements, il remet en marche les hauts-fourneaux de Knutange. Il montre à cette occasion ses qualités d’organisateur et d’entraîneur d’hommes. Marcel Hanra et son équipe seront cités à l’ordre de la Nation.
Dès la fin de la guerre, connaissant son efficacité et sa connaissance de l’allemand, il est chargé du séquestre des usines métallurgiques de la Lorraine redevenue française. Il constitue son équipe avec 16 Gadzarts. La reconstruction du bassin lorrain va se faire dans un climat social très difficile, au milieu des grèves (la révolution russe était de 1917) et avec un travail très dur (12 H de travail de jour alternant avec 12H de travail de nuit), toujours ponctué de très nombreux accidents Son travail acharné et son contact humain vont avoir une influence positive certaine sur cette reconstruction . Le journal l’Est Républicain du 27 novembre 1923 :
“Toujours à l’écoute des doléances de ses subordonnés, Marcel Hanra est connu pour son dévouement et son ardeur au travail . Dans les moments critiques de tensions sociales et politiques, il embrasse d’un coup d’œil une situation compliquée, trouvant toujours un terrain d’accord entre ouvriers et employeurs.”
Après cinq années en Lorraine il rejoint les Etablissements Bacholle en Région parisienne et s’installe à Villemomble. Ce changement est essentiel car il fait à ce moment là le choix décisif, sa priorité devenant, non pas sa carrière, mais ce qu’il a laissé deviner depuis longtemps : s’occuper des autres et surtout des plus faibles, tout en gardant une activité professionnelle. Il est élu en 1925 conseiller municipal de Villemomble et il a été Maire adjoint de 1953 à 1969 avec un court intermède à la Libération comme Responsable de l’Administration, désigné par les Mouvements de Résistance.
Œuvres sociales
Dès 1932, il crée le Centre d’hygiène et d’Assistance Sociale de Villemomble, pour aider les plus démunis, reconnu d’utilité publique, dont il sera le Président jusqu’en 1971. Il entreprend une véritable croisade contre la misère et la tuberculose qui fait des ravages, à une époque où la Sécurité Sociale n’existe pas. Pour financer le Centre et les œuvres sociales, il entraîne toute une équipe de bénévoles sans distinction d’origine sociale et il organise des collectes, kermesses, soirées de gala, ventes diverses. Le Centre qui a pris aujourd’hui le nom de Marcel Hanra existe toujours, en faisant évoluer ses priorités, selon les besoins, par exemple aujourd’hui, l’aide aux personnes âgées.
L’activité sociale de Marcel Hanra ne s’arrête pas là puisqu’il intervient dans plusieurs associations caritatives de Villemomble, par exemple : – administrateur de la ” Mutuelle de Villemomble ” – administrateur de l’Office Public d’Habitation à Bon Marché -secrétaire de la Ligue des Familles Nombreuses Mais aussi au plan national, par exemple : – membre du Comité National de l’Enfance – membre du Comité National de la lutte contre la tuberculose
Il fonde et préside en 1932 le Groupe des Ingénieurs Arts et Métiers de Villemomble-Le Raincy-Montreuil dont il restera Président d’honneur et il assistera aux réunions mensuelles jusqu’aux dernières années de sa vie.

La guerre de 1939-45 va apporter au Centre un surcroît d’activité, surtout dans le domaine alimentaire. L’activité de Marcel Hanra ne se limita pas à cet aspect caritatif. Il ne peut admettre l’occupation. Dès 1940, il prend parti et entre en Résistance, toujours à sa manière, discrète et efficace mais qui lui vaudra la perte de sa situation professionnelle. Sa famille le suit dans cet engagement. Ses relations avec l’imprimeur Bernier du Raincy permettent la parution du tract : ” France Libre “. Après avoir mis en garde ses filles sur les dangers d’entrer dans un mouvement de résistance, par sa présence d’esprit et sa connaissance de l’allemand, il sauve par deux fois sa fille Colette d’une arrestation. Dans les derniers mois de la guerre, le Centre devient le lieu de réunion des différents groupes de Résistance pour préparer l’insurrection de fin août 1944. Il cache des personnes recherchées, juif, résistant, aviateur anglais…Il devient à la Libération responsable local du mouvement ” Ceux de Libération Vengeance “.
Mais qui était Marcel Hanra ?
Sa fille Colette Hanra le décrit comme un homme honnête et droit, ayant son franc-parler, conscient de sa valeur mais sans ostentation et restant simple. Animé d’une foi sans faille, il n’est pas bigot, altruiste il aide discrètement , tolérant et sachant écouter, il est agréable de parler avec lui. Il ralentit beaucoup ses activités après 80 ans, ayant des difficultés avec son ouie et sa vue. Il est certain que ces activités débordantes ne lui ont pas permis de manifester sa présence dans sa famille aussi souvent que celle-ci l’aurait peut-être souhaité.
Pour son centenaire, des cérémonies émouvantes ont été organisées à Villemomble le 8 mars 1987. Y participaient entre autres le Sénateur-Maire et la Municipalité, la Société d’entraide de la Légion d’honneur, le Président des Ingénieurs Arts et Métiers , ” Ceux de Verdun “.
Marcel Hanra, étonnant de vivacité, présida un banquet réunissant plus de 100 personnes parmi lesquelles ses camarades des Arts et Métiers, et, symbole de l’unité des promotions, son archi archi archi filleule ” nums 30 ” de la promotion Châlons 1986.
Il reçut des mains du président Roland Génin la médaille d’or de la Société des Ingénieurs Arts et Métiers.
La liste des distinctions qu’il a reçues est impressionnante:
– Officier de la Légion d’Honneur,
– Chevalier des Palmes Académiques
– Officier du Mérite Social
– Officier d’Académie
– Croix de guerre 14/18
– Médailles de bronze et d’argent de l’Académie de Médecine
– Diplôme de reconnaissance de la Croix Rouge avec citation
Deux diplômes de reconnaissance:
– l’un du Maréchal de l’Air Marshall, anglais;
– l’autre du Général Dwight Eisenhover, américain;
– la Médaille de la Résistance.
Il est décédé le 16 octobre 1987 à Villemomble et est inhumé au cimetière de l’Ouest, à Châlons sur Marne.
E.DeAndréa (Aix 1945)
Avec l’aide précieuse de Jean Borde (An 1949)
George-Camille Imbault

Châteauneuf sur Loire 1877 – Châteauneuf sur Loire 1951
Promotion Angers 1892
Exceptionnel bâtisseur, G. C. Imbault a consacré sa vie à édifier des ponts dans le monde entier. Quitte à les reconstruire quand la guerre les avait détruits.
Georges-Camille Imbault naît le 2 mai 1877 à Châteauneuf-sur-Loire (Loiret) dans une famille de mariniers sur Loire. Félix, son père, exercera successivement plusieurs métiers : marinier sur les bateaux du grand père, charpentier de marine et constructeur de bateaux. Puis il s’associera avec Guillaume, l’oncle de Georges Camille, et Ferdinand Joseph Arnodin et sera entrepreneur de dragage en Loire et constructeur de dragues.
Cadet de trois garçons, Georges Imbault est très brillant dans ses études. À 15 ans, il entre major aux Arts et Métiers d’Angers en 1892, après avoir redoublé car… il était trop jeune. Major de promotion durant ses trois années d’études, il revient dès sa sortie de l’École à Châteauneuf et participe à la construction de ponts métalliques, au sein de l’entreprise F. Arnodin.
Malgré cette place enviable, il veut se familiariser avec la langue anglaise et voyager à travers le monde ; il part dès 1901 pour Londres où il trouve un emploi temporaire. Ferdinand Arnodin, inventeur du pont transbordeur breveté le 5 novembre 1887, ne tarde pas à faire appel à lui pour suivre les travaux du pont de Newport (portée 325 m).
Du pont-rail au pont-bascule
En parallèle, Imbault est le seul à présenter un projet de montage complexe d’un pont en arc pour le compte de la Cleveland Bridge and Ingineering Co. Ltd. Il s’agit d’un pont-rail à double voie de 1 550 tonnes d’acier, au-dessus des gorges du Zambèze, près des chutes Victoria, en Rhodésie (aujourd’hui le Zimbabwe).
En 1903, son projet est retenu. Jeune ingénieur de 26 ans, Imbault va diriger pendant trois ans et avec succès ce chantier exceptionnel par ses difficultés techniques (arc de portée 152 m et tablier à 128 m du niveau du fleuve) et matérielles (éloigné de tout, climat très humide, accès difficiles).
Puis, la Cleveland Bridge lui confie le montage d’un pont à bascule à Port-Soudan sur les bords de la Mer Rouge ainsi que l’étude de faisabilité du pont de Khartoum (Soudan) sur le Nil Bleu.
De retour en France, il épouse une castelneuvienne, qui le suivra au Soudan. En effet, Imbault est nommé directeur responsable des travaux de l’impressionnant ouvrage soudanais : deux voies ferrées, une route et deux trottoirs, sept travées de 67 m, une basculante de 30 m et deux travées d’approche.
Le chantier est délicat car celui-ci est soumis aux violentes crues du Nil et les fondations des piles sont très profondes. Puis suivront les ponts de chemin de fer sur le Nil Blanc, dont celui de Gor-Abu-Gama (une travée tournante de 75 m et huit travées fixes de 48 m).
À partir de 1911 et jusqu’à la guerre, il réalisera, en tant qu’ingénieur en chef responsable des travaux à l’étranger pour la Cleveland Bridge, plusieurs ponts en Égypte, au Brésil, ainsi que le pont transbordeur de Middlesbrough en Angleterre.
Imbault, mobilisé, va travailler pendant toute la durée de la guerre et jusqu’en 1921, à la reconstruction d’une cinquantaine de ponts détruits par les combats pour lesquels il proposera les services des entreprises castelneuviennes.
Dès l’après-guerre, Basile Baudin (1876-1948), un castelneuvien ancien de chez F. Arnodin, contacte Imbault pour ses compétences reconnues de constructeur de ponts métalliques.
Le 15 mars 1919, il accepte d’entrer dans le conseil d’administration de la société des Ets B. Baudin et Cie, tout en continuant à vivre à Paris avec sa femme et ses deux filles et en gardant ses contacts en Angleterre. À la mort de Ferdinand Arnodin en 1924, Basile Baudin, fabriquant de charpentes métalliques (pylônes, grues…), reprend la construction des ponts.
Un ingénieur mondialement connu
En 1923, Imbault propose à la Cleveland Bridge le projet de construction du Sydney Harbour Bridge (Australie). Le dossier est présenté à une grosse société d’ingénierie, la Dorman Long and Company. Séduite, elle envoie Imbault sur place. Ce projet de pont en arc de 503 m de portée (record du monde inégalé à ce jour) est retenu en février 1924, parmi les 22 proposés. Avec son associé, l’ingénieur londonien Freeman, Imbault est chargé de l’étude et de la fabrication de cet ouvrage d’exception.
Mais en octobre 1930, le gadzarts refuse d’être naturalisé anglais ; seul Freeman représentera la Dorman Long pour l’inauguration. En effet, la crise économique de 1929 se traduit par la quasi-obligation pour les étrangers employés dans les entreprises britanniques de se faire naturaliser ou de quitter le pays. Imbault choisit la deuxième option et rentre définitivement à Châteauneuf-sur-Loire avec sa famille. Il ne reviendra jamais en Australie.
En 1932, une hémorragie cérébrale force Basile Baudin à limiter ses activités. Imbault prend la direction générale effective des Ets B. Baudin et Cie et augmente rapidement le chiffre d’affaires en orientant l’activité plus spécialement vers les ponts suspendus.
L’immédiate après guerre est à la reconstruction, soit à l’identique, soit de façon plus moderne avec seulement deux piles, une travée centrale et deux travées complémentaires rejoignant les culées sur les rives. Ce sera le cas à Gennes en 1948 (Maine-et-Loire) ou à Ancenis en 1953 (Loire-Atlantique), le plus grand pont sur la Loire.
En 1950, l’entreprise avait à son actif plus de cinquante-cinq ouvrages suspendus, les trois quarts des réalisations françaises dans ce domaine.
En mars 1951, Georges Camille Imbault est emporté par une embolie à 74 ans et enterré à Châteauneuf-sur-Loire. L’équipe en place assurera la succession : Robert Carrière (An. 22), directeur de la société, Lucien Chadenson président-directeur général et les deux gendres d’Imbault, Yves Colombot (Cl. 17), né à l’École de Châlons et Armand Ducos (An. 14).
En 1952, la société est rebaptisée de son nom actuel Baudin-Châteauneuf, Yves Colombot en assurera la direction jusqu’en 1976. Son fils aîné, Michel Colombot (Li. 57), petit-fils de Georges Imbault, est depuis à la tête de l’entreprise.
Celle-ci se verra encore confier la construction de nombreux ouvrages. Ce seront les ponts de Tancarville sur la Seine en 1959 (longueur totale 1 420 m, travée centrale 608 m), d’Aquitaine sur la Garonne en 1967 (longueur totale 1 767 m, travée centrale 394 m), de Saint-Nazaire sur la Loire en 1974 (longueur totale 3 356 m, travée centrale 404 m),…
Que de chemin parcouru par les six générations de cette famille, depuis les aïeux mariniers sur Loire, aux industriels bâtisseurs de ponts…toujours restés fidèles à Châteauneuf-sur-Loire.
Jean-Louis Eytier (Bo 68)
avec la très aimable contribution de Michel Colombot (Li 57).
Alcide Kacou

Côte d’Ivoire 14 mars 1919 – 18 avril 2011
Promotion Aix 1938
Artisan du progrès en Côte d’Ivoire.
Tour à tour ministre, chef d’entreprise ou créateur d’une école d’ingénieurs, Alcide Kacou a considérablement œuvré à l’essor industriel de son pays, en initiant et accompagnant de nombreux projets d’infrastructures. Il a aussi été un modèle pour des milliers de jeunes Ivoiriens désireux de devenir ingénieur. Très jeune, Alcide Kacou montre des qualités intellectuelles qui le font remarquer des instances académiques : «Il est intelligent, il faut l’envoyer en France», affirme un inspecteur du primaire, ce qui lui permet d’obtenir une bourse d’enseignement. Le patron français de son père, ouvrier dans une imprimerie, déconseille toutefois de faire comme les autres Africains qui «s’orientent vers le droit ou la médecine» et préconise plutôt de lui faire suivre des études d’ingénieur.
Alcide Kacou, doté d’un sens de l’humour sympathique et sans complexe, aimait raconter qu’il avait failli préparer les Arts et Métiers à Châlons. Mais un gadzart avait onvaincu son entourage qu’il risquait d’y mourir de froid et qu’il fallait l’envoyer à Aix-en-Provence.Il entre ainsi au collège technique de la ville et réussit en 1938 le concours d’entrée aux Arts.
Un an plus tard, il effectue son service militaire puis revient à Aix pour continuer sa scolarité avec la promotion 1940. Il obtient son diplôme d’ingénieur en 1943. Il aime raconter que peu après sa sortie de l’École, avec son premier salaire, il s’était acheté une voiture américaine d’occasion qu’il dut revendre rapidement: «Quand j’arrivais quelque part, on me prenait pour un riche chanteur nègre américain et on me faisait payer en conséquence.»
Son œuvre majeure, la construction du pont Charles-de-Gaulle à Abidjan.
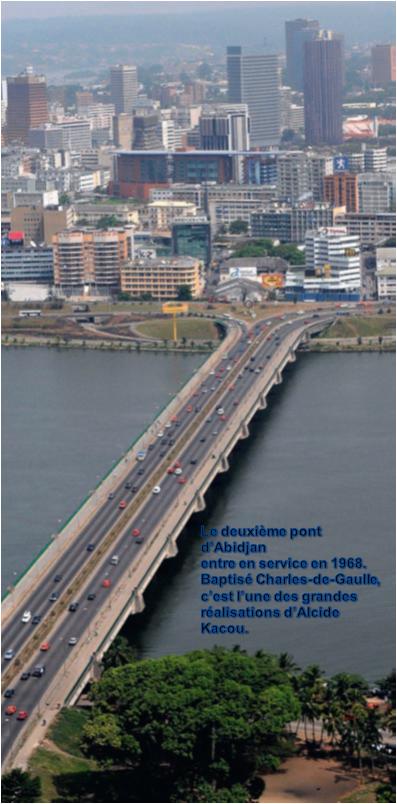
Son diplôme en poche, il intègre la SNCF qui, après un temps de formation, le détache en Guinée. C’est le début d’une longue carrière dans les territoires d’Afrique occidentale et dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire, où il entre en politique. En 1957, il est nommé ministre de l’Enseignement technique. Malheureusement, comme en France, cette filière était insuffisamment valorisée et le ministère est supprimé au bout de trois ans. En 1960, il devient député puis maire de la ville de Grand Bassam. L’année suivante, il est nommé ministre des Travaux publics, transports, postes et télécommunications. Il participe ainsi efficacement au développement de son pays en améliorant considérablement le réseau routier, en initiant la construction de plusieurs ponts, en suivant les travaux du barrage hydroélectrique d’Ayamé, en rénovant des ports ou l’aéroport d’Abidjan. Au milieu des années 1970, avec l’aide de l’École d’Arts et Métiers et de son directeur Louis Feuvrais, il participe à la création d’une école d’ingénieurs généralistes,l’ENSIA, encore très active de nos jours.La construction du deuxième pont d’Abidjan, qui sera baptisé Charles-de-Gaulle, représente son œuvre majeure. Le premier pont Houphouët-Boigny était saturé, Alcide Kacou convainc donc son gouvernement de l’importance du projet. Mais l’État ivoirien étant dans l’incapacité d’en assurer le financement, le ministre se tourne vers un groupement d’entreprises (Sofitom), dirigé par Henri Houdin (Pa. 41), pour mettre au point un montage financier international. Le nouveau pont entrera en service en 1968. Polyvalent et proche des autres ses compétences, son désintéressement et sa sagesse étant très recherchés, Alcide Kacou exercera dans des secteurs d’activité aussi variés que les transports aériens, le contrôle technique des constructions ou l’hôtellerie. Il crée également une usine de fabrication de béton manufacturé, toujours en service et dirigée actuellement par un gadzarts, Daniel Paul (Ai. 67). Malgré de multiples fonctions et une famille nombreuse (il a eu huit enfants), il trouve néanmoins le temps de s’occuper d’œuvres caritatives, via son club Rotary dont le taux d’assiduité est l’un des meilleurs, d’encadrer des activités sportives et d’être chevalier du Tastevin.

Tous ceux qui ont travaillé avec lui ou l’ont approché conservent l’image d’un homme proche des autres. Ses activités professionnelles et politiques en Côte d’Ivoire et dans d’autres pays d’Afrique Occidentale lui valent de nombreuses distinctions. Il est décoré dans son pays mais aussi au Liberia, en Tunisie, au Gabon, au Niger, en Allemagne fédérale et bien sûr en France. Il reçoit de la Société des ingénieurs Arts et Métiers le prix Nessim Habif en 1979 – récompense décernée à un ingénieur qui aura contribué sensiblement au progrès de l’industrie – pour la part qu’il prit au développement de son pays en améliorant le réseau routier.
Mais il se plaisait à dire que le titre dont il était le plus fier était d’être gadzarts. Il participe d’ailleurs activement, en tant que membre du comité de 1962 à 1965, aux activités de la Société.
Alcide Kacou, décédé dans sa 93e année, a eu droit à de grandioses funérailles en 2011. Les cérémonies ont duré cinq jours en présence de deux rois locaux. C’est d’ailleurs à cette occasion que l’on a appris qu’ Alcide Kacou était prince. Un très grand nombre de personnes ont assisté aux obsèques : la famille bien évidemment, mais aussi les amis, d’anciens collaborateurs, des représentants du gouvernement ou de la société civile, et la communauté Arts et Métiers.Un hommage à la hauteur du personnage et de ce qu’il a réalisé en Côte d’Ivoire.
André Sauze – Aix 50
PHOTO N. ZORKOT Ai38 — Arts&Métiers Mag – Décembre 2011-Janvier 2012
Charles Albert Keller

Romagne-sous-Montfaucon 1874 – Grenoble 1940
Promotion Angers 1890
Né dans un petit village de Lorraine, Charles-Albert Keller a créé ex nihilo un empire dauphinois de l’électricité et de la sidérurgie.
Charles-Albert Keller naît le 1er janvier 1874 à Romagne-sous-Montfaucon, dans la Meuse. Ce charmant petit village de 165 habitants héberge aujourd’hui sur son territoire le plus grand cimetière militaire américain de la Première Guerre mondiale. Charles-Albert est issu d’une famille modeste. Son père Alphonse est percepteur, sa mère Marie-Augustine – née Lombard – reste au foyer. Un grand-père aubergiste et un oncle cafetier ne le prédisposent guère à devenir capitaine d’industrie. Et pourtant…
Sa famille étant venue s’établir à Saint-Ouen, il intègre l’École d’Arts et Métiers d’Angers en 1890, en compagnie d’un certain Louis Delage. Après un premier poste au Bureau des études des ateliers de la Marine (Farcot, Saint-Ouen), il rejoint le 1er novembre 1896 le Bureau d’ingénieurs-conseils électrométallurgistes. C’est une “PME innovante” de l’époque, dirigée par Gustave Gin (Ch. 1875). Il y développe des fours électriques industriels de différents types. En 1899, il prend à son nom le brevet d’un four à deux électrodes. Ce four équipera finalement 18 usines en Europe et en Amérique. Il n’a que 25 ans…
Chercheur et entrepreneur dans l’âme, Charles-Albert quitte rapidement sa condition de salarié. En 1900, il s’associe avec Henri Leleux (38 ans). Dans leur usine de Kerousse (Morbihan), ils fabriquent au four électrique du carbure de calcium.
Ce produit constitue à l’époque la seule source connue d’acétylène, gaz d’éclairage alors très employé (mais qui n’est plus guère utilisé de nos jours que pour les lampes des spéléologues). Une petite chute d’eau produit l’électricité nécessaire. Malgré sa faible puissance, Charles-Albert met au point la fabrication de plusieurs produits sidérurgiques, dont des aciers au chrome utilisés pour les blindages. En 1901, il parvient – c’est une innovation – à produire de l’acier dans un four électrique. Il présente ses résultats au premier Congrès de la Houille blanche à Grenoble, en 1902. Dès lors, sa trajectoire professionnelle prend son orientation définitive. Sans attendre, il recherche dans le Dauphiné un site industriel dont les dénivelés peuvent fournir la puissance hydraulique dont il a besoin. Il remarque une usine de carbure de calcium abandonnée, à Livet. Cette commune (aujourd’hui Livet-et-Gavet) se niche à 620 m d’altitude dans la vallée encaissée de la Romanche, à 20 km au sud-est de Grenoble (voir AMM de janvier-février 1997). Charles-Albert Keller y implante le noyau de toute une structure de production d’acier et d’électricité. Dès 1902, le gadzarts met en service une première batterie de fours électriques de 1 250 ch. Puis il augmente la puissance de la chute d’eau de 60 m (20 000 ch. en 1926).
L’industriel trouve aussi le temps de se marier. Marie Mathis, sa première épouse (il en aura trois), est une Alsacienne de 22 ans. Ils s’unissent en 1906 à Paris VIIIe, où Charles-Albert a un logement, rue de Moscou. La même année, à 32 ans, il crée les structures juridiques nécessaires à son développement: la société Keller et Leleux S.A., au capital de 3 500 000 F – en francs-or, soit 10 millions d’euros aujourd’hui.\\ Un an plus tard, il réussit à traiter directement le minerai de fer dans un four spécial: c’est le haut-fourneau électrique. Mais la grande réussite de Keller sera en 1908 l’obtention de fonte synthétique, au four électrique, à partir de ferrailles et de charbon. Ce procédé devient pendant la Grande Guerre d’autant plus stratégique que les mines et hauts-fourneaux du Nord et de l’Est sont indisponibles. Charles-Albert reste donc à son “poste de combat” : la direction de ses usines, que la Défense nationale sollicite fortement.
Pour augmenter la production, il a besoin de davantage d’énergie. À cet effet, il construit en 1916 l’extraordinaire centrale des Vernes, où il manifeste son goût pour l’architecture (voir encadré). Entre 1914 et 1918, Livet fabrique 120 000 t de fonte pour les obus de gros calibre. Une voie ferrée qui escalade la vallée alimente l’usine en ferrailles et évacue la production.
En 1919, les insignes de chevalier de la Légion d’honneur récompensent Charles-Albert Keller – un des premiers civils ainsi distingués – pour cette contribution exceptionnelle à l’effort de guerre. Il a entre-temps divorcé, et en 1923, il épouse Maria-Marguerite Moulins (33 ans), à Paris VIIe.\\ À l’Exposition internationale de la houille blanche de Grenoble, en 1925, l’ingénieur promeut ses conceptions novatrices de l’électrométallurgie et de l’emploi de l’électricité hydraulique… et est promu officier de la Légion d’honneur.
Membre influent du Conseil supérieur de l’Exposition, il y participe également par le stand des Établissements Keller et Leleux. En 1927, il installe à Livet un nouveau four géant, qui contribue à augmenter la consommation d’énergie.
Charles-Albert Keller construit donc de nouvelles centrales. Il équipe les deux chutes du Bâton (l’une de 560 et l’autre, de 1 100 m, un temps la plus haute chute de France). Il construit ensuite la centrale de l’île Falcon (lac Mort, au plateau de Laffrey), et enfin celle de la Roizonne. Ces centrales, reliées entre elles, fonctionnent en réseau. Le lac Mort constitue le réservoir principal des six centrales, reliées en outre à la centrale de Saint-Guillerme (barrage du Chambon, en Haute-Romanche). En 1938, la production électrique totale atteint 125 000 MWh, partagés presque également entre les fours de Livet et l’alimentation électrique de Grenoble (à comparer aux 560 000 MWh de la nouvelle centrale de Gavet, en projet actuellement).
LA CENTRALE DES VERNES, CATHÉDRALE À LA GLOIRE DE L’EAU
Classée Monument historique, la centrale des Vernes illustre de façon théâtrale la puissance motrice de l’eau. De grandes baies vitrées percent ses deux bâtiments massifs, éclairant le hall intérieur carrelé. Leur charpente métallique à voûtains supporte la terrasse, desservie par un escalier à deux volées. Un jardin à la française y était aménagé. Le bassin de décharge ressemble à une fontaine monumentale, et deux tuyaux de 2,50 m de diamètre amènent l’eau aux turbines. Cette centrale produit toujours de l’électricité EDF. La future centrale hydro-électrique de Gavet devrait la remplacer après 2010, ainsi que les cinq autres centrales de la vallée de la Romanche. La centrale des Vernes et la façade de l’usine de Livet sont les deux seuls bâtiments industriels préservés dans ce projet.
Charles-Albert dirige cet ensemble depuis le “bureau promontoire”, pièce de sa villa bâtie en rotonde sur pilotis, qui domine les installations de Livet. On le connaît comme un patron social, créant toutes sortes d’avantages pour son personnel (logement, magasins, mutuelle). L’industriel fait l’acquisition en 1919 du château historique de la Veyrie (à Bernin, dans l’Isère), qui deviendra sa résidence secondaire. Il est membre du Comité de la Société des ingénieurs Arts et Métiers de 1920 à 1923 et préside ensuite le Groupe régional Arts et Métiers du Dauphiné. En 1937, il contribue largement à l’édification du Centre régional XII – Dauphiné pour l’Exposition internationale de Paris. L’année suivante, élu président de la Chambre de commerce de Grenoble, il devient commandeur de la Légion d’honneur.
Infatigable, il lancera d’autres grands projets, par exemple l’aéroport de Grenoble et la Maison du Dauphiné à Paris : “Certaines missions dans la vie ne connaissent pas de retraite, professe-t-il. Elles doivent naturellement se prolonger en vertu d’une tacite reconduction de l’existence et de soi-même. Leur cessation n’est pas à notre propre gré.”
À 57 ans, en 1931, il épouse en troisièmes noces à Paris XVIIe Louise Adèle Marie Trochet (43 ans), dont il a eu un fils, Albert. Mécène, il finance l’installation des vitraux de l’église paroissiale de Livet, où figurent les usines… et leur fondateur ! Charles-Albert s’éteint le 22 octobre 1940, à Grenoble. Il repose au cimetière de Livet. Le dernier four de Livet s’est arrêté en 1967, mais les centrales tournent toujours.
Pierre Tarrissi (Aix 70) .
Léon Lemartin

Dunes 1883 – 1911
Promotion Aix 1899
Pionnier de l’aviation, Théodore Le Martin, dit Léon Lemartin, a côtoyé les plus grands de cette épopée. D’abord ingénieur mécanicien très recherché, il fut aussi l’un des premiers pilotes d’essais.
Dès sa naissance, le 20 octobre 1883 à Dunes (Tarn-et-Garonne), Théodore, Clovis, Edmond Le Martin reçoit le prénom d’usage de Léon : ses prénoms officiels sont aussi ceux de ses grands-pères et de son père. Ce dernier, maréchal-ferrant, compagnon du Tour de France, est l’inventeur de plusieurs fours de maréchal, dont certains brevetés ; il croit au progrès, aux sciences appliquées, à la révolution technologique. Une fois son fils pourvu de son certificat d’études, il le fait entrer à l’École pratique d’Agen. Élève doué, plutôt précoce, “Léon” fait preuve de sérieux et de volonté; à tel point que ses maîtres l’incitent à poursuivre ses études. Et c’est à moins de 16 ans, en octobre 1899, qu’il quitte son pays du Brulhois natal pour Aix-en-Provence, où il est admis aux Arts et Métiers.
Il a passé de nombreuses heures dans la forge paternelle et souvent aidé son père, d’où une habileté manuelle hors du commun. Mais, exilé, il s’ennuie des siens, d’autant que les affaires périclitent à Dunes. Dès qu’il a son diplôme en poche, en juillet 1902, il part pour la Capitale afin de trouver au plus vite un emploi pour aider sa famille. Ayant besoin d’un acte de naissance pour des démarches administratives, il découvre une coquille sur son état civil: “Le Martin” est écrit “Lemartin” !
Pour éviter des complications, il adoptera cette nouvelle orthographe. En décembre 1902, il fait la connaissance de Louise Soriano : divorcée d’un passionné d’aviation, le comte Charles de Lambert, elle s’est remariée avec un Sud-Américain fortuné, Ricardo Soriano. Elle présentera Léon à ces deux hommes, mais aussi à Santos-Dumont, qui initiera le gadzarts à l’aérostation. Avec Ricardo Soriano, qui financera le projet, Lemartin tente une incursion dans le domaine des aérostats. Mais suite à un incendie lors des essais de gonflage, son expérience se révèle malheureuse. Léon abandonne les aérostats pour se tourner définitivement vers les appareils plus lourds que l’air : les avions. Il va rapidement devenir un ingénieur-mécanicien recherché. Il côtoiera les plus grands constructeurs du moment. En décembre 1907, Louise meurt. Elle sera enterrée à Dunes. Léon adopte sa fille Jane de Lambert, née du premier mariage de Louise.
À cette époque, Léon travaille sur la structure (ailes, carlingue). Il participe au montage des biplans des frères Voisin, sans trop y croire toutefois : il partage l’avis de Blériot, promoteur du monoplan. À l’évidence, la pièce maîtresse d’un avion reste le moteur.
Aussi Léon quittet-il les frères Voisin pour l’entreprise des frères Louis et Laurent Seguin, pères du Gnome Oméga, un moteur rotatif révolutionnaire pensé et développé pour les aéroplanes. Le gadzarts va devenir un “metteur au point” hors pair pour ce moteur, et très courtisé. Chez les frères Seguin, il bénéficie d’un statut spécial: il est officiellement détaché auprès des aviateurs qui utilisent le Gnome, et peut exercer des missions pour son propre compte. Les exploits se multiplient, signés Henry Farman (premier kilomètre en circuit fermé en janvier 1909), Léon Delagrange (premier passager, en mars), Louis Blériot… Autant d’utilisateurs de moteurs Gnome réglés par Lemartin. Durant ces années exaltantes, où l’enthousiasmedes spectateurs décuple, Léon Lemartin participe directement à l’avancée soudaine de l’aviation.
Il suit plus particulièrement Blériot qui, en 1909, a besoin d’un exploit pour se renflouer : le “Daily Mail” promet 25 000 F au premier pilote qui réussira la traversée de la Manche. Léon est appelé pour mettre au point le nouveau moteur du “Blériot XI”, équipé d’une hélice Lucien Chauvière (An. 1891), un Anzani de 25 ch ; mais, après des mois de travail acharné, le “patron” Blériot renonce. Le comte de Lambert fait de son côté ses préparatifs sur le biplan Wright, ainsi qu’Hubert Latham sur le monoplan “Antoinette IV” de Léon Levavasseur… Le 20 juillet, Blériot change d’avis et bat le rappel de ses troupes. Le lendemain, l’avion démonté à Paris est acheminé vers Calais en chemin de fer.
Lemartin rejoint l’équipe. L’appareil est monté en deux jours, il ne reste plus qu’à attendre une météo favorable. Le 25 au petit matin, on sort le monoplan, on fait chauffer le moteur avant un petit vol d’essai d’une dizaine de minutes. Puis c’est l’envol pour l’Angleterre: 38 km en 32 min. Et le triomphe de Louis Blériot.
À peine un mois plus tard, du 22 au 29 août, Blériot, Curtiss, Delagrange, Farman, de Lambert, Latham, Paulhan, Santos-Dumont, les frères Wright et dix-huit autres pilotes se retrouvent à la Semaine de Reims-Bétheny, un meeting aérien. Lemartin vient d’inventer un système qui accroît sensiblement le rendement dans les pointes de vitesse. Sur les cinq épreuves inscrites au programme, quatre sont remportées par deux avions à moteurs Gnome : sont battus le record de vitesse par Louis Blériot sur le “Blériot XII” (77 km/h) et le record de distance (180 km), de durée (3 h 15) et de passagers (2) par Henry Farman sur Voisin.
LE PREMIER CONTRAT DE PILOTE D’ESSAIS
[…] À dater de ce jour, Monsieur Théodore Lemartin sera affecté aux écoles de pilotes de la Maison Blériot […]. Il sera spécialement occupé au réglage des appareils et à leurs essais de réception […]. Après avoir obtenu ses brevets, il touchera 400 F par mois, plus 30 F pour chaque appareil dont il aura fait l’essai officiel […]. En cas de mort par accident, une somme de 32 500 F sera versée à sa veuve ou ses ayants droit par Monsieur Blériot. Fait à Paris le 20 août 1910.”
Après avoir décliné une offre de Farman (car il apprécie la relative liberté dont il bénéficie chez les frères Seguin), Léon Lemartin franchit un grand pas l’année suivante. Il rêve de voler, lui aussi, et signe le premier contrat connu de pilote d’essais (voir encadré). 45 jours après avoir passé les trois épreuves du brevet, il reçoit sa carte de l’Aéro-club de France, qui le nomme pilote-aviateur sous le numéro 249. Le nouveau fou volant enchaîne alors les records du monde du nombre de passagers (6, puis 8, 11 et 13) et de vitesse (128,418 km/h en 1911).
Il se doit de participer aux courses pour promouvoir les avions Blériot. Les prix sont partagés à raison de 2/3 pour Blériot et 1/3 pour Lemartin. Le 18 juin 1911, à Vincennes, il prend le départ du Circuit européen. Avec 1 600 km à parcourir en 8 étapes, cette épreuve, la plus dure jamais proposée (65 engagés, 41 au départ, 9 à l’arrivée), est dotée de 450 000 F de prix. Le gadzarts a travaillé toute la nuit sur les monoplans Blériot de ses équipiers, dont André Beaumont – qui gagnera le circuit – et Roland Garros. Ce dernier juge qu’il y a trop de vent et refuse de partir, au risque d’être mis hors course. Devant plus d’un million de spectateurs enthousiastes, Léon Lemartin s’envole. L’avion, pris dans une bourrasque, pique du nez. Pour éviter la foule, le pilote s’écrase aux commandes. Il décède peu après son arrivée à l’hôpital. Léon Lemartin repose dans son village natal. Il laisse, outre Jane, trois filles et sa veuve Madeleine, qui se remariera avec son frère Albert, un fabricant de cycles à Dunes.
Jean-Louis Eytier (Bo 68),
Avec l’aimable contribution de l’unique petit-fils de Lemartin, Jacques Dalmon
Hippolyte Maindron

Champtoceaux 1601 – Paris 1884
Promotion Angers 1816
Issu d’un milieu modeste, un ingénieur Arts et Métiers devenu sculpteur va connaître un très grand succès tout au long du XIX° siècle. Au salon des Beaux-Arts de 1839, une statue de Velléda obtient un succès considérable, et vaut à son auteur une grande notoriété. Ce jeune sculpteur presque inconnu, qui vient de présenter le modèle en plâtre de son œuvre et va alors recevoir de l’État de nombreuses commandes, c’est Hippolyte Maindron.
Né à Champtoceaux (Maine-et-Loire) en 1801, II n’a reçu qu’une instruction fort incomplète (…). Il est contraint d’enter dans le commerce à onze ans, et se retrouve commis dans une maison de Bourbon-Vendée. Mais, déjà, ses dispositions pour le dessin se manifestent d’une manière frappante, et il est admis gracieusement à suivre tes leçons du collège de la ville. Il obtient une bourse du département pour entrer aux Arts et Métiers d’Angers, dont il sortira en août 1823. Après un nouveau passage dans le commerce, il revient comme surveillant à l’École, de 1824 à 1826.
Ses dispositions évidentes pour la sculpture lui valent une pension du département, pendant trois ans, de 500 F. Cela lui permet de se rendre à Paris et d’être admis à l’École des Beaux-Arts en 1827 David d’Angers, le grand statuaire, lui ouvre les portes de son atelier. Hippolyte Maindron va l’aider dans l’exécution du fronton du Panthéon. Il expose pour la première fois au Salon de 1834, avec une statue d’un “Jeune berger piqué par un serpent”, dont le marbre est maintenant visible au musée d’Angers. Cette œuvre, d’une exécution irréprochable, fut très remarquée, et valut à son auteur un légitime succès.
La “Velléda” présentée en plâtre en 1839, puis en marbre en 1844, peut être admirée au jardin du Luxembourg, côté boulevard Saint-Michel. Cette œuvre, inspirée par le livre X des “Martyrs” de Chateaubriant, est fidèle au portrait dressé par l’écrivain, de cette druidesse gauloise, couronnée de feuilles de chêne, et portant les accessoires rituels, la faucille d’or et la lyre. La représentation de cette fière guerrière, amoureuse et fragile dans sa méditation inconsolable, défraie la chronique; la statue obtient à l’époque un succès considérable et vaut à l’artiste une grande notoriété et de multiples commandes (…).
Parmi les très nombreuses œuvres de Maindron, il faut citer les deux groupes, commandés par l’État, qui ont figuré sous le grand péristyle d’entrée du Panthéon : “Attila et Sainte Geneviève” (1857) et “La conversion de Clovis par saint Rémi” (1865). Ces deux grands ensembles ont été renvoyés aux réserves des musées lors de dernière restauration du monument, et ne sont donc plus visibles.

Mais pour les gadzarts, le plus beau titre de gloire de Maindron est d’avoir réalisé la statue en pied du duc de La Rochefoucauld, qui se trouve place de Liancourt. Commandé à notre sculpteur conjointement par la ville de Liancourt et la Société des anciens élèves , pour honorer leur bienfaiteur, le modèle, d’une hauteur de 2,80 mètres, a été coulé en bronze aux Arts et Métiers d’Angers. La statue a été moulée couchée, et coulée d’un seul jet (900 kg). Son inauguration, le 26 octobre 1861, a été l’occasion d’une grande tête à Liancourt, qui a rassemblé près de quinze mille personnes. Elle devait évidemment se trouver au centre des cérémonies du Centenaire de l’École en 1880. Malheureusement, ce bronze original fut “récupéré” par l’Occupant en 1941. Grâce à de multiples, tenaces et généreuses bonnes volontés, animées par l’ingénieur Arts et Métiers Nicolas Monnier, grâce aussi à des moulages soigneusement conservés, une nouvelle statue a été remise en place le 24 juin 1951.
À côté de cette statue magistrale, Maindron a aussi exécuté le buste du duc de La Rocheloucauld, puis celui de son fils, le marquis Frédéric-Gaétan, à la demande de la Société AM, en reconnaissance du don fait en 1859 d’une rente annuelle et perpétuelle de 2 000 F. Les deux bustes juste terminés furent dévoilés et acclamés par les participants au banquet qui suivit l’assemblée générale du 5 août 1860, réunis dans “les vastes salons de Wepler à Batignolles”.

Maindron n’ayant voulu aucune rémunération pour la travail artistique de retouche après les coulages, l’un à Châlons, l’autre à Angers, fut nommé par acclamation membre perpétuel de la Société AM. Un deuxième exemplaire du buste du marquis, réalisé grâce à une souscription des sociétaires, leur fut offert le 25 janvier 1861. De nombreuses copies ou réductions en bronze ont été réalisées par la suite, aux bons soins d’Auguste Gouge, établi à Paris comme fabricant éditeur de bronzes d’art, sa marque apparaissant à côté de la signature de Maindron.
Le catalogue des œuvres de Maindron est impressionnant, et toutes ne sont pas dans les musées. Ainsi, à l’église de La Madeleine, sous le portique latéral de droite, se trouve une statue en pierre de 3,17 m de haut : saint Grégoire de Valois (la douzième en partant de la façade, mais masquée actuellement par des travaux). (…)Citons aussi une “Vierge à l’Enfant” offerte par l’auteur à l’église de Champtoceaux, son pays natal.

Médaillé plusieurs fois, chevalier de la Légion d’honneur en 1874, Maindron prit encore part au salon de 1880 et mourut à Paris le 21 mars 1884.
Extrait de l’article de Jean Vuillemin (Pa 40)
parut dans Arts et Métiers Magazine – Octobre 2001.
Pierre-Joseph Meifred
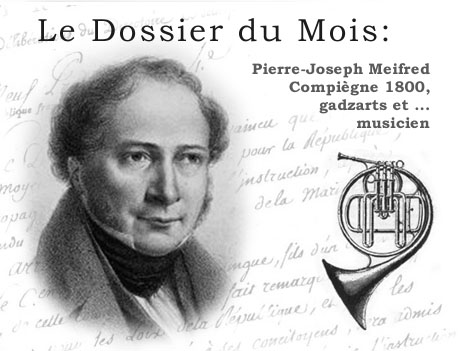
“Ce n’est pas ma faute si, m’étant couché élève du prytanée de Compiègne, je me suis éveillé un beau matin, et sans l’avoir rêvé, élève d’une école d’Arts et Métiers !…”
Colmar 1791 – Paris 1867
Promotion Compiègne 1800 – Châlons 1806
MEIFRED Pierre-Joseph – Compiègne 1800 – Châlons 1806 Né le 22 novembre 1791 à Colmars, dans les Basses-Alpes, Pierre-Joseph Meifred est le fils d’un officier supérieur tué durant la Campagne d’Italie. En 1800, il entre au prytanée de Compiègne et rejoint ainsi d’autres enfants de “défenseurs de la Patrie”. Disposant déjà de quelques notions, il fait partie de la musique de l’école, où il choisit le cor. Doué d’aptitudes remarquables, il s’illustrera notamment en exécutant un concerto au théâtre de Compiègne. En 1803, le prytanée de Compiègne est transformé en école d’Arts et Métiers. À peine trois années plus tard, son transfert à Châlons-sur-Marne est décrété.

En décembre de cette même année, le jeune Meifred et ses camarades rejoignent à marche forcée leur nouvelle cité d’accueil, comme une compagnie de la Grande Armée. Meifred est un élève brillant dans les diverses disciplines enseignées, comme en témoignent une distribution des prix de septembre 1808, et un palmarès conservé au Musée national gadzarts de Liancourt. En 1811, il est nommé aspirant de l’École et, à ce titre, adjoint au directeur des travaux.
À l’issue de sa formation, l’année suivante, le duc de La Rochefoucauld, fondateur des Écoles d’Arts et Métiers, le recommande auprès de l’impératrice Joséphine, en qualité de secrétaire. Son introduction dans ce nouvel environnement est facilitée par la comtesse Alexandre de La Rochefoucauld, dame d’honneur de l’impératrice. Le château de Malmaison, résidence de Joséphine, accueille fréquemment les cornistes Naderman et Duvernoy. La qualité de leurs récitals accentue l’attrait de Meifred pour son instrument de prédilection. Mais en 1814, cette période faste s’achève brutalement, lorsque survient le décès de l’impératrice. Meifred se retrouve alors secrétaire particulier du duc de La Rochefoucauld, jusqu’aux Cent Jours.
Au lendemain de cette période, il s’oriente pleinement vers une carrière artistique, en se présentant au Conservatoire de musique. Après une audition devant les membres éminents du comité d’enseignement, parmi lesquels figurent Méhul et Chérubini, il est admis dans la classe de Duvernoy. Sous la Restauration, le Conservatoire, rebaptisé École royale de musique, subit une réorganisation. Le maître de Meifred, Duvernoy, est alors remplacé par Dauprat. En 1818, Meifred remporte le premier prix de cor et entre au théâtre des Italiens. En 1822, il est appelé à l’Académie royale de musique et remporte une place vacante à la chapelle de Louis XVIII.
C’est vers cette époque que, rappelant à son souvenir quelques connaissances acquises à l’école de Châlons, Pierre-Joseph Meifred met au point le système à trois pistons qui va révolutionner la pratique du cor chromatique. L’instrument qu’il fait construire obtient la médaille d’honneur à l’Exposition de 1827. Le musicien-inventeur va consacrer plusieurs années à perfectionner son innovation, qu’il abandonnera finalement au domaine public afin d’en faciliter l’essor. Ce système à trois pistons est en vigueur encore de nos jours, non seulement pour le cor, mais aussi pour le cornet, la trompette et le saxhorn.
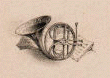
En 1828, Meifred fonde, avec Habeneck, la Société des concerts, dont il devient le secrétaire. Cinq ans plus tard, il obtient au conservatoire la création d’une classe dont il deviendra le professeur. Il rejoint peu après les membres du Conseil d’enseignement, sur une proposition de Chérubini. Et, après les événements de 1848, il est nommé Capitaine de musique de la troisième subdivision de la Garde nationale de Paris !
On doit à Meifred de nombreuses publications organologiques et pédagogiques, dont la première méthode écrite pour le “cor perfectionné”, dit à pistons ou chromatique. Il publie également une notice sur la fabrication des instruments de cuivre en général, et du cor chromatique en particulier. Outre ses études sur les instruments de musique, Meifred compose des poèmes et des chants aux caractères fantaisistes : “Le Café de l’opéra”, “La Société des boulettes” (1829), “L’Impromptu impossible” (1848), et le conte en vers “Mécanicien” en 1851).
Meifred est également à l’origine de trois tentatives de constitution d’une association des anciens élèves des Écoles d’Arts et Métiers. Membre fondateur de la Société Arts et Métiers, qui voit définitivement le jour en 1846, il participe à la rédaction de ses statuts. Il en sera vice-président de 1850 à 1855 et président d’honneur en 1856. Dans une allocution prononcée au banquet des anciens élèves de 1863, lui qui s’est consacré à la musique rend hommage à ses camarades, témoins et acteurs de la révolution industrielle :
“Si je m’appelais Salomon de Caus ou Papin, Watt, Fulton ou Arago, il me serait bien agréable de m’entretenir avec vous dans une langue qui vous est si familière, et je trouverais ce moment très opportun pour vous proposer de passer en revue les admirables et récentes découvertes de la science et de l’industrie, pas de géant que nous mesurerions ensemble, et qui sera l’honneur de notre époque ! Si j’étais ingénieur, j’aimerais tracer le plan, les épures de ce grand monument du progrès, auquel chacun de vous apporte incessamment sa pierre !” D’aucuns verront en Meifred l’artiste talentueux; il apparaît aussi pour la communauté Arts et Métiers comme un digne représentant de l’esprit gadzarts, certes un peu frondeur, et enfin, comme l’initiateur de leurs “amusantes traditions”. Ami du duc de La Rochefoucauld, il était tout comme lui dévoué et novateur. Chevalier de la Légion d’honneur, Pierre-Joseph Meifred devait décéder à l’âge de soixante-seize ans en son domicile parisien, au 47 de la rue Fontaine-Saint-Georges.
Frédéric Champlon, Ingénieur A&M
Extrait de Arts et Métiers Magazine – Mai 2002.
Antoine Odier
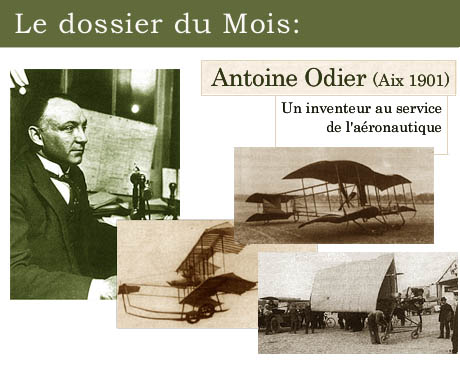
“Le démon de la mécanique possédait Odier” Gabriel Voisin.
Tournon 1884 – Alger 1956
Promotion Aix 1901
Un inventeur au service de l’aéronautique
Antoine Odier naît en 1884 à Tournon dans l’Ardèche dans une famille modeste. Son père né à St Alban du Rhône, employé de commerce, meurt dès 1889. A cinq ans, il est recueilli et élevé par un vieil oncle de Bourg-les-Valence. Celui-ci, ancien officier mécanicien de la Marine, se dévoue sans compter pour envoyer le jeune Antoine ” aux Ecoles “.Très doué pour les mathématiques et la mécanique, Antoine Odier est reçu dans les premiers à l’Ecole d’Aix-en-Provence ; il est aussi très doué pour les chahuts et les blagues scientifiques. Diplomé en 1904 , il travaille d’abord sur les bicyclettes et les motos , puis dans différentes firmes d’automobiles de Lyon et de Genève. Mais déjà, il ne rêve que d’aviation . Ces rêves prennent d’abord la forme d’articles publiés à partir de 1907 par des revues de l’époque :La Technique automobile, l’Aérophile etc. Il entre même en correspondance avec Clément Ader dont, plus tard, il justifiera les choix techniques sur son ” Eole “.
En 1908, il rencontre à Paris son idéal de jeune ingénieur : Léon Turcat des automobiles ” Turcat-Méry ” qui accepte de commanditer l’étude et la construction d’un prototype d’avion par Antoine Odier et Raoul Vendome ; ils devront utiliser le moteur des voitures de la firme qui pèse 220 kg refroidissement compris pour une puissance effective de 18 cv, à comparer avec les 12kg pour 16cv de la ” Demoiselle ” de Santos Dumont. L’imagination et l’intuition extraordinaires d’Antoine Odier vont faire merveille. Il crée un profil d’aile creux que, des années plus tard, Eiffel reconnaîtra comme étant le mieux adapté à ce genre de machine . Il dessine une hélice originale ultra-légère dont la forme est logique et efficace. Toute la structure de ce premier biplan ” Odier-Vendome ” , construit en bois et en toile est un chef-d’œuvre de légèreté. Il est assemblé dans un hangar de Grenelle attenant aux ateliers Regio, ( Ai 1901 ).Deux innovations le caractérisent déjà : la suppression de l’équilibreur avant et le remplacement des roulettes de queue par des béquilles à sandow.
Elles seront vite copiées par 2 les autres constructeurs qui se retrouvent sur le terrain d’Issy-les-Moulineaux, c.a.d. Blériot, les frères Voisin, Nieuport,Santos-Dumont et Védoville . L’avion décollera du premier coup le 27 mai 1909 avec, aux commandes, Antoine Odier qui n’avait jamais piloté. Le 20 juin suivant, il découvre la perte de vitesse à quelques mètres seulement de hauteur et ” casse du bois “. Le 18 juillet, Odier va effectuer son premier virage. Puis il décolle avec une passagère de 38 kg (une première). Le 22, il effectue 4 tours de terrain ” hors barrières “. Le 25 éclate la nouvelle de la traversée de la Manche par Blériot. Un deuxième avion biplan est construit en 1910. Il est muni d’une hélice tractrice et d’un volant breveté conjuguant profondeur et gauchissement qui ne sera généralisé qu’à partir de 1930.
Suit une période vouée aux meetings et aux courses auxquelles les grands pilotes de l’époque vont se livrer. Ils demandent des ” Machines à Voler ” aux ailes repliables ou démontables pour le transport par route et le stockage facile dans les hangars. Odier va y exceller. Puis il devient Ingénieur en chef des Avions Borel. Il conçoit alors toute une série de monoplans à moteur rotatif Gnome 50 cv très surs d’emploi ; ils remportent de nombreux prix et équipent les premières écoles de pilotage militaires et civiles.

L’année 1912 voit l’avènement des hydravions Borel-Odier dont le premier sera piloté par Geo Chemet (Ch 1908). Après le succès qu’il remporte dans une course à Tamise en Belgique, 12 machines sont commandées par la Royal Navy et 18 par la Marine Italienne, mais aucune par la France. Au début de la Grande Guerre, Antoine Odier est chargé de mettre en route des fabrications de matériels de guerre aéronautiques ou non. Puis, à la demande de la Marine, il conçoit, avec peu de moyens, un hydravion bi-moteur à flotteurs dont le prototype est construit avec beaucoup de difficultés en 1916 et sera piloté par Geo Chemet. Le premier d’une série de 90 appareils est livré en 1917 et montre des performances inégalées pour l’époque. C’est à cette 3 occasion que Antoine Odier va créer le démarreur embarqué à gaz comprimé (CO2) permettant de lancer sans danger les moteurs de 200 cv équipant ces hydravions torpilleurs.
En 1918, une version amovible permet de démarrer sur avion des moteurs de 300 cv et rencontre un succès mondial. Elle va lui permettre de créer sa propre entreprise, la société A. Odier à Levallois avec laquelle il acquiert enfin son indépendance.
Cette activité ne lui suffira pas . En novembre 1924, devant son ami le député Laurent Eynac, il fait tourner pendant un quart d’heure à 15 000 tr/mn la première turbine à explosions ébauche visionnaire du turbo-propulseur qui ne verra le jour que 30 ans plus tard. Avec l’illustre ingénieur Gustave Bessière (Ai 1898) il construit à partir d’un Caudron 193 le Clinogyre inspiré de l’autogyre de l’ingénieur De La Cierva et auquel l’armée ne s’intéressera pas.

En 1930, grâce à l’appui du grand ingénieur Albert Caquot ( X 1899 ) du Service Technique de l’Aéronautique et de Laurent Eynac, alors Ministre de l’Air, avec l’Ingénieur général Louis Jauch ( Ai 1898) et Gustave Bessière, Antoine Odier crée l’Ecole Spéciale des Travaux Aéronautiques ( E.S.T.A.) qu’il dirigera jusqu’en 1939. Cette école a donné chaque année jusqu’en 1998 une formation aéronautique de haut niveau à plus de 30 ingénieurs diplômés ( en particulier Arts-et-Métiers). Dotée d’un statut d’école privée, un enseignement évolutif était dispensé par des intervenants de l’industrie aéronautique laquelle finançait son fonctionnement depuis les années 50. Les anciens élèves de l’E.S.T.A. avaient créé, au début des années 80 un prix Odier attribué tous les deux ans à un ingénieur de l’aéronautique qui s’était distingué par des travaux originaux et de qualité.
Profondément marqué par la défaite de 1940, Antoine Odier ferme son usine de Levallois. Après avoir prospecté en vain la zone libre , il s’établit définitivement à Alger où il prend une participation dans une teinturerie industrielle. Il s’éteint le 6 novembre 1956 à Alger où il est inhumé. Un an avant de disparaître, il publie un livre étonnant et passionnant , plein de verve 4 et d’esprit : ” Souvenirs d’une Vieille Tige ” dont son ami Gabriel Voisin écrira la préface : “Le Démon de la Mécanique possédait Odier. S’il me fallait décrire tout ce que ce mécanicien de génie a produit d’ingénieux et de pratique, il me faudrait allonger cette préface qui deviendrait une encyclopédie….Un Français bien français, un de ces admirables utopistes pleins d’idées, plein de réalisations, plein de rêves, plein de réalités, capables de concevoir une machine à explorer le temps.”

Dans ce XX ème siècle si fécond en inventions de toutes sortes suivies d’une révolution des technologies , Antoine Odier est arrivé avec son esprit pratique de Gadzarts doublé d’une formidable capacité d’observation et d’analyse des problèmes rencontrés. Il trouve d’instinct les solutions les plus simples et les plus économiques. Il a pris de nombreux brevets , mais, comme bien des inventeurs, il n’a pas toujours su aller jusqu’au bout de ses découvertes et se fera souvent copier par ses concurrents. Il lui aura peut-être manqué un véritable esprit d’entrepreneur et l’art de fréquenter l’ antichambre des grands décideurs. Antoine Odier était Chevalier de la Légion d’Honneur.
Son fils, le regretté Professeur Marc Odier a écrit son émouvante histoire dans les n° 49 et 50 de la revue Pionniers ( Association des Vieilles Tiges dont Odier était membre)
G. Gutman. (Cl 1943 . E.S.T.A.) Ancien président des anciens élèves de l ‘ E .S.T.A.
Denis Poulot

Gray 1832 – Père La Chaise 1905
Promotion Châlons 1847
Il faut que les Ecoles d’Arts et Métiers forment des sujets de plus en plus instruits, constamment maintenus à la hauteur des sciences mécaniques appliquées, et pouvant, par un travail assidu, s’élever aux premiers rangs de l’industrie française. Denis Poulot
La vie de Denis Poulot est celle qui, pour nous, personnifiait le plus le Gadzarts et le meilleur Camarade, la vie de l’industriel et du grand philanthrope\\ M.P.Barbier (Ch 1862), Maire adjoint du 11e.
Denis Poulot naquit le 3 mars 1832 à Gray. Il entra aux Arts-et-Métiers à Châlons en 1847. A sa sortie, son frère Alfred (Ch 1836), associé dans une entreprise de construction de machines-outils, l’embaucha, d’abord comme ajusteur-tourneur, puis chef monteur. En 1852, on le retrouve contremaître chez Gouin, constructeur où il fut attaché à Alphonse Oudry (Ch 1832, polytechnique) pour la construction du pont tournant de Brest. Il décide alors en 1857 de fonder sa propre fabrique de ferronnerie dans le 19e, à Paris, qu’il cèdera en 1868 à Nicolas Vuillaume (Ch 1840) dont le fils Ernest (Ch 1872) a été Président de la Société de 1913 à 1917. En 1872, il crée au 50, av. Philippe-Auguste à Paris une ” Fabrique de produits pour polissage ” (émeri, meules et machines à polir) remportant une médaille d’argent à l’Exposition de 1878 (…).
Cette activité manufacturière ne l’a pas empêché de s’engager dans la vie publique, de s’impliquer dans la Société des Anciens Elèves et d’écrire un certain nombre d’ouvrages, soit techniques, soit de réflexion sur la société de son temps.
En mars 1879, il est nommé maire du 11e arrondissement de Paris par Mr Hérold, préfet de la Seine. Il le restera trois ans, déclarant en 1882 :” En démocratie, il ne faut éterniser ni les fonctions, ni les mandats. ” Durant ce mandat relativement court, il s’appliquera à imposer des réformes qui correspondaient aux idées nouvelles. Ami de Gambetta, il était un ” esprit libéral ” convaincu (…). Un square proche de la Mairie porte son nom.
Son engagement à la Société des Anciens Elèves a été particulièrement important, pour la défense de l’Ecole et pour son évolution. La France de la fin du 19e était au cœur d’une nouvelle bataille des Anciens et des Modernes. On sait que le mot République dans la Constitution de 1875 avait été acquis à une voix de majorité, ce qui laisse supposer que quelques années plus tard, les Conservateurs et les Libéraux étaient encore à peu près à égalité dans le pays . La Société des Anciens Elèves était un reflet de la société civile et comme telle se partageait entre conservateurs et libéraux . La controverse éclata lorsque le Ministère du Commerce, tuteur de l’Ecole, envisagea d’élever le niveau des études. Les sociétaires se divisèrent en deux camps, l’un emmené par le Président Lucien Arbel (Aix 1843) et par César Trotabas (Aix 1844) qui ne voulaient pas de cette évolution, l’autre emmené par Denis Poulot qui la défendait. Une véritable campagne électorale (voir encadré) pour désigner le successeur de L.Arbel eut lieu et D. Poulot fut élu à une confortable majorité. Il nomma tout de suite une commission interne chargée d’étudier une réforme de l’Ecole qui, dans un rapport rendu en 1884, recommanda l’élévation du niveau des cours (…).
Mais Denis Poulot est connu aussi, en Littérature et en Sciences Sociales, comme auteur d’un livre édité en 1870, réédité trois fois, la dernière en 1980 : ” Le Sublime ou le travailleur comme il est en 1870, et ce qu’il peut être “. Il y décrit, avec sincérité et lucidité, son expérience d’ouvrier et de contremaître en usine et les ravages de l’alcoolisme qui y régnait. Cet ouvrage fit l’objet d’une polémique, le directeur du journal, ” Télégraphe “, Auguste Dumont, accusant Zola de plagiat en ayant utilisé des passages entiers du ” Sublime ” dans ” L’Assommoir “, Zola y répondant par une lettre ouverte dans laquelle il expliquait qu’il “avait l’habitude de prendre ses références dans les livres les plus sérieux.”
Cette activité débordante ne l’a pas empêché d’être membre du Conseil de perfectionnement des Ecoles d’Arts et Métiers et inspecteur régional de l’Enseignement technique et il mettait beaucoup d’ardeur à remplir ces fonctions. Il était Officier de la Légion d’Honneur, Officier d’académie.
Décédé le 28 mars 1905 ; ses obsèques ont eu lieu le 31 mars, en présence de plus de mille personnes. Il est inhumé au Père Lachaise.
Edmond De Andrea, ingénieur Arts et Métiers (Aix 45).
Extrait de ‘Arts et Métiers Magazine’ – Mars 2003.
Emile Prisse d'Avennes

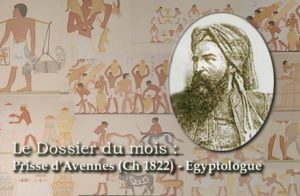
Suivons les traces d’Emile Prisse d’Avennes qui parti dès 19 ans combattre pour l’indépendance de la Grèce. Puis, il explora l’Égypte, enseigna la topographie et l’art de la fortification, étudia l’assèchement du delta du Nil.
 Buste de Prisse d’Avennes conservé au Musée d’Orsay.
Buste de Prisse d’Avennes conservé au Musée d’Orsay.Avesnes-sur-Helpe 1807 – Paris 1879
Promotion Châlon 1822
Né le 27-01-1807 à Avennes, décédé le 16-02-1879, il fut Ingénieur, libraire et journaliste.
“En 1822, il entra à l’école de Châlons avec l’intention de se préparer à l’Ecole polytechnique. Toutefois son grand-père, qui était pour lui un guide éclairé et son meilleur soutien, vint mettre obstacle à ce projet.
Il s’illustra dès 1826 par son projet de la Grande-Fontaine de la Bastille dite ‘fontaine de l’Éléphant’. Ce projet lui attira maints éloges mais il n’y fut pas donné suite.
Refusant de se plier à des emplois subalternes, il résolut de s’abandonner à ses goûts artistiques et à ses penchants d’explorateur. Ainsi, en 1826 il prit part à la guerre d’indépendance grecque, puis s’en fut aux Indes en qualité de secrétaire du gouverneur général. S’étant démis de ses fonctions, il passa en Palestine. Il fut nommé chevalier du Saint-Sépulcre pour avoir sauvé le temple de Jérusalem …”.
“… De 1827 à 1844, il parcourut et explora l’Egypte et la Nubie, se consacrant non seulement à des recherches et à des découvertes de la plus haute importance mais à une propagande des plus actives et des plus efficaces pour l’influence française, montrant une énergie extraordinaire dans des circonstances difficiles et souvent périlleuses.
Le vice-roi d’Égypte Mohamed-Aly dont il avait su gagner l’estime lui confia les fonctions d’ingénieur civil et d’hydrographe, puis de professeur de topographie à l’École de la marine. Il fut aussi professeur de fortifications à l’Ecole d’infanterie de Damiette et gouverneur des jeunes Princes, enfants d’Ibrahim-Pacha.
En 1836, il renonça à ces situations officielles pour s’adonner entièrement à l’égyptologie et en particulier à l’étude des hiéroglyphes, science dans laquelle il devait surpasser l’illustre Champollion.
A travers la Turquie, la Perse, La Palestine, l’Arabie, La haute et basse Égypte, la Nubie, l’Éthiopie, l’Abyssinie, la Syrie, pendant dix-sept années de fatigues incessantes, de misères, de privations, de luttes et de dangers, Prisse d’Avennes recueillit une abondante et merveilleuse moisson d’ inestimables trésors dont il enrichissa notre patrimoine national.”
Parmi les monuments et documents qui furent envoyés en France figurent, le Papyrus Prisse d’Avennesconsidéré comme le premier écrit de l’humanité lettré. Ce serait le plus ancien livre du monde. Il fut découvert dans la nécropole de Thèbes.
“… En 1844, Prisse d’Avennes revint en France. En 1845, il fut fait chevalier de la Légion d’honneur. Chargé de nombreuses missions scientifiques, commerciales et artistiques en Égypte et dans les régions avoisinantes, il en rapporta d’innombrables documents, dessins, aquarelles, photographies, plans, croquis extrêmement précieux. En outre, il publia une quantité considérable de mémoires, de notices dont une Encyclopédie égyptienne.”
Source : Biographie de Prisse d’Avennes rédigée par C.N. Peltrisot membre de la société archéologique et historique de l’arrondissement d’Avennes (publié 1934).
Article extrait de Arts et Métiers Magazine de Novembre 2002
Jules Ramas

La Voulte-Sur-Rhône 1869 – Chatou 1963
Promotion Aix 1885
“Ardéchois, cœur fidèle” : Jules Ramas vérifiera cet adage tout au long de sa vie par ses engagements militaires et industriels, autant que familiaux et sociaux.
Jules Ramas est né le 25 novembre 1869 à La Voulte-sur-Rhône (entre Valence et Montélimar), dans une famille où l’on cultive les vertus traditionnelles. Celles-ci marqueront son enfance studieuse. Son “pays” natal vit alors au rythme des mines de fer et des hauts-fourneaux. Son parrain est chef des fabrications dans la métallurgie à La Voulte et son frère aîné Émile (Aix 1882) y sera jeune ingénieur. Naturellement, Jules s’oriente vers les Arts et Métiers qu’il intègre 2e de sa promotion en 1885 pour en sortir major en 1888, année de la fermeture des usines sidérurgiques locales.
À sa sortie de l’École, il s’engage et effectue un an de service militaire. Son parrain Émile Clere étant devenu entre-temps directeur des usines de Marquise (Pas-de-Calais), il entre à son tour dans le groupe. Durant huit ans, il effectue de nombreuses missions à l’étranger. Il commence avec l’étude et la construction de l’usine à gaz de Constantinople, puis se rend dans le même but à Galatz, en Roumanie. En 1895, il se trouve à Cuba, où il assure non seulement des travaux techniques de distribution d’eau, mais aussi la formation du personnel. Il devra fuir clandestinement vers l’Amérique du Nord à bord d’un voilier, pour échapper aux violences de la révolution qui vient d’éclater.
Malgré ces déplacements multiples, il trouve le temps de fonder une famille : en avril 1896, il épouse Marguerite Clere, la fille de son parrain, native comme lui de La Voulte. Ils auront deux garçons et deux filles. Néanmoins, l’ingénieur s’expatrie une fois de plus pour travailler à l’usine à gaz de Corfou.
Son beau-père, qui l’a déjà aidé à orienter sa carrière à la sortie de l’École, est passé des usines de Marquise aux Forges de Gorcy (Meurthe-et-Moselle), en tant que directeur. Jules Ramas suit le même chemin. Avec son beau-père et son frère Émile, il participe à la fondation de la société métallurgique Griffin, dont il assure la direction puis l’administration générale jusqu’en 1936.
Chargé de mission pour Churchill !
Cette vie professionnelle et familiale menée de main de maître se heurte à la déclaration de guerre de 1914. Jules Ramas est mobilisé dès le 2 août. Le 6, on le charge de la défense du fort de Banbois, près d’Épinal. Puis il monte en première ligne du front de Lorraine à Badonviller, en mars 1915. Capitaine mitrailleur, il est cité à l’ordre de la Division et nommé chef de bataillon; il a 46 ans. Jusqu’en 1917, il assure divers commandements à l’état-major du Génie sur la demande du général Roques, et invente un procédé rapide et efficace de pose de barbelés. Il assure par ailleurs des missions diverses, notamment à Londres auprès de Winston Churchill, alors ministre de l’Armement, et également auprès d’attachés militaires italiens et belges. C’est à titre militaire qu’il devient chevalier de la Légion d’honneur en 1917, et reçoit des distinctions italiennes et belges.
À l’Armistice du 11 novembre 1918, on le charge de missions pour la réorganisation des aciéries françaises en Lorraine et en région désannexée. Il est démobilisé en 1919 avec le grade de lieutenant-colonel, et termine ainsi brillamment une période douloureuse et héroïque, durant laquelle il a fourni la preuve de ses qualités de chef, de sa valeur technique, d’un courage tranquille et d’une grande volonté. Son fils aîné Émile, engagé volontaire dès 1914 à l’âge de 18 ans, est blessé à Verdun: il reçoit la Croix de guerre et la Légion d’honneur.
La fin de la guerre ramène Jules Ramas à l’industrie lorraine. Son rôle technique à la commission interministérielle des métaux et fabrications de guerre en 1917 l’amène à la direction générale du Comptoir sidérurgique de France, fondé par les 17 aciéries françaises pour restaurer l’industrie sidérurgique nationale. Ses compétences sont unanimement reconnues, de même que ses qualités de caractère et son sens aigu de l’intérêt général. Devenu administrateur délégué vers 1925, il assume ce poste jusqu’en novembre 1940, date à laquelle cette organisation est mise en sommeil.
La période d’entre-deux-guerres va permettre à cet homme infatigable d’assurer, avec persévérance et dévouement, de nombreuses fonctions bénévoles, en priorité dans la Société des anciens élèves de l’Ensam, où il s’investit dès 1903, par séquences successives : 18 ans au Comité, dont trois ans comme vice-président, puis trois années comme président, de 1932 à 1935.
Un personnage très estimé
La haute estime que d’éminentes personnalités portent à sa conception de l’intérêt général contribue à étendre le rayonnement de l’École et le renom des Arts et Métiers. Témoin, la profonde amitié qu’il reçoit du président de la République Albert Lebrun. Sa connaissance de l’École et des besoins de l’industrie le désigne naturellement au conseil de perfectionnement de l’École. Il se montre très attentif aux problèmes existants pour préparer l’École et les gadzarts à un avenir digne de leur histoire : il y est très attaché et ne manque jamais de le rappeler avec beaucoup d’émotion. Également attentif au maintien de la fraternité, il remarque au cours de sa présence au Comité que ses membres, de générations différentes, se connaissent mal. Il institue alors le “dîner de la relève” pour que les “entrants” et les “sortants” aient l’occasion de se rencontrer. Cette manifestation chaleureuse reste aujourd’hui très appréciée. Son passé de voyageur et sa personnalité entraînent également Jules Ramas à la Société des ingénieurs de l’outre-mer: il en devient président de 1936 à 1946. Cette fonction lui vaut le titre de Commandeur de la Légion d’honneur. Il devient également conseiller du Commerce extérieur. Un homme comme lui ne pouvait passer inaperçu : il est sollicité par le maire de Chatou dès 1920 pour siéger au Conseil municipal. Il en devient maire à son tour de 1935 à 1944, et ces neuf années de mandat se révèlent difficiles. En 1936, des grèves avec occupation d’usines l’obligent à assurer le maintien de l’ordre: le gouvernement, débordé, passe la main aux autorités locales. L’effigie du maire de Chatou fait alors l’objet d’une parodie de pendaison! Jules Ramas fait face avec le courage tranquille et la détermination souriante d’un Ardéchois entêté!
Après une courte accalmie, le temps de nouvelles épreuves se profile avec l’année 1939: une nouvelle fois la guerre se déclenche, accompagnée de l’Occupation. Ses deux fils et l’un de ses gendres sont mobilisés. L’aîné, déjà blessé à Verdun et commandant d’artillerie, est fait prisonnier en 1940; il est père de quatre enfants. Son fils cadet, Henri, ingénieur du Génie maritime, est tué le 18 juin 1940 en défendant Cherbourg. Ayant rejeté l’ultimatum de Rommel, il a retardé la prise du port et permis l’évacuation de 50000 Anglais. Lors de ses obsèques, les honneurs lui sont rendus par les Allemands. Il laisse quatre orphelins. Le gendre de Jules Ramas, capitaine d’artillerie, reçoit la Légion d’honneur et la Croix de guerre; il a également quatre enfants.
La ville de Chatou n’est pas épargnée: réfugiés, ponts sautés, bombardements… Marguerite Ramas assiste son mari sur place, le relayant au Secours national et à la Croix rouge.
Après ces nouvelles épreuves, Jules Ramas profite de sa famille, qui compte de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants. Jusqu’à sa fin et malgré son grand âge, il continuera à servir la communauté gadzarts et à lui apporter son expérience, avec une jeunesse de cœur exceptionnelle. Jules Ramas est décédé le 18 juillet 1963 à Chatou à l’âge de 94 ans.
Jean Vuillemin (Paris 40)
Charles-Armand Trépardoux

Paris 1853 – Arcueil-Cachan 1920
Promotion Anger 1868
Ce passionné de sciences mécaniques a compté parmi les précurseurs de l’automobile.Son nom reste associé à l’histoire des “voitures sans chevaux”.
Lorsqu´en 1769, Cugnot expérimente son mémorable fardier à vapeur, aujourd’hui exposé au musée du Conservatoire national des Arts et Métiers, il ne peut soupçonner que plus d´un siècle de patience sera nécessaire avant l´avènement de l´automobile. Charles-Armand Trépardoux fait partie de ces pionniers qui, grâce à leur inventivité et leur talent, ont donné naissance aux premières voitures dites “sans chevaux”.
Charles Trépardoux est né le 26 février 1853, 2 rue Férou à Paris. Encouragé par son père à suivre des études techniques sérieuses, il entre à l´École impériale d´Arts et Métiers d´Angers en 1868, alors que la France s´apprête à traverser une période particulièrement sombre avec l´invasion de la Prusse. Après trois années de formation aux sciences mécaniques, le jeune Charles sort 41e de sa promotion. Une fois son devoir militaire accompli au sein d´un régiment de Génie en 1873, il exerce une activité de dessinateur industriel à Paris. En 1877, il épouse Marie Joly mais celle-ci décède brutalement quelques mois plus tard.
Domicilié rue de Clignancourt, Trépardoux rencontre le mécanicien Georges Bouton, également installé dans ce quartier. Les deux techniciens s´associent et ouvrent un atelier dans le passage Léon, situé à proximité de la rue de La Chapelle. Ensemble, ils construisent du matériel destiné à des cabinets de physique ou des instruments scientifiques de précision, appréciés des amateurs fortunés.
Outre le talent et la compétence, ces réalisations exigeaient perfectionnisme et rigueur ; des qualités partagées par les deux techniciens. Les deux hommes s´apprécient et leur entente se conforte par le mariage de Charles Trépardoux avec la jeune sœur de Georges Bouton, Eugénie-Ernestine, en 1879.
Parallèlement, l´atelier produisait des modèles réduits de bateaux à vapeur ou des locomotives de salon. Ces objets rares et luxueux étaient commercialisés par la prestigieuse maison Giroux, située boulevard des Italiens. Vers la fin de 1881, le Comte Albert de Dion remarque, dans la devanture du fameux magasin, une petite machine à vapeur. Passionné de propulsion mécanique, le Comte s´enthousiasme devant la qualité et l´ingéniosité du modèle. Il entreprend alors de rencontrer Trépardoux et Bouton. À cette époque, les mécaniciens projettent la mise au point d´un nouveau type de chaudière, laquelle permettrait d´assurer la force motrice de véhicules légers. Séduit par les enjeux du projet, de Dion propose d´en financer les travaux.
En 1882, tous trois créent ensemble sous la signature “Trépardoux et Cie, ingénieurs-constructeurs”, mais celle-ci ne fait référence qu´à Trépardoux, car pour le service des Mines chargé d´agréer les chaudières, le gadzarts est le seul à posséder le titre d´ingénieur. Un premier prototype de quadricycle à vapeur est expérimenté avec succès durant l´été 1884. Encouragés par les résultats de leurs premiers essais, les constructeurs conçoivent un nouveau véhicule plus puissant en 1885. Véritable voiture de tourisme, l´engin connaît un vif engouement (cf. encadré), notamment auprès d´un acquéreur de notoriété, le chocolatier Menier.
La chaudière présentée par “Trépardoux et Cie” allie toutes les qualités : robustesse, fiabilité, puissance, mais également légèreté, ce qui lui permet d´être utilisée pour la propulsion de canots ou de yachts de plaisance. En 1887, la société enfin formalisée adopte la dénomination “De Dion, Bouton & Trépardoux”. Elle est commanditée par le ministère de la Marine pour la construction de la chaudière d´un torpilleur. C´est également à cette époque qu’elle participe, le 28 avril 1887, à une course de vélocipèdes avec un tricycle à vapeur particulièrement léger. Piloté par Georges Bouton, le bolide couvre les 32 km de parcours avec une vitesse moyenne de 26 km/h, et aurait par ailleurs dépassé la vitesse record de 60 km/h.
Installé à Puteaux depuis 1884, Trépardoux est élu conseiller municipal en 1888. En charge de la commission des travaux, il s´occupe notamment des projets d´extension de lignes de tramway entre Marly-le-Roi et la porte Maillot. Quelques années plus tard, alors premier adjoint au maire, il participe au projet de construction du pont de Puteaux.
La notoriété de la société De Dion, Bouton et Trépardoux est désormais acquise. Paris connaît alors une effervescence particulière avec l´Exposition universelle de 1889. Au sein du Pavillon Geneste-Herscher, elle présente des chaudières de grande puissance en fonctionnement.

Cependant, de nouvelles techniques de propulsion apparaissent avec l´électricité et les carburants liquides. Bien que les moteurs à pétrole manquent encore de fiabilité, de Dion est très attiré par ce procédé, susceptible de remplacer la vapeur si chère à Trépardoux.
En 1890, Eugénie Bouton, épouse de Trépardoux, décède lors de la naissance de leur second fils. Cette tragédie affecte profondément son mari. La relation entre le gadzarts et le comte De Dion se dégrade alors fortement. Déjà opposés sur les orientations techniques et industrielles de la société, les fortes personnalités des deux hommes se heurtent. Trépardoux n´accepte plus le comportement parfois désinvolte du comte, et leurs échanges se résument désormais à des querelles récurrentes. Ils mettent finalement un terme à leur association le 27 mai 1893. Trépardoux conservera toutefois des droits d´exploitation sur certains brevets. Peu après la dissolution de la Société “De Dion, Bouton & Trépardoux”, comme on enlève le nom du partant, d´aucuns diront que le comte s´est employé à effacer les traces de cette association dans les archives de l´entreprise, mais aussi sur les photos ou plaques de cuivre des machines.
Quelques années plus tard, Trépardoux épouse Héloïse Godot en troisième noce. Installé 36, rue de Paris à Colombes, Trépardoux conçoit différents matériels et développe des applications de sa chaudière légère. En 1896, il dépose de nouveaux brevets mais, comme l´idée de la vapeur régresse, il rencontre de nombreuses difficultés à se développer. Il pourra bien entendu évoquer l´influence néfaste de son ancien associé…
Manifestement aigri, Trépardoux s´efface progressivement. Il quitte Colombes en 1902 pour rejoindre le domaine de son beau-père à St-Aubin-les-Forges, dans la Nièvre. Il reviendra en région parisienne et décèdera le 4 mai 1920 à Arcueil-Cachan.
Peu d´informations sont disponibles sur son parcours au-delà de 1900. Toutefois, le nom de Trépardoux reste étroitement lié à l´histoire de l´automobile. Comme l’un de ses précurseurs qui contribuèrent, par leur inventivité et leur ardeur, à la naissance de cette industrie.
Frédéric Champlon (Ch. 94), avec le soutien de l’Amicale de Dion-Bouton
Guillaume Wilhem

A la veille de la tourmente révolutionnaire, le 18 décembre 1781, Guillaume-Louis Bocquillon naît à Paris où son père faisait le commerce de parfumerie. Non contents de n’être que les témoins d’événements historiques majeurs, ils en deviennent des acteurs. En effet, en 1791, à peine âgé de 10 ans, il rejoint son père François Bocquillon devenu chef de bataillon au sein de l’armée du Nord.
Le jeune Boquillon est enrégimenté en qualité de sapeur parmi ces ‘Volontaires’, tous plus inexpérimentés qu’enthousiastes.
1781 – Père La chaise 1842
Promotion Liancourt 1795 – Compiègne 1800
Liancourt, un asile bien cher à notre souvenir
L’ambition qu’avait François Bocquillon à l’égard de son fils l’amène à le rendre aux études et à l’envoyer à l’Ecole Nationale de Liancourt. En juillet 1795, le sac au dos, les manches décorées des haches de sapeur, le jeune Wilhem rejoint le château de Liancourt. L’école à peine installée dans la propriété du duc de La Rochefoucauld, accueille près d’une centaine de fils d’officiers ‘défenseurs de la patrie’. Si la discipline très sévère et les privations sont le lot quotidien des élèves, la fraternisation des jeunes gens contribue à les surmonter : ” cet asile, où nous étions si malheureux, est bien cher à notre souvenir ; il a vu commencer des amitiés qui sont inaltérables “. Dans un récit de 1834, Wilhem dressera un des rares témoignages sur la vie et le dénuement des élèves de Liancourt de 1795.
Pierre Crouzet, directeur de l’institution de Liancourt distingue Wilhem comme faisant parti des plus recommandables. Ainsi, dans un rapport datant du 7 janvier 1799, le chef de compagnie Bocquillon est cité comme ” instruit dans les mathématiques, la fortification, la grammaire, la musique, comme aimé de tous les élèves, respecté par ses subordonnés, estimé par ses supérieurs, comme un modèle d’application, de sagesse et de bonté “. Son goût pour la musique et ses talents pour la composition laissent présager une vocation pour cet art ; d’autant que ses talents sont alors reconnus et encouragés par les fameux Gossec, Méhul et Cherubini.
Du Prytanée de Compiègne à celui de Saint-Cyr
De retour d’exil en 1799, le duc de La Rochefoucauld obtient le transfert de l’établissement à Compiègne. L’école devient alors une composante du Prytanée Français et Wilhem gagne dans cette organisation militaire le grade de capitaine. En 1801, suite aux recommandations de Crouzet, Boquillon est admis au Conservatoire national de musique. Toutefois, les pressions paternelles l’incitent à se tenir éloigné d’une carrière musicale et à poursuivre son apprentissage à Compiègne pendant une année encore.
En 1802, Crouzet est appelé à diriger le Prytanée de Saint-Cyr et Wilhem prend lui aussi le chemin de cette institution où il va exercer la fonction de répétiteur en mathématiques. A la faveur d’une visite du Conseiller d’Etat Roederer, Wilhem fait exécuter un hymne de Gossec par quelques élèves. Le zèle du jeune répétiteur conduit sa hiérarchie à le charger officiellement de donner des leçons sur l’art musical.
Wilhem quitte le Prytanée de Saint-Cyr en 1807, année de son transfert à La Flèche. Un nouvel emploi dépendant du ministère de l’intérieur le met ainsi à l’abri du besoin tout en lui laissant le temps de donner des leçons de musique et de composer des airs longtemps restés populaires : Brennus, la Vivandière, la Bonne vieille, les Adieux de Charles VII, etc.
Une rencontre décisive
Durant cette époque son fidèle ami de Liancourt, Benjamin Antier lui présente un certain Pierre-Jean de Béranger. Ce dernier deviendra l’illustre chansonnier, dont nombre de paroles, seront accompagnées par des airs de …Wilhem. La chanson ! disait Béranger. La musique et la chanson ! disait Wilhem. Ils devinrent rapidement de grands amis ; ils partageaient les mêmes ambitions, les mêmes attentions. Notamment à l’égard du peuple car pour Wilhem : ” enseigner le chant, ce n’était pas seulement distraire le peuple, c’était aussi le moraliser “. L’amitié profonde qui lia les deux hommes ne se brisa qu’avec la mort.
Le succès d’une méthode
Après une nomination de professeur de musique au Lycée Napoléon en 1810, il expérimente huit ans plus tard une méthode d’enseignement mutuel appliquée à la musique. Encouragé par le succès des premiers résultats, Wilhem étend ses essais à l’ensemble des élèves d’une école parisienne. Le perfectionnement quotidien de la méthode en conforte le succès. En 1820, ses efforts lui permettent d’obtenir la nomination de professeur de chant pour la ville de Paris. Bientôt, son influence n’allait plus se limiter qu’à la seule capitale, car de nombreux visiteurs vinrent étudier la fameuse méthode.
En 1821, puis en 1828 la Société pour l’instruction élémentaire lui décerne des médailles d’argent et d’or; cette reconnaissance est renforcée en 1835 avec la remise de la croix de La Légion d’Honneur et la nomination de directeur-inspecteur du chant.
Inspiré par ce qui se pratiquait déjà en Suisse et en Allemagne, Wilhem voulut constituer une société de choristes. Une fois par mois, il rassembla quelques élèves de divers quartiers parisiens dans un local de l’école du passage Pecquay. Wilhem fonde ainsi la Société de l’Orphéon en 1833. Les nombreux élèves formés selon les principes définis par Wilhem allaient constituer le socle où L’Orphéon allait puiser ses choristes. L’immense succès des réunions publique des orphéonistes contribua également à accentuer la notoriété de Wilhem.
L’hommage à une œuvre et à son géniteur
Tandis que des pays étrangers tels que l’Angleterre et la Belgique commencent à développer la méthode à leurs propres établissements, Wilhem est atteint d’une fluxion de la poitrine. Une semaine plus tard, le 26 avril 1842, ses nombreux élèves et amis ne partageaient plus que d’unanimes regrets. Les magnifiques funérailles qui lui sont rendues, l’imposant cortège qui l’accompagne jusqu’au Père-Lachaise attestent de la grandeur accordée à son œuvre.
Celui qui apparaît comme le véritable propagateur du chant aux écoles françaises, était aussi connu pour son dévouement, son désintéressement exemplaire et son indéfectible persévérance au travail.
Quelques mois avant la disparition de Wilhem, son vieil ami Béranger, poète national lui adresse ces couplets dont la terminaison est tout aussi troublante qu’ annonciatrice.
Mon vieil ami, ta gloire est grande Grâce à tes merveilleux efforts, Des travailleurs la voix s'amende Et se plie aux savants accords. Wilhem, toi de qui la jeunesse Rêva Grétry, Gluck et Mozart, Courage ! à la foule en détresse Ouvre les trésors de l'art. (…) D'une œuvre et si longue et si rude Auras-tu le prix mérité ? Va, ne crains pas l'ingratitude, Et ris-toi de la pauvreté. D'une fée as-tu la baguette, Pour rendre ainsi l'art familier ? Il purifiera la guinguette ; Il sanctifiera l'atelier. (…) Quand tu pouvais sur notre scène Tenter un brillant laurier, Tu choisis d'alléger la chaîne Du pauvre enfant de l'ouvrier. (…) Sur ta tombe, tu peux m'en croire, Ceux dont tu charmes les douleurs Offriront un jour à ta gloire Des chants, des larmes et des fleurs.
Frédéric Champlon – Châlons 94